14juillet2010
Posté par Paul dans la catégorie : aventures et voyages au féminin; Histoire locale, nationale, internationale : pages de mémoire.
l’histoire étonnante de l’une des premières journalistes d’investigation
 Le 22 novembre 1889, une journaliste américaine de 25 ans rencontre l’écrivain Jules Verne à Amiens. Ce rendez-vous est programmé depuis plusieurs semaines déjà. La jeune femme a embarqué le 14 novembre à New York, à bord du paquebot Augusta Victoria, s’est arrêtée à Londres puis a débarqué à Calais. Son départ des Etats-Unis s’est fait en tambour et trompette. Il faut dire qu’elle s’est fixé un objectif ambitieux pour l’époque : elle a lancé le pari qu’elle ferait mieux que Phileas Fogg, le héros de l’écrivain français, et réaliserait un tour du monde en moins de 80 jours, ce qui serait une première dans l’histoire. L’entrevue entre Nellie Bly et Jules Verne est très cordiale. La jeune femme lui fait part de ses espoirs, de ses projets. L’écrivain lui montre l’abondante documentation qu’il a rassemblée pour écrire son roman, et il est très ému de rencontrer celle qui va donner corps à son héros imaginaire. La seule déception du Français vient du fait que la jeune Américaine refuse de goûter à l’excellente bouteille qu’il a choisie dans sa cave à cette occasion. Miss Bly n’aime pas l’alcool ! Cela ne l’empêche pas de prodiguer de nombreux encouragements à la jeune aventurière lors de son départ, le lendemain. Cette rencontre marque l’écrivain au point qu’il décide que les héros de son prochain roman seront américains, et il se lance dans la rédaction de « Mistress Branigan », l’épopée d’une femme qui part à la recherche de son mari, disparu en mer… Jules Verne est informé par des dépêches que lui adresse le journal new-yorkais, des progrès du tour du monde de Nellie Bly.
Le 22 novembre 1889, une journaliste américaine de 25 ans rencontre l’écrivain Jules Verne à Amiens. Ce rendez-vous est programmé depuis plusieurs semaines déjà. La jeune femme a embarqué le 14 novembre à New York, à bord du paquebot Augusta Victoria, s’est arrêtée à Londres puis a débarqué à Calais. Son départ des Etats-Unis s’est fait en tambour et trompette. Il faut dire qu’elle s’est fixé un objectif ambitieux pour l’époque : elle a lancé le pari qu’elle ferait mieux que Phileas Fogg, le héros de l’écrivain français, et réaliserait un tour du monde en moins de 80 jours, ce qui serait une première dans l’histoire. L’entrevue entre Nellie Bly et Jules Verne est très cordiale. La jeune femme lui fait part de ses espoirs, de ses projets. L’écrivain lui montre l’abondante documentation qu’il a rassemblée pour écrire son roman, et il est très ému de rencontrer celle qui va donner corps à son héros imaginaire. La seule déception du Français vient du fait que la jeune Américaine refuse de goûter à l’excellente bouteille qu’il a choisie dans sa cave à cette occasion. Miss Bly n’aime pas l’alcool ! Cela ne l’empêche pas de prodiguer de nombreux encouragements à la jeune aventurière lors de son départ, le lendemain. Cette rencontre marque l’écrivain au point qu’il décide que les héros de son prochain roman seront américains, et il se lance dans la rédaction de « Mistress Branigan », l’épopée d’une femme qui part à la recherche de son mari, disparu en mer… Jules Verne est informé par des dépêches que lui adresse le journal new-yorkais, des progrès du tour du monde de Nellie Bly.
Le voyage de la jeune journaliste se poursuit sans encombre et un mois après son départ, elle se trouve sur l’île de Ceylan, dans la ville de Colombo, attendant avec impatience le bateau qui doit la conduire à Hong Kong, puis à Tokyo…. A chacune de ses escales dans des grandes villes, elle câble à son journal, le « New York World » un récit pittoresque de ses dernières aventures. Les lecteurs attendent chaque nouvel épisode avec une impatience comparable à celle qui touche les amateurs de feuilletons à suspens, et, au fil des jours, sa célébrité grandit aux Etats-Unis. Lorsqu’elle arrive enfin à New York, le 25 janvier 1890, elle a parcouru 40 070 kilomètres et largement remporté son pari puisqu’il ne lui a fallu « que » 72 jours, six heures et 11 minutes. Elle est accueillie triomphalement et cette notoriété singulièrement acquise va lui permettre de réaliser son rêve : écrire et surtout faire publier des reportages sur ses thèmes de prédilection. Nellie Bly est en effet une journaliste qui s’intéresse au « social », aux conditions de vie des plus humbles, et n’hésite pas à payer de sa personne pour rédiger ses reportages.
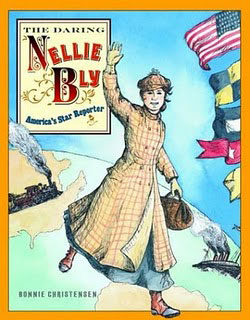 Au moment où son exploit l’amène sous la lumière des projecteurs, Nellie Bly a réussi quelques coups spectaculaires qui lui valent déjà une solide réputation parmi ses confrères. Le premier article qu’elle doit écrire pour le « New York World », journal appartenant à Joseph Pulitzer, a pour thème « la vie quotidienne dans un asile de fous réservé aux femmes ». Histoire de recueillir des informations directement à la source et non dans les bibliothèques comme le font nombre de ses confrères, la jeune journaliste décide de simuler une maladie mentale. Elle est internée pendant quelques temps au Blackwells Island Hospital, et peut ainsi témoigner, avec beaucoup de sincérité, des conditions de vie épouvantable des femmes qui sont enfermées dans ce lieu maudit. Son article provoque pas mal de remous et a sans doute comme conséquence directe le fait d’entrainer une sérieuse rénovation de l’institution et de ses pratiques cruelles. Elle aura recours à plusieurs reprises à ce procédé d’immersion pour rédiger ses reportages et cette façon de procéder, mise en valeur par un « talent de plume » indéniable va contribuer à faire d’elle une journaliste renommée. Sa destinée va être brillante, ce qui ne l’empêchera pas de continuer à s’intéresser au sort réservé aux plus humbles, plus particulièrement aux femmes qui luttent pour obtenir l’égalité des droits avec les hommes. La célébrité et la richesse ne l’empêchent pas de conserver une vision profondément sociale du monde. Ce qu’elle croyait à ses débuts, elle n’y a pas renoncé et va rester toute sa vie sur la même trajectoire idéologique, fait suffisamment rare pour être mentionné, la notoriété ayant tendance parfois à faire tourner la tête en direction des nuages.
Au moment où son exploit l’amène sous la lumière des projecteurs, Nellie Bly a réussi quelques coups spectaculaires qui lui valent déjà une solide réputation parmi ses confrères. Le premier article qu’elle doit écrire pour le « New York World », journal appartenant à Joseph Pulitzer, a pour thème « la vie quotidienne dans un asile de fous réservé aux femmes ». Histoire de recueillir des informations directement à la source et non dans les bibliothèques comme le font nombre de ses confrères, la jeune journaliste décide de simuler une maladie mentale. Elle est internée pendant quelques temps au Blackwells Island Hospital, et peut ainsi témoigner, avec beaucoup de sincérité, des conditions de vie épouvantable des femmes qui sont enfermées dans ce lieu maudit. Son article provoque pas mal de remous et a sans doute comme conséquence directe le fait d’entrainer une sérieuse rénovation de l’institution et de ses pratiques cruelles. Elle aura recours à plusieurs reprises à ce procédé d’immersion pour rédiger ses reportages et cette façon de procéder, mise en valeur par un « talent de plume » indéniable va contribuer à faire d’elle une journaliste renommée. Sa destinée va être brillante, ce qui ne l’empêchera pas de continuer à s’intéresser au sort réservé aux plus humbles, plus particulièrement aux femmes qui luttent pour obtenir l’égalité des droits avec les hommes. La célébrité et la richesse ne l’empêchent pas de conserver une vision profondément sociale du monde. Ce qu’elle croyait à ses débuts, elle n’y a pas renoncé et va rester toute sa vie sur la même trajectoire idéologique, fait suffisamment rare pour être mentionné, la notoriété ayant tendance parfois à faire tourner la tête en direction des nuages.
 Elisabeth Jane Cochran (Nellie Bly est le pseudonyme qu’elle utilisera pour signer ses articles) est née en Pennsylvanie le 5 mai 1864. Peu d’informations sont connues sur le début de sa vie. On sait par contre comment a débuté sa carrière de journaliste, puisqu’il s’agit d’un épisode plutôt original. Le journal local, le « Pittsburgh Dispatch » publie une chronique dont elle estime le contenu violemment sexiste. La jeune femme réagit vigoureusement à cet article en envoyant une lettre incendiaire au rédacteur en chef. Celui-ci apprécie le ton qu’emploie la jeune femme et surtout la haute tenue littéraire de sa missive. Il lui propose donc de collaborer régulièrement au journal, et lui offre ainsi une occasion de faire valoir son point de vue sur différents sujets d’actualité. Les articles de la nouvelle rédactrice (qui signe Nellie Bly, en faisant allusion à l’héroïne d’une chanson populaire du moment), ne laissent personne indifférent. La façon dont elle décrit les conditions de vie des ouvrières et des ouvriers de la région, l’ardeur de ses convictions féministes et surtout ses prises de positions enflammées lors des conflits sociaux, provoquent la colère des industriels locaux. Face à la levée de boucliers, et surtout au retrait des annonces payantes qui menacent la survie même du journal, le rédacteur en chef du « Pittsburgh Dispatch » propose à Nellie Bly de traiter de sujets plus consensuels, et, en fait, plus féminins. Voilà notre journaliste « sociale », reléguée aux pages maisons, cuisine et mode… ce qui ne lui convient guère ! Elle démissionne rapidement et part pour le Mexique, dans l’intention d’écrire des reportages sur la pauvreté des habitants et sur la corruption qui règne à tous les niveaux de l’administration. Cette fois-ci, c’est le gouvernement mexicain qui n’apprécie pas la teneur de ses textes et il lui est très vite signifié qu’elle est « persona non grata » dans le pays. Il n’est pas question pour elle de quémander quoi que ce soit en retournant à Pittsburgh. L’ambition ne lui manque pas, ni la détermination, et elle décide de s’installer à New York et de devenir journaliste au « New York World », dont elle apprécie le ton et l’indépendance relative des articles. Sa réussite est loin d’être assurée car le milieu journalistique est alors essentiellement masculin et il n’est pas évident pour une femme de percer dans la profession. Le reportage qu’elle écrit à ce moment là sur l’asile pour les femmes lui ouvre les portes du journal.
Elisabeth Jane Cochran (Nellie Bly est le pseudonyme qu’elle utilisera pour signer ses articles) est née en Pennsylvanie le 5 mai 1864. Peu d’informations sont connues sur le début de sa vie. On sait par contre comment a débuté sa carrière de journaliste, puisqu’il s’agit d’un épisode plutôt original. Le journal local, le « Pittsburgh Dispatch » publie une chronique dont elle estime le contenu violemment sexiste. La jeune femme réagit vigoureusement à cet article en envoyant une lettre incendiaire au rédacteur en chef. Celui-ci apprécie le ton qu’emploie la jeune femme et surtout la haute tenue littéraire de sa missive. Il lui propose donc de collaborer régulièrement au journal, et lui offre ainsi une occasion de faire valoir son point de vue sur différents sujets d’actualité. Les articles de la nouvelle rédactrice (qui signe Nellie Bly, en faisant allusion à l’héroïne d’une chanson populaire du moment), ne laissent personne indifférent. La façon dont elle décrit les conditions de vie des ouvrières et des ouvriers de la région, l’ardeur de ses convictions féministes et surtout ses prises de positions enflammées lors des conflits sociaux, provoquent la colère des industriels locaux. Face à la levée de boucliers, et surtout au retrait des annonces payantes qui menacent la survie même du journal, le rédacteur en chef du « Pittsburgh Dispatch » propose à Nellie Bly de traiter de sujets plus consensuels, et, en fait, plus féminins. Voilà notre journaliste « sociale », reléguée aux pages maisons, cuisine et mode… ce qui ne lui convient guère ! Elle démissionne rapidement et part pour le Mexique, dans l’intention d’écrire des reportages sur la pauvreté des habitants et sur la corruption qui règne à tous les niveaux de l’administration. Cette fois-ci, c’est le gouvernement mexicain qui n’apprécie pas la teneur de ses textes et il lui est très vite signifié qu’elle est « persona non grata » dans le pays. Il n’est pas question pour elle de quémander quoi que ce soit en retournant à Pittsburgh. L’ambition ne lui manque pas, ni la détermination, et elle décide de s’installer à New York et de devenir journaliste au « New York World », dont elle apprécie le ton et l’indépendance relative des articles. Sa réussite est loin d’être assurée car le milieu journalistique est alors essentiellement masculin et il n’est pas évident pour une femme de percer dans la profession. Le reportage qu’elle écrit à ce moment là sur l’asile pour les femmes lui ouvre les portes du journal.
 Le fait d’être devenue, quelques années plus tard, la « Phileas Fog » féminine, va influer sur le cours de sa vie, mais non sur ses idées, ainsi que je l’ai indiqué auparavant. En 1895 elle fait la connaissance d’un riche industriel, Robert Seaman, et devient son épouse. Elle renonce temporairement au journalisme pour se consacrer à sa nouvelle vie. Le mariage ne dure que neuf ans et, suite au décès de son compagnon, en 1904, elle se retrouve à la tête de son entreprise métallurgique et de sa fortune. Elle fait alors des choix de gestion plutôt singuliers pour la veuve d’un capitaine d’industrie, mais guère surprenants lorsque l’on sait à quel personnage on a affaire précisément. Nellie Bly décide de réformer fondamentalement le fonctionnement de son usine de fabrication de tôles. Elle supprime la rémunération à la pièce et introduit un salaire journalier indépendant de la productivité, et elle dépense une bonne part de ses capitaux pour réaliser des investissements sociaux dans l’entreprise : centre de loisirs, bibliothèque, club de pêche… Toutes ces « loufoqueries » sociales ne sont guère appréciées par ses pairs. La nouvelle patronne n’est pas une très bonne gestionnaire et la situation financière de l’usine devient catastrophique. Pour échapper aux pressions de ses créanciers, Nellie Bly quitte les Etats-Unis et se réfugie en Grande Bretagne. Elle décide de se consacrer à ce qui l’a fait vivre avant son mariage et qui est sa véritable passion : le journalisme. Nous sommes en 1914 et le monde est sur le point de basculer dans le chaos. Lorsque le conflit éclate, Nellie Bly devient correspondante de guerre. Jusqu’en 1919, elle se rend sur de nombreux fronts et publie une longue série de reportages sur la vie des soldats et l’évolution du conflit. La première guerre mondiale terminée, elle décide de tourner la page et de rentrer à New York. Elle devient collaboratrice au « New York Evening Journal » et consacre la quasi totalité de ses chroniques aux enfants abandonnés de la grande métropole. Elle meurt le 27 janvier 1922 des suites d’une pneumonie.
Le fait d’être devenue, quelques années plus tard, la « Phileas Fog » féminine, va influer sur le cours de sa vie, mais non sur ses idées, ainsi que je l’ai indiqué auparavant. En 1895 elle fait la connaissance d’un riche industriel, Robert Seaman, et devient son épouse. Elle renonce temporairement au journalisme pour se consacrer à sa nouvelle vie. Le mariage ne dure que neuf ans et, suite au décès de son compagnon, en 1904, elle se retrouve à la tête de son entreprise métallurgique et de sa fortune. Elle fait alors des choix de gestion plutôt singuliers pour la veuve d’un capitaine d’industrie, mais guère surprenants lorsque l’on sait à quel personnage on a affaire précisément. Nellie Bly décide de réformer fondamentalement le fonctionnement de son usine de fabrication de tôles. Elle supprime la rémunération à la pièce et introduit un salaire journalier indépendant de la productivité, et elle dépense une bonne part de ses capitaux pour réaliser des investissements sociaux dans l’entreprise : centre de loisirs, bibliothèque, club de pêche… Toutes ces « loufoqueries » sociales ne sont guère appréciées par ses pairs. La nouvelle patronne n’est pas une très bonne gestionnaire et la situation financière de l’usine devient catastrophique. Pour échapper aux pressions de ses créanciers, Nellie Bly quitte les Etats-Unis et se réfugie en Grande Bretagne. Elle décide de se consacrer à ce qui l’a fait vivre avant son mariage et qui est sa véritable passion : le journalisme. Nous sommes en 1914 et le monde est sur le point de basculer dans le chaos. Lorsque le conflit éclate, Nellie Bly devient correspondante de guerre. Jusqu’en 1919, elle se rend sur de nombreux fronts et publie une longue série de reportages sur la vie des soldats et l’évolution du conflit. La première guerre mondiale terminée, elle décide de tourner la page et de rentrer à New York. Elle devient collaboratrice au « New York Evening Journal » et consacre la quasi totalité de ses chroniques aux enfants abandonnés de la grande métropole. Elle meurt le 27 janvier 1922 des suites d’une pneumonie.
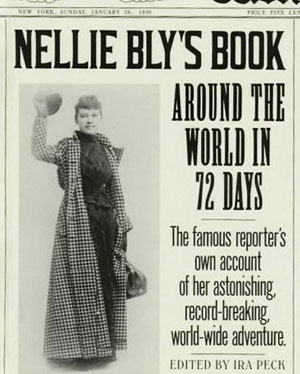 Figure marquante du féminisme américain, Nellie Bly est considérée, de nos jours, comme l’une des pionnières du journalisme d’investigation, n’hésitant pas à s’immerger dans la réalité sociale pour mieux en témoigner, ne reculant devant aucune prise de risque. Elle incarne une certaine image de la déontologie professionnelle que bien de ses confrères ou consœurs actuelles se devraient d’imiter quelque peu. Bien qu’elle n’ait jamais milité pour une idéologie politique particulière et n’ait jamais été membre d’aucun parti ou d’aucune organisation ouvrière, Nellie Bly a su montrer, tout au long de sa carrière, qu’elle était attachée à un idéal de justice et d’égalité, et qu’elle ne supportait pas la morgue des riches possédants et des hommes de pouvoir à leur solde. Elle a combattu l’oppression des femmes et des pauvres gens dans leur ensemble, avec les armes qui étaient les siennes : la plume, l’amour de la vérité et un courage indéniable dont elle a fait montre à de nombreuses occasions. A une époque où l’on voit certains journalistes de la presse écrite ou télévisée devenir de simples courroies de transmission du pouvoir, se contentant de recopier et/ou de répéter à n’en plus finir le contenu des dépêches d’agence, son histoire méritait d’être contée.
Figure marquante du féminisme américain, Nellie Bly est considérée, de nos jours, comme l’une des pionnières du journalisme d’investigation, n’hésitant pas à s’immerger dans la réalité sociale pour mieux en témoigner, ne reculant devant aucune prise de risque. Elle incarne une certaine image de la déontologie professionnelle que bien de ses confrères ou consœurs actuelles se devraient d’imiter quelque peu. Bien qu’elle n’ait jamais milité pour une idéologie politique particulière et n’ait jamais été membre d’aucun parti ou d’aucune organisation ouvrière, Nellie Bly a su montrer, tout au long de sa carrière, qu’elle était attachée à un idéal de justice et d’égalité, et qu’elle ne supportait pas la morgue des riches possédants et des hommes de pouvoir à leur solde. Elle a combattu l’oppression des femmes et des pauvres gens dans leur ensemble, avec les armes qui étaient les siennes : la plume, l’amour de la vérité et un courage indéniable dont elle a fait montre à de nombreuses occasions. A une époque où l’on voit certains journalistes de la presse écrite ou télévisée devenir de simples courroies de transmission du pouvoir, se contentant de recopier et/ou de répéter à n’en plus finir le contenu des dépêches d’agence, son histoire méritait d’être contée.
9juillet2010
Posté par Paul dans la catégorie : Humeur du jour; Vive la Politique.
 Histoire de faire habilement le lien avec la chronique précédente, nous allons continuer à jouer un peu avec les nombres… ce qui n’empêche pas de faire de la poésie – j’espère que vous avez apprécié la richesse de la rime qui embellit le titre de ce billet – et d’encenser une fois de plus notre grandeur nationale. Les données « numériques » de cette chronique sont basées en grande partie sur les informations fournies par le SIPRI (Institut International de Recherches pour la Paix de Stockholm). Elles figurent dans le rapport sur les dépenses militaires mondiales publié en juin 2010, et concernent les budgets alloués en 2009. Il ne s’agit, bien entendu, que des dépenses « officielles » ; les crédits alloués par des biais divers (recherche « civile » intéressant directement les militaires par exemple) ne peuvent être évalués précisément. Bon… Ça c’était l’entrée en matière, histoire de montrer à quel point nous allons parler de choses sérieuses tout autant que kaki… Revenons donc à nos treillis froufroutants et aux Big Jim et supers Lolitas qui se pavanent avec. Pour faire plaisir à ces dames et à ces messieurs, notre planète bleue (qu’il faudra sans doute envisager de rebaptiser un jour planète rouge sang) a dépensé en 2009 la coquette somme de 1531 milliards de dollars. Cette enveloppe matelassée a augmenté de 49 % en dix ans. Il est fort probable que sur 2010, 2011, Messieurs les Militaires ne seront pas trop en peine non plus puisque, malgré la « crise » qui affecte essentiellement les budgets sociaux, les dépenses en lance-pierres, catapultes, pistolets à eau et missiles à la chantilly, continuent (et continueront sans doute) à grimper allègrement. Différents médias ont bien entendu commenté ce rapport du Sipri, avec le ton qui correspond généralement avec le style maison . Parmi les analyses que j’ai pu lire, cette citation d’un article du journal « Le Monde » que je vous laisse le soin d’apprécier : « Une partie des dépenses militaires 2009 sont liées aux « opérations de maintien de la paix« , notamment en Afghanistan. […] Au total, cinquante-quatre de ces opérations de maintien de la paix se sont déroulées dans le monde au cours de l’année passée pour « un coût connu » et jamais atteint jusque-là de 9,1 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros). » Si j’étais rédacteur de l’article, j’aurais sans doute ajouté « salauds de pacifistes ! »… Rien ne coûte aussi cher que le « maintien de la paix » confié aux militaires en tout cas !
Histoire de faire habilement le lien avec la chronique précédente, nous allons continuer à jouer un peu avec les nombres… ce qui n’empêche pas de faire de la poésie – j’espère que vous avez apprécié la richesse de la rime qui embellit le titre de ce billet – et d’encenser une fois de plus notre grandeur nationale. Les données « numériques » de cette chronique sont basées en grande partie sur les informations fournies par le SIPRI (Institut International de Recherches pour la Paix de Stockholm). Elles figurent dans le rapport sur les dépenses militaires mondiales publié en juin 2010, et concernent les budgets alloués en 2009. Il ne s’agit, bien entendu, que des dépenses « officielles » ; les crédits alloués par des biais divers (recherche « civile » intéressant directement les militaires par exemple) ne peuvent être évalués précisément. Bon… Ça c’était l’entrée en matière, histoire de montrer à quel point nous allons parler de choses sérieuses tout autant que kaki… Revenons donc à nos treillis froufroutants et aux Big Jim et supers Lolitas qui se pavanent avec. Pour faire plaisir à ces dames et à ces messieurs, notre planète bleue (qu’il faudra sans doute envisager de rebaptiser un jour planète rouge sang) a dépensé en 2009 la coquette somme de 1531 milliards de dollars. Cette enveloppe matelassée a augmenté de 49 % en dix ans. Il est fort probable que sur 2010, 2011, Messieurs les Militaires ne seront pas trop en peine non plus puisque, malgré la « crise » qui affecte essentiellement les budgets sociaux, les dépenses en lance-pierres, catapultes, pistolets à eau et missiles à la chantilly, continuent (et continueront sans doute) à grimper allègrement. Différents médias ont bien entendu commenté ce rapport du Sipri, avec le ton qui correspond généralement avec le style maison . Parmi les analyses que j’ai pu lire, cette citation d’un article du journal « Le Monde » que je vous laisse le soin d’apprécier : « Une partie des dépenses militaires 2009 sont liées aux « opérations de maintien de la paix« , notamment en Afghanistan. […] Au total, cinquante-quatre de ces opérations de maintien de la paix se sont déroulées dans le monde au cours de l’année passée pour « un coût connu » et jamais atteint jusque-là de 9,1 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros). » Si j’étais rédacteur de l’article, j’aurais sans doute ajouté « salauds de pacifistes ! »… Rien ne coûte aussi cher que le « maintien de la paix » confié aux militaires en tout cas !
Le raisonnement sur les grands nombres que je tenais il y a quelques jours est encore pleinement illustré par l’exemple donné dans le premier paragraphe. 182 euro, tout le monde voit à peu près ce que ça représente… 1 244 000 000 000 euro… personne et tant mieux : ça aide nos mauvaises consciences à mieux dormir la nuit. Ce qui est sûr c’est qu’avec 182 euro, au supermarché du coin, on n’achète pas une arme bien terrible : même un arc et des flèches de qualité c’est nettement plus cher que ça ; quant à une hache de pierre, pour peu qu’il s’agisse d’un objet authentique ayant appartenu à un illustre guerrier sioux, ce n’est même pas la peine d’y songer. Ce qui est tout autant certain c’est qu’avec la somme globale, bon nombre de problèmes humanitaires seraient réglés moyennant quelques réorientations budgétaires bénignes. On pourrait sans problème donner un toit, une nourriture convenable et de l’eau potable à la totalité des habitants de la planète, surtout si l’on ponctionnait en outre quelques unes de ces fortunes honteuses dont on énonce fièrement les montants dans les médias ces derniers temps. Rien que pour la France, troisième pays au monde pour ses dépenses (en pourcentage par rapport aux dépenses totales), on atteint la somme rondelette de 50 milliards d’euro (toujours en 2009). Nous faisons donc de gros efforts pour équiper, salarier et pensionner nos braves pioupious. Je vous rappelle en effet que la somme mentionnée dans le titre, 182 euro, est une moyenne internationale et que nous autres, dans l’hexagone, nous situons bien en dessus de cette somme dérisoire. Si ma calculette ne se trompe pas (avec tous ces zéros) ça devrait tourner plutôt autour de 770 euro par tête.
 Le contexte économique soi-disant « difficile » pourrait laisser penser que l’on va ponctionner un pourcentage conséquent de ces dépenses d’une utilité « discutable ». Eh bien non ! Si l’on prend l’exemple du mouton noir du troupeau européen, la Grèce, l’austérité va frapper tous les secteurs autres que l’armée. Les « amis » européens et autres usuriers du FMI ont quelque peu trainé la jambe avant de prêter aux Hellènes endettés, sous réserve que le gouvernement d’Athènes procède à des coupes sombres dans tous les budgets sociaux. Seul le budget militaire a échappé aux ciseaux des commissaires européens. Il faut dire que ces dépensiers de Grecs ont le bon goût d’investir leurs euro dans du solide matériel kaki fabriqué dans les usines françaises et allemandes notamment. Il est tout à fait logique que l’on prête de l’argent à un taux raisonnable à des gens qui s’apprêtent à le dépenser chez vous. On appelle ça « solidarité capitaliste » !
Le contexte économique soi-disant « difficile » pourrait laisser penser que l’on va ponctionner un pourcentage conséquent de ces dépenses d’une utilité « discutable ». Eh bien non ! Si l’on prend l’exemple du mouton noir du troupeau européen, la Grèce, l’austérité va frapper tous les secteurs autres que l’armée. Les « amis » européens et autres usuriers du FMI ont quelque peu trainé la jambe avant de prêter aux Hellènes endettés, sous réserve que le gouvernement d’Athènes procède à des coupes sombres dans tous les budgets sociaux. Seul le budget militaire a échappé aux ciseaux des commissaires européens. Il faut dire que ces dépensiers de Grecs ont le bon goût d’investir leurs euro dans du solide matériel kaki fabriqué dans les usines françaises et allemandes notamment. Il est tout à fait logique que l’on prête de l’argent à un taux raisonnable à des gens qui s’apprêtent à le dépenser chez vous. On appelle ça « solidarité capitaliste » !
Continuons à jouer avec la guerre, l’argent et les mathématiques. Avec 172 euro (217 dollars US) on ne fait rien de vraiment utile comme investissement (j’entends par « utile », un investissement permettant de liquider proprement son voisin dans le cadre légal d’un assassinat collectif programmé que l’on nomme pudiquement « conflit »). Enfin, ça dépend où on habite car, selon les régions du monde, le prix des armes est extrêmement variable. Selon un rapport de l’ONU (un peu défraichi puisqu’il date de 2001), il y a des pays où l’on peut se procurer un fusil d’assaut AK-47 pour le prix d’un sac de maïs, c’est à dire pour une vingtaine ou une trentaine de dollars. Il ne s’agit pas forcément d’une arme neuve, de première main, mais, rien de grave, ça fonctionne comme il faut, largement assez en tout cas pour flinguer un gosse en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Ces armes « légères » constituent du coup un véritable fléau. On vend quelques sacs de cocaïne et on achète deux ou trois containers de flingues et de munitions. On est alors fin prêt à dégommer le crétin du village d’à côté qui a le culot d’avoir une religion différente, ou bien de semer les haricots en poquets plutôt qu’en lignes régulières. Selon le rapport Onusien mentionné plus haut « Plus de 500 millions d’armes légères sont en circulation dans le monde, soit environ une pour 12 personnes. Elles ont été l’arme de prédilection dans 46 des 49 grands conflits que la planète a connus depuis 1990 et ont causé la mort de 4 millions de personnes, dont 90 % de civils et 80 % de femmes et d’enfants. » Vous voyez que ce n’est quand même pas mal ! Là où je ne suivrai pas ce rapport par contre, c’est lorsqu’il se contente de dénoncer le trafic illégal de ces armes légères, sans piper mot concernant les profits gigantesques que dégage ce secteur commercial au niveau planétaire. Au risque de faire de la peine à Mr Kofi Anan, je ne pense pas que les deux millions d’enfants qui ont été tués au cours de ces dix dernières années (de 1990 à 2000 mais rassurez-vous, depuis, c’est mieux) fassent vraiment la différence entre balles « légales » et « illégales ». Il faudra bien un jour que le discours humanitaire aille jusqu’au bout de sa logique.
 Si vous disposez de moyens plus conséquents vous pourrez toujours faire mieux que d’acheter des AK 47 de contrebande. L’union fait la force et il y a plus sérieux comme matériel, sur le marché. Il vous faudra dans ce cas grouper vos économies dans le cadre d’une petite coopérative d’entrepreneurs, genre République bananière, ou convaincre votre opinion publique que de dangereuses menaces terroristes ou d’infâmes velléités agressives du pays voisin justifient que l’on ponctionne les budgets sociaux pour élever la nation au rang de « puissance militaire qui compte » au bal des arrogances. Si les frictions frontalières diminuaient entre les Turcs et les Grecs, je suis sûr que les gouvernements des deux pays auraient du mal à faire passer la pilule amère qu’ils ont habitué leurs citoyens à avaler. Ce n’est pas pour rien que les grands groupes industriels du secteur de l’armement s’intéressent depuis des lustres aux médias en tout genre. Lorsqu’on a un ou deux journaux, une chaine de télé et quelques radios à ses ordres, on a à peine besoin de colonels et de chars d’assauts pour convaincre la population du bien fondé d’investissements exorbitants dans du matériel foireux qui sera obsolète au bout de quatre ou cinq ans. Autrefois, cela se faisait de manière discrète, maintenant on n’a plus aucune honte à afficher un quelconque « Matra-Hachette » et autre « groupe Lagardère ». De plus, le secteur est créateur d’emplois : nos amis suisses n’ont pas manqué de se le voir rappeler par la propagande officielle lors d’un récent référendum. Rien de tel que la main de l’homme pour assembler avec amour la baïonnette qui va permettre de pourfendre l’abdomen de l’ennemi héréditaire.
Si vous disposez de moyens plus conséquents vous pourrez toujours faire mieux que d’acheter des AK 47 de contrebande. L’union fait la force et il y a plus sérieux comme matériel, sur le marché. Il vous faudra dans ce cas grouper vos économies dans le cadre d’une petite coopérative d’entrepreneurs, genre République bananière, ou convaincre votre opinion publique que de dangereuses menaces terroristes ou d’infâmes velléités agressives du pays voisin justifient que l’on ponctionne les budgets sociaux pour élever la nation au rang de « puissance militaire qui compte » au bal des arrogances. Si les frictions frontalières diminuaient entre les Turcs et les Grecs, je suis sûr que les gouvernements des deux pays auraient du mal à faire passer la pilule amère qu’ils ont habitué leurs citoyens à avaler. Ce n’est pas pour rien que les grands groupes industriels du secteur de l’armement s’intéressent depuis des lustres aux médias en tout genre. Lorsqu’on a un ou deux journaux, une chaine de télé et quelques radios à ses ordres, on a à peine besoin de colonels et de chars d’assauts pour convaincre la population du bien fondé d’investissements exorbitants dans du matériel foireux qui sera obsolète au bout de quatre ou cinq ans. Autrefois, cela se faisait de manière discrète, maintenant on n’a plus aucune honte à afficher un quelconque « Matra-Hachette » et autre « groupe Lagardère ». De plus, le secteur est créateur d’emplois : nos amis suisses n’ont pas manqué de se le voir rappeler par la propagande officielle lors d’un récent référendum. Rien de tel que la main de l’homme pour assembler avec amour la baïonnette qui va permettre de pourfendre l’abdomen de l’ennemi héréditaire.
Désolé de rabâcher un peu sur ce thème, mais je vous avais déjà fait grâce d’une relative amnésie au moment d’Eurosatory, vous n’imaginiez quand même pas que cela allait durer jusqu’au moment où nos braves parlementaires vont débattre des restrictions budgétaires pour 2011 et 2012. Je ne voudrais pas que notre armée soit obligée de licencier du personnel ou d’avancer l’âge du départ en retraite de ses meilleurs éléments. Nous nous devons d’être prêts, le jour où les Afghans et les Nigériens, manipulés par les Chinois, tenteront de prendre à revers notre base de Djibouti en débarquant en Provence sur une plage bondée de touristes en maillot de bain. Le carnage serait alors insupportable à mes yeux délicats. Je me demande même si je ne vais pas pousser le patriotisme jusqu’à demander qu’une partie de mes impôts qui se perdent dans le bourbier immoral des crédits Education Nationale, ne soient affectés à la Défense… Je suis sûr qu’il y a un trou quelque part dans notre ligne de surveillance radar… Pour acheter un char Leclerc à 6,8 millions d’euro, il suffit qu’un nombre raisonnable de citoyens « bien de chez nous » se déleste d’une pièce d’un ou deux euro et le compte y sera ! C’est beau les mathématiques non ? Vous voyez que les grands nombres… on peut faire des efforts pour les apprivoiser !

5juillet2010
Posté par Paul dans la catégorie : philosophie à deux balles.
 Je me mets à la place du premier bûcheron qui a contemplé les forêts du Canada : des arbres à perte de vue, une marée de verdure qui fuit vers l’horizon, disparait derrière une colline pour mieux surgir au faîte de la suivante. Comment aurait-il pu imaginer, ce brave colon, que la saignée à blanc qu’il allait opérer, laborieusement, à l’aide de sa cognée, viendrait à bout d’une immensité pareille ? Même si on l’avait informé qu’il n’était que le premier et que des milliers d’autres viendraient à sa suite, munis d’outils de plus en plus perfectionnés. Difficulté pour l’esprit humain d’apprécier une grandeur à partir du moment où elle excède un seuil (sans doute variable d’un individu à l’autre). Les avancées technologiques ne sont pas seules responsables d’un tel massacre organisé. Derrière la machine, il y a un cerveau (plus ou moins autonome) qui commande ou bien exécute les ordres que d’autres cerveaux, tout aussi humains, lui ont intimés. Couper la totalité ou presque de la forêt primaire du Canada ! Vous auriez raconté ça à un trappeur, il y a quelques siècles, il vous aurait ri au nez ! Je parle des arbres, mais je pourrais évoquer aussi les saumons dans les grands lacs à la frontière des USA (on s’en servait pour fertiliser les champs, tant il y en avait) ou les troupeaux de bisons que l’on massacrait à la mitrailleuse puis que l’on laissait pourrir sur place…
Je me mets à la place du premier bûcheron qui a contemplé les forêts du Canada : des arbres à perte de vue, une marée de verdure qui fuit vers l’horizon, disparait derrière une colline pour mieux surgir au faîte de la suivante. Comment aurait-il pu imaginer, ce brave colon, que la saignée à blanc qu’il allait opérer, laborieusement, à l’aide de sa cognée, viendrait à bout d’une immensité pareille ? Même si on l’avait informé qu’il n’était que le premier et que des milliers d’autres viendraient à sa suite, munis d’outils de plus en plus perfectionnés. Difficulté pour l’esprit humain d’apprécier une grandeur à partir du moment où elle excède un seuil (sans doute variable d’un individu à l’autre). Les avancées technologiques ne sont pas seules responsables d’un tel massacre organisé. Derrière la machine, il y a un cerveau (plus ou moins autonome) qui commande ou bien exécute les ordres que d’autres cerveaux, tout aussi humains, lui ont intimés. Couper la totalité ou presque de la forêt primaire du Canada ! Vous auriez raconté ça à un trappeur, il y a quelques siècles, il vous aurait ri au nez ! Je parle des arbres, mais je pourrais évoquer aussi les saumons dans les grands lacs à la frontière des USA (on s’en servait pour fertiliser les champs, tant il y en avait) ou les troupeaux de bisons que l’on massacrait à la mitrailleuse puis que l’on laissait pourrir sur place…
Comment imaginer qu’un seul sac en plastique, un unique et misérable petit détritus, jeté au milieu des vagues de l’océan, arriverait un jour à constituer un ilot considérable, une pollution détestable et mortelle pour la faune marine… Incapacité, pour l’esprit humain, de raisonner au-delà d’une certaine échelle, plus que volonté de nuisance…
Cette impossibilité d’évaluer les conséquences d’un acte, à partir du moment où il est reproduit un grand nombre de fois, permet à tout un chacun de minimiser l’impact de ses propres pratiques : incapacité de passer de l’individuel au collectif, des conséquences jugées bénignes de l’acte individuel aux effets catastrophiques du même acte multiplié à l’infini. Il ne s’agit pas forcément d’une attitude égocentrique (ou anthropocentrique diraient certains) forcenée, mais du manque de capacité du cerveau humain à appréhender les grands nombres.
 Le problème est le même, que ce soit la distance de la Terre aux plus proches planètes habitables ou la longueur du voyage qu’il faudrait faire dans le temps pour rencontrer d’aimables dinosaures ou les ancêtres de nos végétaux actuels. Cette difficulté à appréhender l’immensité des distances spatiales ou temporelles est tout à fait palpable chez les enfants : leurs grands parents auraient très bien pu vivre à l’époque des Gaulois, et les Celtes chasser les brontosaures. Lorsqu’on a l’occasion d’aborder quelques notions de ce genre, un peu complexes, avec eux, on se rend vite compte du problème : invention de la voiture, châteaux forts et druides se situent grosso modo dans la même zone temporelle, c’est à dire « avant ». Il y a aussi un « avant-avant » dans lequel la majorité d’entre-eux situent l’homme des cavernes et les dinosaures, point final. Le déroulement de l’histoire humaine se limite à trois ou quatre grandes périodes et c’est tout. Lorsqu’on demande à un enfant de huit ou dix ans si la voiture existait du temps de Louis XIV, il marque toujours un temps d’hésitation avant de répondre. Il en est de même pour les distances. Leur appréciation se limite bien souvent à : ici, un peu plus loin, très loin, très très loin. « Jeudi, je suis allé voir mémé, on est resté au moins une heure dans la voiture ; elle habite très loin. » « Plus loin encore il y a Paris et l’Amérique, et très très loin il y a les planètes ».
Le problème est le même, que ce soit la distance de la Terre aux plus proches planètes habitables ou la longueur du voyage qu’il faudrait faire dans le temps pour rencontrer d’aimables dinosaures ou les ancêtres de nos végétaux actuels. Cette difficulté à appréhender l’immensité des distances spatiales ou temporelles est tout à fait palpable chez les enfants : leurs grands parents auraient très bien pu vivre à l’époque des Gaulois, et les Celtes chasser les brontosaures. Lorsqu’on a l’occasion d’aborder quelques notions de ce genre, un peu complexes, avec eux, on se rend vite compte du problème : invention de la voiture, châteaux forts et druides se situent grosso modo dans la même zone temporelle, c’est à dire « avant ». Il y a aussi un « avant-avant » dans lequel la majorité d’entre-eux situent l’homme des cavernes et les dinosaures, point final. Le déroulement de l’histoire humaine se limite à trois ou quatre grandes périodes et c’est tout. Lorsqu’on demande à un enfant de huit ou dix ans si la voiture existait du temps de Louis XIV, il marque toujours un temps d’hésitation avant de répondre. Il en est de même pour les distances. Leur appréciation se limite bien souvent à : ici, un peu plus loin, très loin, très très loin. « Jeudi, je suis allé voir mémé, on est resté au moins une heure dans la voiture ; elle habite très loin. » « Plus loin encore il y a Paris et l’Amérique, et très très loin il y a les planètes ».
Du côté des adultes, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’appréciation des distances et des durées n’est guère plus rigoureuse. Dans le meilleur des cas, seule la succession chronologique est en place, pas l’échelle des temps. Le deuxième conflit mondial a duré moins d’une dizaine d’années ; le Moyen-Âge s’étale sur un millénaire. Le nombre d’événements que l’on a mémorisé pour ces deux périodes est à peu près le même. On va parler dans les livres d’histoire de la vie des paysans à l’époque médiévale : on balaie ainsi d’un geste large la succession d’une cinquantaine de générations.
Du coup, il n’y a pas lieu d’être surpris par les réactions individuelles aux problèmes de pollution. Un terrrien se déleste d’un kilo de déchets ; lorsque ses six milliards de concitoyens ont fait la même chose, on se retrouve avec un tas de six millions de tonnes d’ordures à gérer. A part les photos plutôt suggestives des rues de nos villes quand il y a grève des éboueurs, vous arrivez à vous représenter un amoncellement pareil ?
 A une certaine époque, avec un copain, on s’amusait à délirer sur les mécanismes de base du capitalisme. On se projetait fabricants des célèbres goûters biscuités au chocolat (dont je ne citerai pas le nom), en Chine comme il se doit. Le raisonnement était simple : on a le gouvernement dans la poche ; chaque citoyen de ce pays est obligé de consommer au moins un gâteau à son petit déjeuner. On inscrit ça dans le petit livre rouge du parti. Imaginons qu’on fasse 1 centime de bénéfice par pâtisserie avalée… Eh bien le total grimpe à un milliard de centimes de bénéf tous les matins (ça se passe à une époque où les Chinois étaient un peu moins nombreux que maintenant)… Vu que les prix des denrées de première nécessité se sont envolés, ça pourrait donner facilement dix millions d’euro dans le tiroir caisse. On n’était pas les seuls à délirer puisque, à peu près à la même époque, dans les débuts de l’informatique à gogo, un employé de banque s’était amusé à un jeu identique. Il s’agissait simplement d’arrondir les soldes des opérations bancaires (ces millièmes ou dix millièmes de dollars ou de francs – la troisième ou la quatrième décimale). Les excédents étaient virés sur un compte fictif qui capitalisait ainsi une somme largement impressionnante. Certes, me direz-vous, notre affaire de biscuits chocolatés c’était une approche de l’économie un peu simpliste et un résultat financier soumis à un contexte bien particulier… Cela avait au moins le mérite d’offrir une représentation des quantités à peu près gérable.. Quoique… Dix millions d’euro de bénéfice, je ne vois pas trop quoi faire avec, comme ça, au débotté (laissez-moi quelques jours de réflexion avant de m’adresser un chèque !). Vous ne vous êtes jamais imaginé que si une centaine de vos copains vous adressaient un chèque de 30 euro tous les mois vous n’auriez plus besoin d’aller « bêtement » travailler ???
A une certaine époque, avec un copain, on s’amusait à délirer sur les mécanismes de base du capitalisme. On se projetait fabricants des célèbres goûters biscuités au chocolat (dont je ne citerai pas le nom), en Chine comme il se doit. Le raisonnement était simple : on a le gouvernement dans la poche ; chaque citoyen de ce pays est obligé de consommer au moins un gâteau à son petit déjeuner. On inscrit ça dans le petit livre rouge du parti. Imaginons qu’on fasse 1 centime de bénéfice par pâtisserie avalée… Eh bien le total grimpe à un milliard de centimes de bénéf tous les matins (ça se passe à une époque où les Chinois étaient un peu moins nombreux que maintenant)… Vu que les prix des denrées de première nécessité se sont envolés, ça pourrait donner facilement dix millions d’euro dans le tiroir caisse. On n’était pas les seuls à délirer puisque, à peu près à la même époque, dans les débuts de l’informatique à gogo, un employé de banque s’était amusé à un jeu identique. Il s’agissait simplement d’arrondir les soldes des opérations bancaires (ces millièmes ou dix millièmes de dollars ou de francs – la troisième ou la quatrième décimale). Les excédents étaient virés sur un compte fictif qui capitalisait ainsi une somme largement impressionnante. Certes, me direz-vous, notre affaire de biscuits chocolatés c’était une approche de l’économie un peu simpliste et un résultat financier soumis à un contexte bien particulier… Cela avait au moins le mérite d’offrir une représentation des quantités à peu près gérable.. Quoique… Dix millions d’euro de bénéfice, je ne vois pas trop quoi faire avec, comme ça, au débotté (laissez-moi quelques jours de réflexion avant de m’adresser un chèque !). Vous ne vous êtes jamais imaginé que si une centaine de vos copains vous adressaient un chèque de 30 euro tous les mois vous n’auriez plus besoin d’aller « bêtement » travailler ???
En fait, l’être humain a tellement de mal à gérer les grands nombres qu’un jour on se retrouvera trop nombreux sur cette petite planète et qu’il faudra envisager de construire des tours d’habitation dans les Parc Naturels pour héberger tout le monde. Peu réaliste me direz-vous ? Au moment où vous lisez ce billet grâce au réseau Wifi du Club Méméd, il y a combien de corps autour de vous, vautrés sur la plage ? Au fait, vous vous situez où ? Première ou deuxième couche ? Pour bronzer (et pour respirer d’ailleurs), mieux vaut celle du haut !
 Alors on fait comment si l’on ne peut pas comprendre ? On peut essayer d’imaginer la résolution d’un problème à une échelle moindre mais déjà importante… Avec les enfants, on peut recourir à un jeu idiot : mettre un caillou chaque jour dans une cuvette remplie d’eau. Le moment où il n’y a plus de place pour l’eau arrive assez vite, même si les pierres sont petites, surtout si l’on réalise cette expérience avec un groupe classe de 25 élèves (non, pardon, 30, Châtel est passé par là). Ce que je fais n’a qu’un impact limité, mais ce que je fais, les autres aussi ont le droit de le faire… genre « un verre ça va », « dix papiers gras, bonjour les dégâts ». L’imagination, puis la morale, vont venir au secours de notre déficience intellectuelle. Cela évitera peut-être le spectacle que l’on découvre au bord des petites routes, vers chez nous, lorsque le tracteur broyeur est passé pour couper l’herbe… « Dix papiers gras ça va, mais cent paquets de clopes bonjour les dégâts ». Le chanteur Michel Bühler (que j’apprécie beaucoup) a une mignonne petite chanson à ce sujet… Ça s’appelle « Les Poissons Sont Des Cons » et ça peut s’écouter sur son disque « Passant »…
Alors on fait comment si l’on ne peut pas comprendre ? On peut essayer d’imaginer la résolution d’un problème à une échelle moindre mais déjà importante… Avec les enfants, on peut recourir à un jeu idiot : mettre un caillou chaque jour dans une cuvette remplie d’eau. Le moment où il n’y a plus de place pour l’eau arrive assez vite, même si les pierres sont petites, surtout si l’on réalise cette expérience avec un groupe classe de 25 élèves (non, pardon, 30, Châtel est passé par là). Ce que je fais n’a qu’un impact limité, mais ce que je fais, les autres aussi ont le droit de le faire… genre « un verre ça va », « dix papiers gras, bonjour les dégâts ». L’imagination, puis la morale, vont venir au secours de notre déficience intellectuelle. Cela évitera peut-être le spectacle que l’on découvre au bord des petites routes, vers chez nous, lorsque le tracteur broyeur est passé pour couper l’herbe… « Dix papiers gras ça va, mais cent paquets de clopes bonjour les dégâts ». Le chanteur Michel Bühler (que j’apprécie beaucoup) a une mignonne petite chanson à ce sujet… Ça s’appelle « Les Poissons Sont Des Cons » et ça peut s’écouter sur son disque « Passant »…
Morale ne veut pas forcément dire coercition. L’exemple montre qu’à partir du moment où « il est interdit de », l’esprit humain cherche à contourner cet interdit… Quoique… je me demande quelle est l’efficacité de la menace figurant sur les panneaux dressés le long des routes au Québec : un marteau, une enclume et la somme de 100 dollars indiquée pour quiconque s’amuserait à jeter des ordures par la fenêtre de son véhicule… C’est un pays étrange… Les képis censés contrôler tout cela on ne les voit guère, que ce soit en ville ou en campagne, contrairement à notre France nationale où l’on a parfois l’impression de vivre dans un pays occupé par les uniformes… En tout cas, c’est propre dans l’ensemble, même lorsque l’on divague ailleurs que dans les parcs nationaux ou provinciaux… Mais bon, je ne me vois guère, compte-tenu de ma philosophie plutôt libertaire, dans la position du crétin réclamant sans cesse plus de policiers pour surveiller tout et n’importe quoi. Rassurez-vous, vous n’écoutez pas JPP sur TF1 ou DP sur France 2, vous lisez bien « la Feuille Charbinoise », ce blog biblique qui résout tous les problèmes à coup de prêches sonnants et trébuchants….
 Le problème n’est donc pas simple. Il va nous falloir bientôt partager l’espace à neuf milliards (je sais, je rabâche puisque j’en parle déjà dans une autre chronique), en prenant soin du fait que chacun mange à sa faim mais pas trop, ne boive pas trop d’alcool, coupe du bois de façon raisonnable, ne fusille pas plus d’un bison par siècle… . Certes, les fabriques de biscuits chocolatés seront autogérées et personne ne vous obligera à en manger un tous les matins, mais il n’en reste pas moins que neuf milliards de gâteaux, de bananes, de yaourts ou de portions de frites, ça fait beaucoup. Il va falloir sacrément planifier tout ça si l’on ne veut pas que les famines à répétition (et les conflits qui les accompagnent inévitablement) ne ramènent l’espèce humaine à une quantité de spécimens mentalement gérable. Le groupe de musiciens « les Cow-Boys Fringants » a écrit un jour une mignonne petite chanson à ce sujet… Ça s’appelle « 8 secondes » et ça peut s’écouter sur leur disque « La Grand-Messe ». Ne me remerciez pas de vous proposer un accompagnement musical « d’ambiance », c’est tout naturel. Je perçois la culture un peu de la même manière que j’élabore un plat de lasagnes : une couche de… suivie d’une couche de… Rien à voir avec la confiture : je n’ai rien à étaler ! Certains vont se plaindre que sur un sujet aussi sérieux (pour ne pas dire grave) je n’arrête pas d’intercaler des remarques déplacées entre deux propos d’une profondeur douteuse. Ce n’est pas pour rien que j’ai décidé de classer ce texte dans la catégorie « philosophie à deux balles ». Il ne me reste plus qu’à déterminer si les balles correspondent à des dollars US, des Francs suisses ou des Euro en perdition. Choix cornélien.
Le problème n’est donc pas simple. Il va nous falloir bientôt partager l’espace à neuf milliards (je sais, je rabâche puisque j’en parle déjà dans une autre chronique), en prenant soin du fait que chacun mange à sa faim mais pas trop, ne boive pas trop d’alcool, coupe du bois de façon raisonnable, ne fusille pas plus d’un bison par siècle… . Certes, les fabriques de biscuits chocolatés seront autogérées et personne ne vous obligera à en manger un tous les matins, mais il n’en reste pas moins que neuf milliards de gâteaux, de bananes, de yaourts ou de portions de frites, ça fait beaucoup. Il va falloir sacrément planifier tout ça si l’on ne veut pas que les famines à répétition (et les conflits qui les accompagnent inévitablement) ne ramènent l’espèce humaine à une quantité de spécimens mentalement gérable. Le groupe de musiciens « les Cow-Boys Fringants » a écrit un jour une mignonne petite chanson à ce sujet… Ça s’appelle « 8 secondes » et ça peut s’écouter sur leur disque « La Grand-Messe ». Ne me remerciez pas de vous proposer un accompagnement musical « d’ambiance », c’est tout naturel. Je perçois la culture un peu de la même manière que j’élabore un plat de lasagnes : une couche de… suivie d’une couche de… Rien à voir avec la confiture : je n’ai rien à étaler ! Certains vont se plaindre que sur un sujet aussi sérieux (pour ne pas dire grave) je n’arrête pas d’intercaler des remarques déplacées entre deux propos d’une profondeur douteuse. Ce n’est pas pour rien que j’ai décidé de classer ce texte dans la catégorie « philosophie à deux balles ». Il ne me reste plus qu’à déterminer si les balles correspondent à des dollars US, des Francs suisses ou des Euro en perdition. Choix cornélien.
 J’en reviens à mes moutons, avec beaucoup d’à propos. Il y en a sûrement parmi vous qui s’amusent à compter les moutons pour s’endormir… Creusez vous la cervelle et faites travailler vos méninges ! Vous souvenez vous du plus grand nombre de moutons que vous ayez réussi à compter ? 1487 ? 2010 un soir de grande insomnie ? Ce n’est même pas la population du bled le plus proche de chez moi. Essayez d’imaginer ce que ça aurait donné si vous étiez allé jusqu’à dénombrer la population de Shangaï ou de Mexico ! Un petit exercice de calcul pour vous exercer : cinq litres d’eau par chasse d’eau, cinq chasses d’eau par jour et par habitant, 19 213 200 habitants (non pardon, 19 213 500, 19 214 000…)… Combien de litres d’eau chaque jour ? Vous avez déjà vu les chutes du Niagara dans un documentaire ? Comparez le débit des chasses d’eau de Shangai et le débit du Niagara… Amusant comme comparaison… Ne comptez pas sur moi pour vous donner la réponse. Cela fait déjà (grosso modo) 30 274 560 minutes que je respire un air de plus en plus pollué et je fatigue ! A la revoyure… Il vous faudra patienter au moins quatre ou cinq mille minutes. Sachant que l’on compte environ 60 moutons à la minute, d’ici là, vous serez sans doute profondément endormis.
J’en reviens à mes moutons, avec beaucoup d’à propos. Il y en a sûrement parmi vous qui s’amusent à compter les moutons pour s’endormir… Creusez vous la cervelle et faites travailler vos méninges ! Vous souvenez vous du plus grand nombre de moutons que vous ayez réussi à compter ? 1487 ? 2010 un soir de grande insomnie ? Ce n’est même pas la population du bled le plus proche de chez moi. Essayez d’imaginer ce que ça aurait donné si vous étiez allé jusqu’à dénombrer la population de Shangaï ou de Mexico ! Un petit exercice de calcul pour vous exercer : cinq litres d’eau par chasse d’eau, cinq chasses d’eau par jour et par habitant, 19 213 200 habitants (non pardon, 19 213 500, 19 214 000…)… Combien de litres d’eau chaque jour ? Vous avez déjà vu les chutes du Niagara dans un documentaire ? Comparez le débit des chasses d’eau de Shangai et le débit du Niagara… Amusant comme comparaison… Ne comptez pas sur moi pour vous donner la réponse. Cela fait déjà (grosso modo) 30 274 560 minutes que je respire un air de plus en plus pollué et je fatigue ! A la revoyure… Il vous faudra patienter au moins quatre ou cinq mille minutes. Sachant que l’on compte environ 60 moutons à la minute, d’ici là, vous serez sans doute profondément endormis.
Je vous abandonne sur ces propos lénifiants. Excusez le côté un peu décousu, désordonné de cette chronique, mais le fil conducteur était si long que je me suis perdu avant d’en trouver l’extrémité. Ce n’est pas très grave, et puis, après tout, « philosophie à deux balles », ça vaut ce que ça vaut !
29juin2010
Posté par Paul dans la catégorie : Bric à blog.
A la traditionnelle question « de quoi va-t-on parler ce mois-ci dans le « bric à blog », je répondrais volontiers « de plein de choses comme d’habitude ». On va même commencer par les sujets qui fâchent… Le dossier brûlant du début de ce mois de juin (avant que le vaudeville de la coupe du monde de foot ne vienne calmer l’incendie), c’est bien entendu l’intervention des commandos israéliens contre la flottille de ravitaillement humanitaire pour Gaza. Une vague énorme d’articles a déferlé sur les sites d’infos et sur les blogs. Beaucoup de clameurs d’indignation (justifiées), beaucoup d’invectives sans intérêt, quelques brûlots de « va-t-en guerre » toujours prêts à napalmiser les problèmes pour les résoudre… Ce n’est pas parmi ces textes-là que j’ai effectué ma petite sélection. Je m’intéresse plutôt à des textes rédigés par des témoins directs, ou bien des analyses un peu plus approfondies et éclairant parfois la situation sous un angle nouveau ou tout au moins original. Je ne prétends pas être exhaustif (loin de moi cette idée, quel que soit le thème par ailleurs) ; dans le cas de cette affaire de « Gaza » il faudrait les capacités de lecture d’un robot informatique pour décrypter tout ce qui a été pixellisé sur nos écrans. Allons-y c’est parti ; je mets mon casque lourd pour éviter les tirs de riposte.
 Le blog « Loubnan y Loubnan » figure dans les liens permanents de « la Feuille », mais il est vrai que je n’en parle pas souvent. Je vous conseille la lecture du billet intitulé: « la flottille et l’escamotage de la question nucléaire« . Le sujet a été peu abordé dans les médias. Il est clair que l’opération montée par les commandos israéliens a constitué un excellent écran de fumée au moment où avait lieu une énième réunion sur la prolifération des armes nucléaires, question à propos de laquelle la position « particulière » de l’état d’Israël devient de plus en plus difficile à légitimer. De quel droit appliquerait-on des sanctions à l’égard de l’Iran, alors que le non respect des résolutions de l’ONU par l’état d’Israël ne provoque aucune réaction coercitive des « grandes puissances » ? Sur la politique complaisante des USA et de l’Europe bien pensante à l’égard du gouvernement israélien et de sa politique , on peut se reporter comme souvent à l’analyse des événements délivrée par Noam Chomsky ; ce texte a été traduit et publiée sur le site « le grand soir ». Toujours à propos de cette affaire de blocus de Gaza, j’ai découvert, sur une affiche signée « des anarchistes », un certain nombre de propos qui me plaisent bien. Je vous en propose un extrait : « […] comme à Gaza, ce camp bombardé et encerclé par l’armée israélienne ; dominé par les autorités religieuses, nationalistes ; soumis à la misère au désespoir. Opposer une logique de guerre contre tout un « peuple » à la terreur de l’Etat israélien ne sert qu’à faire oublier aux rejetés de Gaza comme aux exploités de Tel Aviv qu’il ne leur reste qu’une possibilité pour s’en sortir : se battre contre toute autorité, que ce soit celle de l’uniforme du soldat israélien ou du policier palestinien, de la camisole religieuse – ce vieil ennemi de la liberté -, du costume des capitalistes démocratiques et des usuriers qui, dans les camps comme ailleurs, spéculent sur la misère […] » Utopie ? Sans doute ; mais quel autre moteur de progrès pour l’humanité que ce changement radical que certains appellent de leurs vœux les plus profonds et que d’autres dénigrent depuis l’aube des temps ?
Le blog « Loubnan y Loubnan » figure dans les liens permanents de « la Feuille », mais il est vrai que je n’en parle pas souvent. Je vous conseille la lecture du billet intitulé: « la flottille et l’escamotage de la question nucléaire« . Le sujet a été peu abordé dans les médias. Il est clair que l’opération montée par les commandos israéliens a constitué un excellent écran de fumée au moment où avait lieu une énième réunion sur la prolifération des armes nucléaires, question à propos de laquelle la position « particulière » de l’état d’Israël devient de plus en plus difficile à légitimer. De quel droit appliquerait-on des sanctions à l’égard de l’Iran, alors que le non respect des résolutions de l’ONU par l’état d’Israël ne provoque aucune réaction coercitive des « grandes puissances » ? Sur la politique complaisante des USA et de l’Europe bien pensante à l’égard du gouvernement israélien et de sa politique , on peut se reporter comme souvent à l’analyse des événements délivrée par Noam Chomsky ; ce texte a été traduit et publiée sur le site « le grand soir ». Toujours à propos de cette affaire de blocus de Gaza, j’ai découvert, sur une affiche signée « des anarchistes », un certain nombre de propos qui me plaisent bien. Je vous en propose un extrait : « […] comme à Gaza, ce camp bombardé et encerclé par l’armée israélienne ; dominé par les autorités religieuses, nationalistes ; soumis à la misère au désespoir. Opposer une logique de guerre contre tout un « peuple » à la terreur de l’Etat israélien ne sert qu’à faire oublier aux rejetés de Gaza comme aux exploités de Tel Aviv qu’il ne leur reste qu’une possibilité pour s’en sortir : se battre contre toute autorité, que ce soit celle de l’uniforme du soldat israélien ou du policier palestinien, de la camisole religieuse – ce vieil ennemi de la liberté -, du costume des capitalistes démocratiques et des usuriers qui, dans les camps comme ailleurs, spéculent sur la misère […] » Utopie ? Sans doute ; mais quel autre moteur de progrès pour l’humanité que ce changement radical que certains appellent de leurs vœux les plus profonds et que d’autres dénigrent depuis l’aube des temps ?
 Comme je le disais dans mon introduction, beaucoup d’encre a coulé sur ce sujet de la flottille anti-blocus. Certains textes outranciers, que ce soit dans un camp comme dans l’autre, ne méritent pas d’être retenus. D’autres écrits par contre, posent les problèmes de façon lucide, en termes clairs et parfaitement compréhensibles. Histoire de prendre connaissance du point de vue de l’un des participants à la flottille, vous pouvez lire le témoignage de l’écrivain Henning Mankell. Je trouve intéressante aussi l’intervention de Stéphane Hessel, diplomate, survivant de l’holocauste et militant des droits de l’homme. Son article a été reproduit sur Altermonde le 20 juin. Ma dernière proposition de lien sur cette histoire, ce sera l’analyse du journaliste israélien Uri Avnery, intitulée « Tue un Turc et repose-toi« . Les textes d’Uri Avnery, comme ceux de nombreux autres intellectuels israéliens, ont le mérite de montrer aussi que dans ce pays, comme ailleurs, tous les citoyens n’approuvent pas forcément la politique extrémiste de leur gouvernement.
Comme je le disais dans mon introduction, beaucoup d’encre a coulé sur ce sujet de la flottille anti-blocus. Certains textes outranciers, que ce soit dans un camp comme dans l’autre, ne méritent pas d’être retenus. D’autres écrits par contre, posent les problèmes de façon lucide, en termes clairs et parfaitement compréhensibles. Histoire de prendre connaissance du point de vue de l’un des participants à la flottille, vous pouvez lire le témoignage de l’écrivain Henning Mankell. Je trouve intéressante aussi l’intervention de Stéphane Hessel, diplomate, survivant de l’holocauste et militant des droits de l’homme. Son article a été reproduit sur Altermonde le 20 juin. Ma dernière proposition de lien sur cette histoire, ce sera l’analyse du journaliste israélien Uri Avnery, intitulée « Tue un Turc et repose-toi« . Les textes d’Uri Avnery, comme ceux de nombreux autres intellectuels israéliens, ont le mérite de montrer aussi que dans ce pays, comme ailleurs, tous les citoyens n’approuvent pas forcément la politique extrémiste de leur gouvernement.
En prolongement de cette affaire, une prise de position de l’équipe dirigeante des cinémas Utopia a provoqué pas mal de remous dans les milieux intellectuels hexagonaux. Les cinémas Utopia ont pris l’initiative, suite à l’intervention militaire contre la flottille anti-blocus, de déprogrammer le film d’un réalisateur israélien, annoncé auparavant, pour le remplacer par un autre (d’une réalisatrice israélienne également – chose que beaucoup de journalistes ont omis de préciser). Le but de cette intervention n’était pas d’annuler la diffusion du premier, mais de la décaler, pour mettre en avant un documentaire consacré à Rachel Corrie, la jeune militante américaine qui a été écrasée par un bulldozer israélien lors d’une action non violente destinée à bloquer la démolition de maisons palestiniennes par les colons. Ce report de programmation a été jugé très maladroit par certains chroniqueurs qui n’ont pas hésité à parler de « censure » et de mesure de rétorsion totalement inappropriée puisque, selon eux, le réalisateur du premier film n’avait rien à voir avec l’intervention armée des commandos. L’argumentation que j’ai trouvée la plus sensée en ce qui concerne ce point de vue – avec lequel je suis en désaccord – est celle qu’a développée JEA sur son blog Mo(t)saïques. D’autres ont totalement approuvé l’initiative prise par l’équipe d’Utopia, et parmi eux un certain nombre d’artistes israéliens qui ne parlent nullement de censure et trouvent que la décision prise était la bonne ; on peut lire notamment à ce sujet le très bon texte du cinéaste israélien Eyal Sivan reproduit sur le blog « Humeurs de Jean Dornac » ou bien le point de vue de Simone Bitton, la réalisatrice du film « Rachel », sur « Rue 89 ». Là-dessus, on clôt temporairement le chapitre « politique au Moyen-Orient ».
 Un peu d’analyse et de théorie politiques histoire de vous user les neurones avant de partir en congé vous bronzer sur la plage ? Si vous ne lisez que peu de textes de ce genre mais que vous aimez avoir matière à réfléchir entre deux mots fléchés, lisez donc cette analyse pertinente sur le blog d’Anne Archet : » Le capitalisme vit ses derniers moments « … Vous saurez tout ce que la chroniqueuse québecoise a pu déchiffrer dans sa boule de cristal, et vous découvrirez que cette « disparition » annoncée du capitalisme ne la fait pas forcément plonger dans un océan de béatitude… Plusieurs raisons majeures risquent de précipiter la fin de ce système qui perdure depuis… bien trop longtemps : en premier lieu, la difficulté d’accroître les profits sans limite, à cause de l’augmentation du coût des matières premières et de l’impossibilité pour les entrepreneurs de laisser le soin à des partenaires extérieurs (Etat, collectivité, citoyens lambda) de gérer le coût de leurs malversations ; en second lieu, l’impossibilité de freiner la hausse des dépenses sociales ; enfin la déliquescence des Etats, meilleurs alliés de la « régulation » capitaliste. Tout cela paraît difficile à gober tout rond et tout cru, mais dans l’exposé d’Anne Archet (nettement plus conséquent que mon résumé) c’est fort bien expliqué et étayé par de nombreux arguments. A mes yeux, cet écrit théorique est une bonne base de discussion. On trouve de bonnes choses dans les livres, mais aussi sur les sites internet… De plus l’auteure n’est ni économiste ni politicienne et ne manie pas la langue de bois ou le verbiage opaque des spécialistes. Du coup, tout un chacun peut y trouver du grain à moudre puis à mâchonner jusqu’à obtenir une certaine élasticité. Je vous propose un bref extrait de cette longue analyse, histoire de piquer un peu votre curiosité :
Un peu d’analyse et de théorie politiques histoire de vous user les neurones avant de partir en congé vous bronzer sur la plage ? Si vous ne lisez que peu de textes de ce genre mais que vous aimez avoir matière à réfléchir entre deux mots fléchés, lisez donc cette analyse pertinente sur le blog d’Anne Archet : » Le capitalisme vit ses derniers moments « … Vous saurez tout ce que la chroniqueuse québecoise a pu déchiffrer dans sa boule de cristal, et vous découvrirez que cette « disparition » annoncée du capitalisme ne la fait pas forcément plonger dans un océan de béatitude… Plusieurs raisons majeures risquent de précipiter la fin de ce système qui perdure depuis… bien trop longtemps : en premier lieu, la difficulté d’accroître les profits sans limite, à cause de l’augmentation du coût des matières premières et de l’impossibilité pour les entrepreneurs de laisser le soin à des partenaires extérieurs (Etat, collectivité, citoyens lambda) de gérer le coût de leurs malversations ; en second lieu, l’impossibilité de freiner la hausse des dépenses sociales ; enfin la déliquescence des Etats, meilleurs alliés de la « régulation » capitaliste. Tout cela paraît difficile à gober tout rond et tout cru, mais dans l’exposé d’Anne Archet (nettement plus conséquent que mon résumé) c’est fort bien expliqué et étayé par de nombreux arguments. A mes yeux, cet écrit théorique est une bonne base de discussion. On trouve de bonnes choses dans les livres, mais aussi sur les sites internet… De plus l’auteure n’est ni économiste ni politicienne et ne manie pas la langue de bois ou le verbiage opaque des spécialistes. Du coup, tout un chacun peut y trouver du grain à moudre puis à mâchonner jusqu’à obtenir une certaine élasticité. Je vous propose un bref extrait de cette longue analyse, histoire de piquer un peu votre curiosité :
« Mais la mondialisation ?» me direz-vous. En effet, n’est-ce pas le désir des capitalistes de créer un marché mondial libre, hors de portée du pouvoir juridique des États nationaux? Évidemment, il est sans grand intérêt de disposer d’un monopole parfait au niveau national si la concurrence extérieure est trop sévère. Mais il ne faut pas oublier que ce que l’on nomme mondialisation est un processus négocié non pas par les entreprises capitalistes, mais par les États eux-mêmes — selon les termes des États puissants et au détriment des États des pays pauvres. En vérité, les mécanismes fondamentaux du capitalisme international n’ont guère changé depuis cinq cents ans: un État puissant exerce toujours des pressions politiques, économiques et même militaires pour forcer l’entrée des marchés des pays pauvres, ce qui permet à ses industries bien rodées d’éliminer les concurrents indigènes faibles. On aboutit au monopole de fait de l’industrie forte du pays puissant. Un État peut aussi préserver un monopole sur le marché mondial en interdisant la vente de technologies avancées et stratégiques à l’extérieur (c’est d’ailleurs en ce sens qu’on doit comprendre l’obsession des gouvernements à freiner «l’exode des cerveaux»).
Bref, le capitalisme n’aurait pu ni voir le jour ni se développer sans un constant soutien des États. Le problème, c’est que l’État fort, pilier du capitalisme, s’effrite. Et c’est encore la faute des pouilleux et des crottés que nous sommes. […] »
 C’est tellement le bazar dans l’entreprise de démolition de l’éducation nationale que même les Inspecteurs d’Académie se plaignent à leur ministre de tutelle. C’est dire ! Ce n’est pas ça qui remontera le moral des enseignants mais vous pouvez toujours lire le texte du courrier envoyé par le S.I.A. (non pas C.I.A. !) à ce très cher Luc Chatel.
C’est tellement le bazar dans l’entreprise de démolition de l’éducation nationale que même les Inspecteurs d’Académie se plaignent à leur ministre de tutelle. C’est dire ! Ce n’est pas ça qui remontera le moral des enseignants mais vous pouvez toujours lire le texte du courrier envoyé par le S.I.A. (non pas C.I.A. !) à ce très cher Luc Chatel.
Fin pour ce qui est de la politique et du social (chapitre bref, ce mois-ci, je le reconnais !)… Détendons nous un peu cré nom de nom de mille sabords. D’abord, face à la morosité ambiante, il y a une arme radicale c’est le blog d’Appas (dont j’ai déjà parlé) qui porte maintenant le nom ésotérique de « 4PP45 » : faits divers sordides, retraites, marée noire, politique gouvernementale… tout passe à la moulinette de l’humour grinçant d’Appas et le résultat du mixage est parfois surprenant. Les chroniques sont courtes et toujours bien délirantes. Pas de référence à un billet particulier : l’ensemble est à « manier » sans aucune modération !
Toujours pour se dérider, une visite s’impose au « Petit Champignacien illustré » : les chroniques de ce mois de juin sont savoureuses, sans que l’une mérite une attention plus particulière qu’une autre…
Une fois n’est pas coutume, une petite vidéo qui parle d’informatique et qui m’a bien fait marrer. Certes les dialogues sont en Anglais, mais si vous êtes réfractaire, les images se suffisent. Ne venez pas dire après ça que vous ne comprenez rien au fonctionnement de votre bombe technologique ! Un grand merci au grand fiston qui m’a fait passer l’info et un clin d’œil au moins grand fiston qui, en cette fin juin 2010, déambule quelque part entre Californie et Nevada (Death valley, Yosemite National Park, ça vous dit quelque chose ?). Un blog est ouvert, contenant photos et récits du voyage. Ça s’appelle « Calivada » et ça débute plutôt bien… Le contenu devrait s’étoffer après son retour dans sa seconde mère patrie québécoise.
 Pour finir en parlant encore popote et maison… Si vous envoyez régulièrement des commentaires sur ce blog, vous avez sans doute remarqué que nous avons dû rétablir un « philtre » anti-spam. C’est casse-pieds certes, mais le nombre de commentaires indésirables atteignait la centaine chaque semaine et votre humble serviteur a d’autres tâches plus enrichissantes à réaliser que de jeter des amoncellements d’âneries à la corbeille. L’été s’installe peu à peu et une certaine torpeur envahit le petit monde des blogs. Certains arrêtent (comme Normand Baillargeon), d’autres ralentissent leur production (l’arbre à palabres)… Le nombre de lecteurs/trices diminue aussi de façon notable, en particulier le week-end, ce qui montre bien, petits canaillous irrespectueux des désirs de votre patron bien aimé, que vous batifolez plus souvent sur l’ordinateur au boulot qu’à la maison… De là à ce que l’on interdise les blogs ! La Feuille Charbinoise continue son train-train pendant l’été, sans qu’il y ait trop de changements par rapport au rythme adopté ce printemps : deux chroniques par semaine (ou plus ! ou moins !) selon l’inspiration du moment ou les coups de sang provoqués par l’actualité… Si vos déplacements estivaux vous amènent à passer non loin du Nord-Isère, n’hésitez pas à vous arrêter. Je vous rappelle que nous sommes dûment inscrits au réseau « Couch-Surfing » et présentons toutes les garanties de moralité requises (enfin on se les accorde et nos premiers invités avaient l’air d’être d’accord) ! De plus, pour ne pas enquiquiner les travailleurs (et ne pas être enquiquinés par eux), nous restons cheu nous tout l’été et n’irons nous mettre au vert que courant septembre… La bière locale (brasserie des Ursulines de Crémieu – excellente – pub gratuite) est au frais et vous attend à l’ombre de « la Feuille ».
Pour finir en parlant encore popote et maison… Si vous envoyez régulièrement des commentaires sur ce blog, vous avez sans doute remarqué que nous avons dû rétablir un « philtre » anti-spam. C’est casse-pieds certes, mais le nombre de commentaires indésirables atteignait la centaine chaque semaine et votre humble serviteur a d’autres tâches plus enrichissantes à réaliser que de jeter des amoncellements d’âneries à la corbeille. L’été s’installe peu à peu et une certaine torpeur envahit le petit monde des blogs. Certains arrêtent (comme Normand Baillargeon), d’autres ralentissent leur production (l’arbre à palabres)… Le nombre de lecteurs/trices diminue aussi de façon notable, en particulier le week-end, ce qui montre bien, petits canaillous irrespectueux des désirs de votre patron bien aimé, que vous batifolez plus souvent sur l’ordinateur au boulot qu’à la maison… De là à ce que l’on interdise les blogs ! La Feuille Charbinoise continue son train-train pendant l’été, sans qu’il y ait trop de changements par rapport au rythme adopté ce printemps : deux chroniques par semaine (ou plus ! ou moins !) selon l’inspiration du moment ou les coups de sang provoqués par l’actualité… Si vos déplacements estivaux vous amènent à passer non loin du Nord-Isère, n’hésitez pas à vous arrêter. Je vous rappelle que nous sommes dûment inscrits au réseau « Couch-Surfing » et présentons toutes les garanties de moralité requises (enfin on se les accorde et nos premiers invités avaient l’air d’être d’accord) ! De plus, pour ne pas enquiquiner les travailleurs (et ne pas être enquiquinés par eux), nous restons cheu nous tout l’été et n’irons nous mettre au vert que courant septembre… La bière locale (brasserie des Ursulines de Crémieu – excellente – pub gratuite) est au frais et vous attend à l’ombre de « la Feuille ».
Addenda – si le texte de cette chronique ne vous passionne pas, vous pouvez toujours admirer les photos… Ce sont quelques unes des fleurs que nous avons cheu nous en ce moment. Gare à Monsieur Hadopi si vous les téléchargez sans demander notre permission. On ne manquera pas de vous dénoncer… Le rapport entre les illustrations et le texte ? Très simple, mon cher Watson… Contempler les fleurs, cela adoucit les mœurs et on en a bien besoin dans ce monde de sauvages.
RAddenda – un complément de dernière minute au texte du blog d’Anne Archet. Il s’agit d’un billet rédigé par Alain Bihr , intitulé « Prendre au mot la dimension mortifère du capitalisme« . Comme ça vous aurez une bonne raison de passer à la pharmacie acheter un médicament contre la migraine (au mieux) ou la dépression (au pire). Ma préférence va à la fin du texte d’Alain Bihr, en particulier ses propositions de slogans et de revendications pour les prochaines manifs !
24juin2010
Posté par Paul dans la catégorie : l'alambic culturel; mes lectures.
Hommage à Eugène Bizeau, plume libertaire et centenaire
 Il y a peu de temps, je vous parlais de Bernard Gainier, anar vigneron, interprète remarquable de Gaston Couté, à l’occasion de la sortie du film « Bernard ni dieu ni chaussettes ». J’ai découvert, il y a peu, un autre personnage singulier, témoignant de la richesse de la culture libertaire dans notre pays. Il s’agit d’Eugène Bizeau, dont les poèmes ont été déclamés ou chantés par plusieurs artistes que nous aimons beaucoup (je pense en particulier à Gérard Pierron, autre interprète de Couté). Après avoir lu quelques uns des textes magnifiques que Bizeau a écrits au cours de sa longue existence, j’ai décidé de vous faire partager mon plaisir. Je me permettrai donc d’entrecouper la biographie que je vais vous présenter de quelques extraits de poèmes choisis. Cette lecture peut s’accompagner d’une dégustation raisonnable de vin du pays de Loire ; l’hommage n’en sera que plus authentique dans ces conditions, puisqu’il rendra gloire à ce qui a été une des occupations principales de notre poète militant : la viticulture. Je donnerai ensuite à celles ou ceux qui ont envie de poursuivre ce voyage de découverte quelques références bibliographiques ou ouebesques ! Je vous laisse la responsabilité de l’exploration viticole…
Il y a peu de temps, je vous parlais de Bernard Gainier, anar vigneron, interprète remarquable de Gaston Couté, à l’occasion de la sortie du film « Bernard ni dieu ni chaussettes ». J’ai découvert, il y a peu, un autre personnage singulier, témoignant de la richesse de la culture libertaire dans notre pays. Il s’agit d’Eugène Bizeau, dont les poèmes ont été déclamés ou chantés par plusieurs artistes que nous aimons beaucoup (je pense en particulier à Gérard Pierron, autre interprète de Couté). Après avoir lu quelques uns des textes magnifiques que Bizeau a écrits au cours de sa longue existence, j’ai décidé de vous faire partager mon plaisir. Je me permettrai donc d’entrecouper la biographie que je vais vous présenter de quelques extraits de poèmes choisis. Cette lecture peut s’accompagner d’une dégustation raisonnable de vin du pays de Loire ; l’hommage n’en sera que plus authentique dans ces conditions, puisqu’il rendra gloire à ce qui a été une des occupations principales de notre poète militant : la viticulture. Je donnerai ensuite à celles ou ceux qui ont envie de poursuivre ce voyage de découverte quelques références bibliographiques ou ouebesques ! Je vous laisse la responsabilité de l’exploration viticole…
Une petite entrée en matière :
AIMONS !
S’il est vrai que le cœur des hommes
S’agrandit au vol des chansons,
Pour être meilleur que nous sommes,
Chantons !
S’il est vrai que les yeux du rêve
Vous font voir de clairs horizons
Pour que l’aurore au ciel se lève,
Rêvons !
S’il est vrai que l’amour nous mène
Vers un avenir sans canons,
Pour qu’il soit plus fort que la haine,
Aimons !
 Eugène Bizeau est mort dans sa cent-sixième année, le 29 mai 1989, après avoir consacré une grande partie de sa vie à militer pour la paix, contre la militarisation de la société. Ses écrits ont été publiés dans de nombreuses et parfois éphémères revues. Ses poèmes ont été regroupés et publiés dans plusieurs recueils. Le poète est né à Véretz, petit village de Touraine, situé au bord du Cher, non loin de Vouvray. Ses parents étaient vignerons et républicains. Son père, libre penseur, militait pour l’instauration d’une république sociale. Ses études sont brillantes mais de courte durée. Il obtient d’excellents résultats mais doit quitter l’école après le certificat d’études pour aller travailler. A l’age de treize ans, il devient domestique jardinier, puis casseur de pierres sur les routes l’hiver, avant d’être apprenti vigneron. Cette intense activité professionnelle ne l’empêche pas de se cultiver et de consacrer une bonne part de son temps libre à la lecture. Très jeune il découvre Blanqui, Proudhon, et s’intéresse à la presse anarchiste. A quatorze ans, il est déjà abonné au « Libertaire » ; peu de temps après il devient lecteur du « Père Peinard » d’Emile Pouget. Il se met à écrire des poèmes (le premier à l’âge de huit ans), mais aussi des articles pour la presse révolutionnaire. En 1907, il s’installe comme vigneron, à son propre compte, et rédige de plus en plus de textes poétiques. La misère du monde, l’arrogance des possédants, le machiavélisme des politiciens, le rendent enragé et il ne cesse de dénoncer l’injustice et l’exploitation. En 1910, il fait partie de la « Muse rouge », un groupe de poètes et de chansonniers révolutionnaires autour duquel gravitent ou ont gravité également May Picqueray ou Gaston Couté.
Eugène Bizeau est mort dans sa cent-sixième année, le 29 mai 1989, après avoir consacré une grande partie de sa vie à militer pour la paix, contre la militarisation de la société. Ses écrits ont été publiés dans de nombreuses et parfois éphémères revues. Ses poèmes ont été regroupés et publiés dans plusieurs recueils. Le poète est né à Véretz, petit village de Touraine, situé au bord du Cher, non loin de Vouvray. Ses parents étaient vignerons et républicains. Son père, libre penseur, militait pour l’instauration d’une république sociale. Ses études sont brillantes mais de courte durée. Il obtient d’excellents résultats mais doit quitter l’école après le certificat d’études pour aller travailler. A l’age de treize ans, il devient domestique jardinier, puis casseur de pierres sur les routes l’hiver, avant d’être apprenti vigneron. Cette intense activité professionnelle ne l’empêche pas de se cultiver et de consacrer une bonne part de son temps libre à la lecture. Très jeune il découvre Blanqui, Proudhon, et s’intéresse à la presse anarchiste. A quatorze ans, il est déjà abonné au « Libertaire » ; peu de temps après il devient lecteur du « Père Peinard » d’Emile Pouget. Il se met à écrire des poèmes (le premier à l’âge de huit ans), mais aussi des articles pour la presse révolutionnaire. En 1907, il s’installe comme vigneron, à son propre compte, et rédige de plus en plus de textes poétiques. La misère du monde, l’arrogance des possédants, le machiavélisme des politiciens, le rendent enragé et il ne cesse de dénoncer l’injustice et l’exploitation. En 1910, il fait partie de la « Muse rouge », un groupe de poètes et de chansonniers révolutionnaires autour duquel gravitent ou ont gravité également May Picqueray ou Gaston Couté.
LA COLOMBE DE PICASSO
La Colombe de Picasso
Sous un ciel que l’amour déserte…
Garde en son bec la branche verte
Que le guerrier jette au ruisseau.
Elle apporte un espoir nouveau
Aux cœurs maternels en alerte,
La Colombe de Picasso,
Sous un ciel que l’amour déserte…
Elle vivra, malgré l’assaut
Des vautours qui voudraient sa perte…
Elle étendra son aile ouverte
Sur les nids et sur les berceaux,
La Colombe de Picasso !
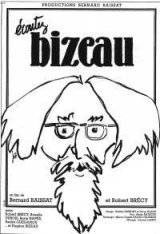 Il n’est pas mobilisé en 1914 car il est réformé pour « faiblesse de constitution ». Il en profite pour mener en Touraine une propagande antimilitariste acharnée. Il écrit de nombreux poèmes pour dénoncer l’absurdité du massacre en cours. Peu sont publiés car la censure veille. L’un de ses textes, intitulé « les martyrs » paraît dans un journal portant la mention « imprimé en Suisse », ce qui n’est bien entendu pas le cas puisqu’il sort des presses d’un imprimeur de Tours. Cette poésie rend hommage aux « fusillés pour l’exemple ». En 1916, il épouse Adélaïde Chambonnière, une institutrice qu’il a connue par le biais du journal d’Emile Armand. La jeune femme partage ses convictions politiques et écrit également de la poésie. Eugène Bizeau s’installe en Auvergne, à Massiac, pour se rapprocher de son épouse. Le couple reviendra s’installer à Véretz en 1945 et le poète pourra reprendre son activité de vigneron abandonnée pendant près de trente ans. Il s’occupe alors de ses vignes jusqu’au début des années 80. Son épouse décède en 1974. Eugène Bizeau reste alors seul à Véretz, partageant son temps entre les travaux domestiques, la lecture, l’écriture et les rencontres avec ses amis. Il appartient à l’association « art et poésie » de Touraine. A l’occasion de son centième anniversaire, en 1983, un film « Ecoutez Bizeau », lui est consacré et témoigne de sa vivacité, de sa joie de vivre et de son esprit critique, toujours bien présent. L’auteur de ce documentaire est le cinéaste libertaire Bernard Baissat. Jusqu’à ses derniers jours, à l’hôpital de Tours, il continue à écrire des poèmes ; c’est sa façon à lui de militer pour la paix, un combat auquel il a participé tout au long de sa vie. Parmi ses nombreux « titres de gloire », celui d’avoir gagné, en 1983, le diplôme de « plus vieux lecteur du Canard enchaîné » ! Grâce à l’association des amis d’Eugène Bizeau qui s’est constituée à Véretz, la mémoire du poète reste bien vivante. Chaque année cette association organise une journée d’hommage au poète vigneron et à son épouse. La plupart de ses recueils de poésies ont été réédités et sont encore disponibles.
Il n’est pas mobilisé en 1914 car il est réformé pour « faiblesse de constitution ». Il en profite pour mener en Touraine une propagande antimilitariste acharnée. Il écrit de nombreux poèmes pour dénoncer l’absurdité du massacre en cours. Peu sont publiés car la censure veille. L’un de ses textes, intitulé « les martyrs » paraît dans un journal portant la mention « imprimé en Suisse », ce qui n’est bien entendu pas le cas puisqu’il sort des presses d’un imprimeur de Tours. Cette poésie rend hommage aux « fusillés pour l’exemple ». En 1916, il épouse Adélaïde Chambonnière, une institutrice qu’il a connue par le biais du journal d’Emile Armand. La jeune femme partage ses convictions politiques et écrit également de la poésie. Eugène Bizeau s’installe en Auvergne, à Massiac, pour se rapprocher de son épouse. Le couple reviendra s’installer à Véretz en 1945 et le poète pourra reprendre son activité de vigneron abandonnée pendant près de trente ans. Il s’occupe alors de ses vignes jusqu’au début des années 80. Son épouse décède en 1974. Eugène Bizeau reste alors seul à Véretz, partageant son temps entre les travaux domestiques, la lecture, l’écriture et les rencontres avec ses amis. Il appartient à l’association « art et poésie » de Touraine. A l’occasion de son centième anniversaire, en 1983, un film « Ecoutez Bizeau », lui est consacré et témoigne de sa vivacité, de sa joie de vivre et de son esprit critique, toujours bien présent. L’auteur de ce documentaire est le cinéaste libertaire Bernard Baissat. Jusqu’à ses derniers jours, à l’hôpital de Tours, il continue à écrire des poèmes ; c’est sa façon à lui de militer pour la paix, un combat auquel il a participé tout au long de sa vie. Parmi ses nombreux « titres de gloire », celui d’avoir gagné, en 1983, le diplôme de « plus vieux lecteur du Canard enchaîné » ! Grâce à l’association des amis d’Eugène Bizeau qui s’est constituée à Véretz, la mémoire du poète reste bien vivante. Chaque année cette association organise une journée d’hommage au poète vigneron et à son épouse. La plupart de ses recueils de poésies ont été réédités et sont encore disponibles.
LE VIN
J’aime le vin qui dort dans un caveau rustique,
Le vin de noble souche et de cépage ancien :
C’est « le lait des vieillards » de la sagesse antique
Et du gourmet subtil qui sait choisir le sien.
J’aime l’éclat vermeil d’un Chinon romantique ;
J’aime la mousse d’or d’un Vouvray magicien,
Qui m’emporte, ébloui, dans un rêve extatique,
Des hauteurs de Thélème au coteau ligérien…
J’aime le vin joyeux des vignes tourangelles,
Le vin des soirs bénis qui nous donne des ailes
Sous le ciel étoilé de nos bonheurs d’un jour…
Et je plains en secret le buveur d’eau sévère,
Quand je vois le soleil miroiter dans mon verre
Où les vins de Touraine ont un parfum d’amour.
 Le pacifisme n’est pas la seule composante du combat d’Eugène Bizeau. Le poète est également anticolonialiste et anticlérical. Cet aspect de sa personnalité ressort dans de nombreux textes qu’il a écrits : ses livres, « verrue sociale », publié en 1914 ou « croquis de rue » paru en 1933. S’opposant de toutes ses forces à l’injustice qu’il trouve particulièrement abjecte, il n’hésite pas à être solidaire des opprimés. Il s’implique par exemple dans la défense de l’institutrice Hélène Brion, emprisonnée et traduite devant le conseil de guerre, en 1918, pour avoir diffusé des brochures pacifistes. Il milite pour la libération des soldats encore emprisonnés après la signature de l’armistice. En 1921, il prend fait et cause pour Sacco et Vanzetti et écrit dans les colonnes du « Libertaire » : « Il faut que notre voix, grondant vers l’Amérique, aille exiger pour eux justice et liberté. » De 1929 à 1934, certains de ses poèmes sont mis en musique par de Cardelus ou Isabelli. Ils seront diffusés sur les ondes de radio Barcelone pendant la Révolution en 1936. Il collabore à un nombre toujours plus grand de journaux libertaires, de la « Revue anarchiste » à « Contre-courant » notamment. Jusqu’à son dernier souffle, Eugène Bizeau est resté fidèle à son idéal, traversant, cahin-caha, un siècle marqué par des violences et des conflits incessants, bien éloigné du monde dont il avait rêvé…
Le pacifisme n’est pas la seule composante du combat d’Eugène Bizeau. Le poète est également anticolonialiste et anticlérical. Cet aspect de sa personnalité ressort dans de nombreux textes qu’il a écrits : ses livres, « verrue sociale », publié en 1914 ou « croquis de rue » paru en 1933. S’opposant de toutes ses forces à l’injustice qu’il trouve particulièrement abjecte, il n’hésite pas à être solidaire des opprimés. Il s’implique par exemple dans la défense de l’institutrice Hélène Brion, emprisonnée et traduite devant le conseil de guerre, en 1918, pour avoir diffusé des brochures pacifistes. Il milite pour la libération des soldats encore emprisonnés après la signature de l’armistice. En 1921, il prend fait et cause pour Sacco et Vanzetti et écrit dans les colonnes du « Libertaire » : « Il faut que notre voix, grondant vers l’Amérique, aille exiger pour eux justice et liberté. » De 1929 à 1934, certains de ses poèmes sont mis en musique par de Cardelus ou Isabelli. Ils seront diffusés sur les ondes de radio Barcelone pendant la Révolution en 1936. Il collabore à un nombre toujours plus grand de journaux libertaires, de la « Revue anarchiste » à « Contre-courant » notamment. Jusqu’à son dernier souffle, Eugène Bizeau est resté fidèle à son idéal, traversant, cahin-caha, un siècle marqué par des violences et des conflits incessants, bien éloigné du monde dont il avait rêvé…
Les Églises
D’énormes monuments où des gredins sinistres,
D’un dieu mort sur la croix se disent les ministres,
Dans l’imbécillité des foules à genoux
Trouveront trop longtemps de quoi beurrer leurs choux.
D’énormes monuments que l’astuce des cuistres
Déchirant en secret d’accusateurs registres,
Ne lavera jamais du sang versé partout
Quand « l’infâme » était reine et le prêtre tabou.
D’énormes monuments éclos dans le domaine,
Hélas! illimité, de la bêtise humaine…
D’énormes monuments, dont l’horreur des bûchers
Où flambaient des penseurs les dernières paroles,
Fait l’éclair de nos yeux menacer les coupoles
Et nos désirs vengeurs monter vers les clochers!…
Notes – concernant les sources documentaires : « Histoire de la littérature libertaire en France » de Thierry Maricourt, paru chez Albin Michel (épuisé, à chercher chez les bouquinistes) – sur le web, on peut se reporter avec profit à l’excellent travail biographique réalisé par Catherine Réault-Crosnier ainsi qu’à l’Ephéméride anarchiste (liens permanents) en date du 29 mai. Une partie des illustrations publiées proviennent de ce site.
21juin2010
Posté par Paul dans la catégorie : Histoire locale, nationale, internationale : pages de mémoire; La grande époque des chemins de fer.
 Je relis avec plaisir le livre documentaire fort bien écrit et illustré d’Henri Vincenot « l’âge du chemin de fer », paru il y a quelques années chez Denoël. Cet ouvrage ainsi que quelques autres ont inspiré la chronique ci-dessous. On retient très souvent, dans l’histoire du chemin de fer français, la date de 1827 comme date officielle de circulation du premier train. Il s’agit là de la mise en service d’une ligne allant de Saint-Etienne à Andrézieux et permettant aux houillères stéphanoises de transporter leur charbon à bon compte jusqu’aux berges de la Loire. C’était un chemin de fer un peu particulier puisque la traction des wagonnets était assurée par des chevaux. Les industriels tiraient donc partie de l’invention des rails mais n’utilisaient encore point cette merveille, mise au point par Stephenson, qu’était la locomotive à vapeur. La réduction du frottement, grâce aux rails, permettait quand même à un seul cheval de tirer quatre wagonnets chargés de huit tonnes de charbon. Un tel exploit n’aurait pas été possible sur route. La direction des houillères confia aux frères Seguin, la construction d’une nouvelle ligne reliant St Etienne à la vallée du Rhône. L’ainé, Marc Seguin, se rendit en Angleterre, étudia l’engin mis au point par Stephenson et, le trouvant un peu primitif et particulièrement peu performant, décida de le perfectionner. Il mit au point la fameuse chaudière tubulaire qui devait équiper pendant des années les locomotives à vapeur. Sa première machine fut utilisée pour tracter les wagons à la place des chevaux sur la nouvelle ligne ferroviaire juste inaugurée. La liaison Saint-Etienne-Lyon fut opérationnelle en 1833 : un parcours bien aménagé de 58 kilomètres à double voie. Dès 1831, la compagnie autorisa l’accès à bord de voyageurs payants. Ces premiers aventuriers pouvaient aller de Saint Etienne à Givors, à condition de voyager dans un wagon à marchandises, bien peu confortable il faut le dire…
Je relis avec plaisir le livre documentaire fort bien écrit et illustré d’Henri Vincenot « l’âge du chemin de fer », paru il y a quelques années chez Denoël. Cet ouvrage ainsi que quelques autres ont inspiré la chronique ci-dessous. On retient très souvent, dans l’histoire du chemin de fer français, la date de 1827 comme date officielle de circulation du premier train. Il s’agit là de la mise en service d’une ligne allant de Saint-Etienne à Andrézieux et permettant aux houillères stéphanoises de transporter leur charbon à bon compte jusqu’aux berges de la Loire. C’était un chemin de fer un peu particulier puisque la traction des wagonnets était assurée par des chevaux. Les industriels tiraient donc partie de l’invention des rails mais n’utilisaient encore point cette merveille, mise au point par Stephenson, qu’était la locomotive à vapeur. La réduction du frottement, grâce aux rails, permettait quand même à un seul cheval de tirer quatre wagonnets chargés de huit tonnes de charbon. Un tel exploit n’aurait pas été possible sur route. La direction des houillères confia aux frères Seguin, la construction d’une nouvelle ligne reliant St Etienne à la vallée du Rhône. L’ainé, Marc Seguin, se rendit en Angleterre, étudia l’engin mis au point par Stephenson et, le trouvant un peu primitif et particulièrement peu performant, décida de le perfectionner. Il mit au point la fameuse chaudière tubulaire qui devait équiper pendant des années les locomotives à vapeur. Sa première machine fut utilisée pour tracter les wagons à la place des chevaux sur la nouvelle ligne ferroviaire juste inaugurée. La liaison Saint-Etienne-Lyon fut opérationnelle en 1833 : un parcours bien aménagé de 58 kilomètres à double voie. Dès 1831, la compagnie autorisa l’accès à bord de voyageurs payants. Ces premiers aventuriers pouvaient aller de Saint Etienne à Givors, à condition de voyager dans un wagon à marchandises, bien peu confortable il faut le dire…
 Deux années plus tard, en 1835, les premiers wagons conçus spécialement pour le transport des personnes étaient disponibles. Dès le début la notion de « classe » apparut et l’on construisit des voitures confortables appelées « les financières » et d’autres beaucoup plus sommaires baptisées « cadres ». Le premier modèle était fermé et l’on pouvait voyager à l’abri de l’air. Le second n’était qu’un simple wagon plat muni d’un toit et équipé de bancs en bois plutôt sommaires. L’ouverture de la ligne aux voyageurs, jusqu’à Lyon, puis jusqu’à Roanne, ne passa pas inaperçue dans le public. Les journaux croulaient sous les articles, les dessins d’art ou les caricatures présentant ce moyen de transport, « révolutionnaire » pour les uns, « diabolique » pour les autres. Même la profession médicale se passionna pour la question. Certains médecins mettaient en garde le public contre les risques de pneumonie, d’autres insistaient sur le fait que le déplacement rapide à l’air libre constituait un excellent moyen de lutte contre la coqueluche. D’un côté l’on prédisait les pires catastrophes : incendie, déraillement, maladie pulmonaire à cause du charbon, déplacement des organes à cause des vibrations. De l’autre on ne manquait pas d’arguments pour vanter les mérites du serpent de fer. Tous les pays d’Europe se lancèrent dans la compétition tant l’engouement du public était grand. Dès 1832, la famille impériale d’Autriche faisait son petit tour sur les rails et inaugurait un tronçon entre Linz et Budweis. L’engouement du public était tel que très vite on renonça à l’idée de réserver ces nouveaux axes de transport aux seules marchandises. A partir de 1835, de nouveaux tronçons ferroviaires furent inaugurés un peu partout en Europe.
Deux années plus tard, en 1835, les premiers wagons conçus spécialement pour le transport des personnes étaient disponibles. Dès le début la notion de « classe » apparut et l’on construisit des voitures confortables appelées « les financières » et d’autres beaucoup plus sommaires baptisées « cadres ». Le premier modèle était fermé et l’on pouvait voyager à l’abri de l’air. Le second n’était qu’un simple wagon plat muni d’un toit et équipé de bancs en bois plutôt sommaires. L’ouverture de la ligne aux voyageurs, jusqu’à Lyon, puis jusqu’à Roanne, ne passa pas inaperçue dans le public. Les journaux croulaient sous les articles, les dessins d’art ou les caricatures présentant ce moyen de transport, « révolutionnaire » pour les uns, « diabolique » pour les autres. Même la profession médicale se passionna pour la question. Certains médecins mettaient en garde le public contre les risques de pneumonie, d’autres insistaient sur le fait que le déplacement rapide à l’air libre constituait un excellent moyen de lutte contre la coqueluche. D’un côté l’on prédisait les pires catastrophes : incendie, déraillement, maladie pulmonaire à cause du charbon, déplacement des organes à cause des vibrations. De l’autre on ne manquait pas d’arguments pour vanter les mérites du serpent de fer. Tous les pays d’Europe se lancèrent dans la compétition tant l’engouement du public était grand. Dès 1832, la famille impériale d’Autriche faisait son petit tour sur les rails et inaugurait un tronçon entre Linz et Budweis. L’engouement du public était tel que très vite on renonça à l’idée de réserver ces nouveaux axes de transport aux seules marchandises. A partir de 1835, de nouveaux tronçons ferroviaires furent inaugurés un peu partout en Europe.
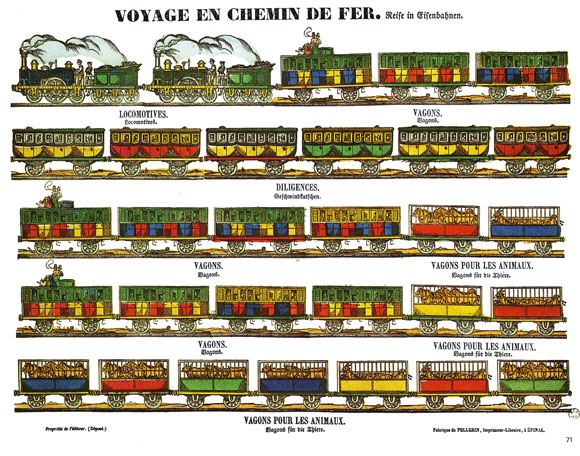
Après avoir joué un rôle précurseur, coude à coude avec l’Angleterre, la France se retrouva plutôt à la traîne au milieu du siècle. Aux yeux de certains, l’excellence du réseau routier et la présence d’un grand nombre de voies navigables, rendaient peu intéressant l’investissement énorme que représentait la construction d’un réseau ferré complet. Mais la locomotive était lancée sur les rails, à des vitesses de plus en plus étonnantes, et il était difficile de ralentir vraiment le mouvement. Les Saint Simoniens, fervents partisans du chemin de fer, militèrent ardemment pour sa cause. Les constructions reprirent donc de plus belle. Le 24 août 1837, on inaugura la ligne Paris-St Germain. La capitale ne pouvait rester longtemps à l’écart d’une telle nouveauté. Le banquier Emile Pereire (Saint Simonien convaincu) et son frère Isaac étaient à l’origine du projet. L’idée était de créer une ligne desservant les lieux d’agrément de la bourgeoisie parisienne et de l’intéresser, par ce biais, à investir dans ce nouveau moyen de locomotion. Il s’agissait plus d’une opération de promotion que d’une réponse à un véritable besoin populaire. La reine de France et ses trois rejetons participèrent à la cérémonie d’inauguration. Les conseillers de Louis Philippe déconseillèrent au Prince de s’exposer à un tel risque. Le dimanche qui suivit l’inauguration, il y eut plus de vingt mille voyageurs et, au bout d’un mois, la compagnie vendit le cent trente millième billet. Les wagons étaient tractés par des locomotives de fabrication anglaise et l’on effectuait le parcours de 16 kilomètres en 26 minutes. L’investissement n’était pas négligeable puisque le ticket coûtait la bagatelle de deux francs en première classe, un franc cinquante en deuxième et un franc en troisième. Mais quand on aime on ne compte pas, et pour aimer, eh bien oui on appréciait ce déplacement à des vitesses vertigineuses. L’événement fit l’objet de la une des journaux pendant des jours et des jours. On jouait même, au théâtre de la Porte Saint-Antoine, une pièce intitulée « Le chemin de fer de Saint Germain ». En 1844 un court tronçon de cette ligne pionnière servit à tester un dispositif nouveau mais peu convaincant : le chemin de fer atmosphérique. Ce système, employé auparavant à deux occasions, en Irlande et en Angleterre, était sensé faciliter le franchissement par les trains de fortes déclivités. Il reposait sur l’utilisation de la pression atmosphérique agissant sur un piston placé dans un tube étanche à l’intérieur duquel on avait réalisé un vide partiel. Cette anecdote permet de se faire une idée du « bouillonnement intellectuel » qui régnait autour de la nouvelle invention. Cette intense activité de recherche explique la rapidité des progrès effectués, tant sur le matériel de traction que sur la construction des voies elles-mêmes.
 Malgré ces quelques réalisations spectaculaires, la France prenait du retard par rapport aux pays voisins. Les liaisons entre les grandes villes se multipliaient dans la plupart des pays européens, mais c’est en Belgique que le programme de construction avançait de la façon la plus spectaculaire. C’est en Belgique aussi que les célébrations étaient les plus extraordinaires (voir avant-dernière illustration de cette chronique). Il y eut ainsi trois jours de fêtes ininterrompues pour l’inauguration du tronçon Malines-Gand. Je cite Henri Vincenot : « … comme le premier convoi avait été baptisé Bayard, du nom du cheval légendaire des quatre fils Aymon, on avait fait un de ces corsos carnavalesques dont les Belges ont le secret, avec un défilé conduit par un immense cheval Bayard monté par les frères Aymon, suivi d’un banquet, puis d’une kermesse avec bal, concert public, feu d’artifice, remise de décorations, puis un deuxième banquet le soir, suivi d’une folle nuit breughelienne dont les dessinateurs de l’époque […] nous ont conservé le souvenir… ». En Sicile on construisit l’une des premières voies à vocation essentiellement touristique, le chemin de fer régional de Naples. Le train permettait aux voyageurs d’arriver à Portici, au pied du Vésuve et connut un grand succès populaire lui aussi. En Russie, on cherchait des solutions pratiques aux immenses problèmes que soulevaient les distances à parcourir et les conditions climatiques extrêmes. On travaillait à la construction d’une voie reliant Saint-Petersbourg à Moscou et le Tsar était enthousiasmé par ce projet dont il avait parfaitement saisi l’intérêt (stratégique en particulier).
Malgré ces quelques réalisations spectaculaires, la France prenait du retard par rapport aux pays voisins. Les liaisons entre les grandes villes se multipliaient dans la plupart des pays européens, mais c’est en Belgique que le programme de construction avançait de la façon la plus spectaculaire. C’est en Belgique aussi que les célébrations étaient les plus extraordinaires (voir avant-dernière illustration de cette chronique). Il y eut ainsi trois jours de fêtes ininterrompues pour l’inauguration du tronçon Malines-Gand. Je cite Henri Vincenot : « … comme le premier convoi avait été baptisé Bayard, du nom du cheval légendaire des quatre fils Aymon, on avait fait un de ces corsos carnavalesques dont les Belges ont le secret, avec un défilé conduit par un immense cheval Bayard monté par les frères Aymon, suivi d’un banquet, puis d’une kermesse avec bal, concert public, feu d’artifice, remise de décorations, puis un deuxième banquet le soir, suivi d’une folle nuit breughelienne dont les dessinateurs de l’époque […] nous ont conservé le souvenir… ». En Sicile on construisit l’une des premières voies à vocation essentiellement touristique, le chemin de fer régional de Naples. Le train permettait aux voyageurs d’arriver à Portici, au pied du Vésuve et connut un grand succès populaire lui aussi. En Russie, on cherchait des solutions pratiques aux immenses problèmes que soulevaient les distances à parcourir et les conditions climatiques extrêmes. On travaillait à la construction d’une voie reliant Saint-Petersbourg à Moscou et le Tsar était enthousiasmé par ce projet dont il avait parfaitement saisi l’intérêt (stratégique en particulier).
 Le premier homme d’état français vraiment convaincu de l’importance du développement du chemin de fer, c’est Louis Napoléon Bonaparte. L’Empereur va donner le coup de pouce nécessaire pour que la France rattrape son retard en la matière et les résultats sont vraiment spectaculaires. La carte du réseau ferré français à la fin de son règne (désastreux par ailleurs) témoigne du progrès des réalisations. En 1852, après avoir effectué les travaux nécessaires pour joindre les différents tronçons existant déjà, la célèbre liaison Paris Lyon Marseille est enfin opérationnelle. Parallèlement à ces grands travaux a lieu un débat d’importance sur la propriété du réseau ferré. L’Etat doit-il conserver le monopole des investissements et de l’exploitation ou bien faut-il recourir à des sociétés à capitaux privés ? On choisit dans un premier temps une solution intermédiaire : le gouvernement confie à des sociétés privées la gestion au quotidien tout en conservant un contrôle assez strict de ce qui se passe. Selon la loi du 11 juin 1842, baptisée « charte des chemins de fer », L’État reste en effet propriétaire des terrains choisis pour les tracés des voies et il finance la construction des infrastructures (ouvrages d’art et bâtiments). Il en concède l’usage à des compagnies qui bâtissent les superstructures (voies ferrées, installations), investissent dans le matériel roulant et disposent d’un monopole d’exploitation sur leurs lignes. Il faudra attendre 1936 pour une étatisation complète des diverses compagnies ferroviaires. Dès 1859, six grandes sociétés se partagent l’exploitation du réseau. L’une des plus célèbres d’entre-elles est la PLM, Paris-Lyon-Méditerranée (et non Marseille pour le M), créée en 1857 par fusion de plusieurs sociétés plus petites. Cette compagnie occupe très vite une place toute particulière dans l’imaginaire des amoureux du train. Outre la ligne Paris-Marseille, d’autres lignes secondaires viennent compléter son réseau, notamment en direction des Alpes et des stations touristiques. La multitude d’affiches publicitaires crées par le PLM vont faire rêver, pendant de nombreuses décennies, les amateurs de destinations exotiques… Aller visiter San Salvadour, à côté de Hyères (illustration n°1 de la chronique), n’est-ce point là une idée pittoresque ? (*)
Le premier homme d’état français vraiment convaincu de l’importance du développement du chemin de fer, c’est Louis Napoléon Bonaparte. L’Empereur va donner le coup de pouce nécessaire pour que la France rattrape son retard en la matière et les résultats sont vraiment spectaculaires. La carte du réseau ferré français à la fin de son règne (désastreux par ailleurs) témoigne du progrès des réalisations. En 1852, après avoir effectué les travaux nécessaires pour joindre les différents tronçons existant déjà, la célèbre liaison Paris Lyon Marseille est enfin opérationnelle. Parallèlement à ces grands travaux a lieu un débat d’importance sur la propriété du réseau ferré. L’Etat doit-il conserver le monopole des investissements et de l’exploitation ou bien faut-il recourir à des sociétés à capitaux privés ? On choisit dans un premier temps une solution intermédiaire : le gouvernement confie à des sociétés privées la gestion au quotidien tout en conservant un contrôle assez strict de ce qui se passe. Selon la loi du 11 juin 1842, baptisée « charte des chemins de fer », L’État reste en effet propriétaire des terrains choisis pour les tracés des voies et il finance la construction des infrastructures (ouvrages d’art et bâtiments). Il en concède l’usage à des compagnies qui bâtissent les superstructures (voies ferrées, installations), investissent dans le matériel roulant et disposent d’un monopole d’exploitation sur leurs lignes. Il faudra attendre 1936 pour une étatisation complète des diverses compagnies ferroviaires. Dès 1859, six grandes sociétés se partagent l’exploitation du réseau. L’une des plus célèbres d’entre-elles est la PLM, Paris-Lyon-Méditerranée (et non Marseille pour le M), créée en 1857 par fusion de plusieurs sociétés plus petites. Cette compagnie occupe très vite une place toute particulière dans l’imaginaire des amoureux du train. Outre la ligne Paris-Marseille, d’autres lignes secondaires viennent compléter son réseau, notamment en direction des Alpes et des stations touristiques. La multitude d’affiches publicitaires crées par le PLM vont faire rêver, pendant de nombreuses décennies, les amateurs de destinations exotiques… Aller visiter San Salvadour, à côté de Hyères (illustration n°1 de la chronique), n’est-ce point là une idée pittoresque ? (*)
L’épopée du chemin de fer est lancée, et bien lancée, sur le vieux continent, mais partout dans le monde la fièvre ferroviaire gagne les investisseurs… Les projets les plus fous naissent dans le cerveau des ingénieurs. Des milliers d’êtres humains paieront de leur vie la réalisation de certaines de ces entreprises. L’invention du chemin de fer – et je rejoins à ce sujet le point de vue d’Henri Vincenot – est probablement l’une des plus importantes dans l’histoire de l’humanité, au même titre que celle de l’imprimerie par exemple. Le XIXème siècle est indubitablement celui du rail et de la vapeur. Dans un futur article, j’aborderai ce phénomène sous un autre angle : celui de la naissance de la corporation des cheminots, leurs conditions de travail, leurs organisations professionnelles et… bien entendu… les premiers mouvements sociaux, car, déjà au temps du PLM, les « gueux » n’hésitaient point « à prendre en otage les malheureux voyageurs » !
Notes – (*) Pour ceux qui (comme moi) ignoreraient en quoi consiste Sans Salvadour, je vous propose un petit lien de secours culturel.
Photos – images 1, 2, 4 et 5 prises au musée de Mulhouse – © La Feuille Charbinoise – image 3, imprimerie Pellerin Epinal – autres illustrations, recherche en cours.


17juin2010
Posté par Paul dans la catégorie : Humeur du jour; Vive la Politique.
Où le chroniqueur de la « Feuille Charbinoise », se croyant hors de la mêlée, se défoule allègrement sur le dos de ses compatriotes, avant de se ressaisir grâce à une conclusion pleine d’espoir et de philosophie…
 J’ai écouté la radio une fois de trop. « Les Français sont résignés » martelait le commentateur-chroniqueur-agent de com de l’Elysée. Les Français sont résignés à gagner moins, travailler plus, partir à la retraite dix ans plus tard, manger des épluchures plutôt que des pommes de terre, payer pour l’éducation de leurs gosses, aller aux urgences à cent kilomètres de chez eux, à la Poste juste un peu plus près… Les Français sont résignés : tant qu’ils pourront allumer leur télé, trouver du charbon de bois pour leur barbecue, et dire du mal des fonctionnaires ou des voisins maghrébins à la concierge de leur immeuble, ils accepteront le dos courbé les sanctions que leur infligent les nouveaux maîtres de la finance et du cynisme. Irrespirable l’air des grandes villes, immangeables les fruits qu’on leur vend à prix d’or, imbuvable l’eau du robinet, inacceptable le salaire à la fin du mois ? Tant qu’il y aura du foot à regarder, des faits divers à savourer, des miss Univers à acclamer… peu importe le reste. Le pays est devenu une gigantesque fumerie d’opium ; une masse de citoyens vieux dans leur tête avant même de l’être dans leur corps se vautrent sur un immense canapé, une bière dans la main et la télécommande dans l’autre. Zapper la misère, zapper l’injustice, zapper l’arbitraire, zapper… zapper… jusqu’à plus soif, jusqu’à trouver les images apaisantes de clinquant et de toc, de paillettes et de biftons… Valeureux sont les quelques énergumènes qui ont encore la force de gueuler dans cet océan de mièvrerie et de fadaise.
J’ai écouté la radio une fois de trop. « Les Français sont résignés » martelait le commentateur-chroniqueur-agent de com de l’Elysée. Les Français sont résignés à gagner moins, travailler plus, partir à la retraite dix ans plus tard, manger des épluchures plutôt que des pommes de terre, payer pour l’éducation de leurs gosses, aller aux urgences à cent kilomètres de chez eux, à la Poste juste un peu plus près… Les Français sont résignés : tant qu’ils pourront allumer leur télé, trouver du charbon de bois pour leur barbecue, et dire du mal des fonctionnaires ou des voisins maghrébins à la concierge de leur immeuble, ils accepteront le dos courbé les sanctions que leur infligent les nouveaux maîtres de la finance et du cynisme. Irrespirable l’air des grandes villes, immangeables les fruits qu’on leur vend à prix d’or, imbuvable l’eau du robinet, inacceptable le salaire à la fin du mois ? Tant qu’il y aura du foot à regarder, des faits divers à savourer, des miss Univers à acclamer… peu importe le reste. Le pays est devenu une gigantesque fumerie d’opium ; une masse de citoyens vieux dans leur tête avant même de l’être dans leur corps se vautrent sur un immense canapé, une bière dans la main et la télécommande dans l’autre. Zapper la misère, zapper l’injustice, zapper l’arbitraire, zapper… zapper… jusqu’à plus soif, jusqu’à trouver les images apaisantes de clinquant et de toc, de paillettes et de biftons… Valeureux sont les quelques énergumènes qui ont encore la force de gueuler dans cet océan de mièvrerie et de fadaise.
J’éteins la radio.
 J’ai lu la presse quotidienne une fois de trop. Les Français sont résignés nous dit-on, mais Bernard Thibaut, lui, est indigné. Il déplore la perte constante et accélérée des acquis sociaux que ses aïeux avaient conquis. Il dénonce le recul considérable que représente la réforme des retraites en cours. Le pire c’est qu’il arrive à déclamer ses grandes tirades anti-gouvernementales sans avoir l’aire de rire… Il a la mémoire courte le Nanard. Il ne se rappelle déjà plus les efforts conséquents qu’il a faits en 2003 avec son état-major de campagne pour torpiller la lutte en cours contre les projets gouvernementaux concernant… les retraites justement. Il ne se rappelle sans doute déjà plus les efforts désespérés pour saboter toute tentative de grève générale reconductible et les appels répétés à une petite grève de 24 h tous les quinze jours pour marquer le coup, garder une image de syndicat de lutte, exaspérer l’opinion et fatiguer les salariés. Une époque singulière où le dénombrement des manifestants par les syndicats était inférieur à celui de la police… D’étranges marchés se sont passés à cette époque-là dans les salons parisiens, entre les bonzes de la CFDT, de la CGT et les négociateurs gouvernementaux. On a tant et tant répété aux Français que leur avenir était dans les urnes et leur présent à la téloche qu’ils ont perdu certaines habitudes plutôt saines de leurs aînés… Certes on occupe encore des lieux de travail, on séquestre, on menace… mais quel courage il faut avoir face à la torpeur des instances syndicales et au silence méprisant des journaleux ! Pas facile de tenir un mois en grève quand les baveux de la presse vous désignent chaque jour à vos concitoyens comme l’ennemi public numéro 1 à abattre. Les cheminots en savent quelque chose !
J’ai lu la presse quotidienne une fois de trop. Les Français sont résignés nous dit-on, mais Bernard Thibaut, lui, est indigné. Il déplore la perte constante et accélérée des acquis sociaux que ses aïeux avaient conquis. Il dénonce le recul considérable que représente la réforme des retraites en cours. Le pire c’est qu’il arrive à déclamer ses grandes tirades anti-gouvernementales sans avoir l’aire de rire… Il a la mémoire courte le Nanard. Il ne se rappelle déjà plus les efforts conséquents qu’il a faits en 2003 avec son état-major de campagne pour torpiller la lutte en cours contre les projets gouvernementaux concernant… les retraites justement. Il ne se rappelle sans doute déjà plus les efforts désespérés pour saboter toute tentative de grève générale reconductible et les appels répétés à une petite grève de 24 h tous les quinze jours pour marquer le coup, garder une image de syndicat de lutte, exaspérer l’opinion et fatiguer les salariés. Une époque singulière où le dénombrement des manifestants par les syndicats était inférieur à celui de la police… D’étranges marchés se sont passés à cette époque-là dans les salons parisiens, entre les bonzes de la CFDT, de la CGT et les négociateurs gouvernementaux. On a tant et tant répété aux Français que leur avenir était dans les urnes et leur présent à la téloche qu’ils ont perdu certaines habitudes plutôt saines de leurs aînés… Certes on occupe encore des lieux de travail, on séquestre, on menace… mais quel courage il faut avoir face à la torpeur des instances syndicales et au silence méprisant des journaleux ! Pas facile de tenir un mois en grève quand les baveux de la presse vous désignent chaque jour à vos concitoyens comme l’ennemi public numéro 1 à abattre. Les cheminots en savent quelque chose !
A la chaudière le journal, dans la mesure où ce n’est pas du papier glacé !
 Alors, face à la misère croissante, le système D, la débrouille… on achète toujours autant, mais on cherche les prix les plus bas, sans réfléchir plus loin que les quelques piécettes que l’on a dans son porte monnaie. On ne fait pas attention au fait que l’on pousse ainsi les paysans à proposer des produits d’une qualité toujours plus médiocre et que l’on arme les distributeurs pour tirer dans le tas de ces mêmes producteurs. Chaque fois qu’une grande surface baisse le prix d’un kilo de fruits de 50 c, le producteur, lui, touche un euro de moins. Il fut une époque où le paysan pliait bagage quand il n’en pouvait plus et partait bosser à l’usine, mais des usines il n’y en a plus. Les porte-containers déversent à flots dans les ports gigantesques les produits « made in ailleurs », que fabriquait l’usine du coin. Peu importe la qualité, pourvu que cela brille… Peu importe les conditions de travail de l’ouvrier chinois ou pakistanais, peu importe que l’on provoque son propre licenciement, chaque être humain a le droit d’avoir la même quantité de cochonneries que son voisin, pourvu que cela étincelle. « On ne fabrique plus rien en France » me dit mon voisin en exhibant fièrement sa trousse à outils toute neuve « made in Taïwan ». « On ne trouve plus de boulot ; moi, ma spécialité, c’est la métallurgie ; eh bien, dans la métallurgie, ils n’embauchent plus ! » se plaint le beaufre d’à côté en constatant que sa perceuse fume comme un pétard du 14 juillet. Liquidation du tissu industriel, liquidation du tissu agricole… il n’y aura bientôt plus que quelques emplois dans le tertiaire : un pays de commerçants achetant les uns chez les autres des produits que l’on ne fabrique plus mais que l’on se fait voler et qu’il faut donc assurer : vendeurs, assureurs, banquiers, gendarmes et voleurs… Je ne suis pas certain que ce système puisse fonctionner longuement… Sans parler de ce que les réserves en matières premières de la planète pensent de tous ces trucs qu’on change sans arrêt parce qu’ils cassent ou parce qu’ils sont démodés… La planète on s’en fout et puis les émissions de Nicolas Hulot et d’Arthus Bertrand sont si belles ! Le rapport avec les tonnes d’ordure que l’on bazarde chaque semaine ? Aucun… Pourquoi tu me demandes ça, chérie ?
Alors, face à la misère croissante, le système D, la débrouille… on achète toujours autant, mais on cherche les prix les plus bas, sans réfléchir plus loin que les quelques piécettes que l’on a dans son porte monnaie. On ne fait pas attention au fait que l’on pousse ainsi les paysans à proposer des produits d’une qualité toujours plus médiocre et que l’on arme les distributeurs pour tirer dans le tas de ces mêmes producteurs. Chaque fois qu’une grande surface baisse le prix d’un kilo de fruits de 50 c, le producteur, lui, touche un euro de moins. Il fut une époque où le paysan pliait bagage quand il n’en pouvait plus et partait bosser à l’usine, mais des usines il n’y en a plus. Les porte-containers déversent à flots dans les ports gigantesques les produits « made in ailleurs », que fabriquait l’usine du coin. Peu importe la qualité, pourvu que cela brille… Peu importe les conditions de travail de l’ouvrier chinois ou pakistanais, peu importe que l’on provoque son propre licenciement, chaque être humain a le droit d’avoir la même quantité de cochonneries que son voisin, pourvu que cela étincelle. « On ne fabrique plus rien en France » me dit mon voisin en exhibant fièrement sa trousse à outils toute neuve « made in Taïwan ». « On ne trouve plus de boulot ; moi, ma spécialité, c’est la métallurgie ; eh bien, dans la métallurgie, ils n’embauchent plus ! » se plaint le beaufre d’à côté en constatant que sa perceuse fume comme un pétard du 14 juillet. Liquidation du tissu industriel, liquidation du tissu agricole… il n’y aura bientôt plus que quelques emplois dans le tertiaire : un pays de commerçants achetant les uns chez les autres des produits que l’on ne fabrique plus mais que l’on se fait voler et qu’il faut donc assurer : vendeurs, assureurs, banquiers, gendarmes et voleurs… Je ne suis pas certain que ce système puisse fonctionner longuement… Sans parler de ce que les réserves en matières premières de la planète pensent de tous ces trucs qu’on change sans arrêt parce qu’ils cassent ou parce qu’ils sont démodés… La planète on s’en fout et puis les émissions de Nicolas Hulot et d’Arthus Bertrand sont si belles ! Le rapport avec les tonnes d’ordure que l’on bazarde chaque semaine ? Aucun… Pourquoi tu me demandes ça, chérie ?
 J’ai allumé la télé une fois de trop. Les hommes politiques commencent à trépigner ! Leur bave dégouline sur l’écran ; c’est nettement plus dégoûtant que les escargots. Lorsque Roland aura terminé sa coupe et que le critérium de tennis de Mongolie Orientale sera bouclé, il sera grand temps de passer au prochain round du grand spectacle de la politique fiction : les présidentielles… Elles ne tarderont pas à arriver. Les journaleux sont déjà au boulot pour expliquer aux Français à quel point cette opération doit les passionner… Les paris en ligne sont autorisés, n’hésitez pas à miser vos euro sur les bons chevaux. Les moutons le savent bien : tous les tondeurs ne travaillent pas de la même façon, mais au bout du compte, il ne leur reste pas plus de laine sur le dos. Alors les futurs concurrents frétillent : la silhouette du grand seigneur Villepin se profile derrière celle du bateleur, collectionneur de montres, actuel ; l’ombre de Strauss Kahn apparait derrière la silhouette gracieuse de Mme Aubry (à moins que ce ne soit celle de cette chère Ségolène…) ; les outsiders d’extrême gauche et d’extrême droite espèrent créer la surprise… Un suspens terrible ; un spectacle de premier choix…. Je n’en doute pas et je suis assez admiratif, pour un fois, à l’égard des journalistes qui vont essayer de convaincre le bon peuple de l’intérêt de la chose électorale et du fait que c’est Strauss Kahn qui incarne le mieux « l’espoir pour la gauche ». Imaginez un peu à quel point c’est bandant de voir la tronche omniprésente de Sarkozy remplacée par celle du « si télégénique » DSK. Centre droit, centre gauche, gauche du centre, droite du milieu, j’avoue franchement, je me tâte, je me tâte… J’attends avec impatience les arguments de ceux qui vont m’expliquer, l’air un peu affligé, qu’il faut « absolument » voter pour l’actuel président du FMI, chancre du socialisme, au second tour, afin d’éviter la victoire de cette droite néo-libérale et cynique qui vient de plumer les Français pendant 5, 10, 15…. années d’affilée. Je rentre les épaules pour être prêt à assumer les injures diverses que l’on profère à l’égard des abstentionnistes congénitaux dont je fais partie : « collabo », « Versaillais », « suppôt de Satan, Le Pen, Bayrou » (au choix). Perso, je serai plus branché par une compétition genre triathlon simultané brasse, vélo, tennis… Ce soir-là promis, je me collerai devant la télé avec une provision de bière de la brasserie locale et je baverai, les yeux injectés de sang, en hurlant mon soutien à l’équipe de France composée pour l’occasion. Autre fantasme pervers, je me dis que le jour où les philatélistes gouverneront le monde à la place des « footeux » on aura une émission tous les soirs en direct sur les sorties de timbres, les « enveloppes premier jour », ou l’avantage de l’auto-collant sur le truc à lécher…
J’ai allumé la télé une fois de trop. Les hommes politiques commencent à trépigner ! Leur bave dégouline sur l’écran ; c’est nettement plus dégoûtant que les escargots. Lorsque Roland aura terminé sa coupe et que le critérium de tennis de Mongolie Orientale sera bouclé, il sera grand temps de passer au prochain round du grand spectacle de la politique fiction : les présidentielles… Elles ne tarderont pas à arriver. Les journaleux sont déjà au boulot pour expliquer aux Français à quel point cette opération doit les passionner… Les paris en ligne sont autorisés, n’hésitez pas à miser vos euro sur les bons chevaux. Les moutons le savent bien : tous les tondeurs ne travaillent pas de la même façon, mais au bout du compte, il ne leur reste pas plus de laine sur le dos. Alors les futurs concurrents frétillent : la silhouette du grand seigneur Villepin se profile derrière celle du bateleur, collectionneur de montres, actuel ; l’ombre de Strauss Kahn apparait derrière la silhouette gracieuse de Mme Aubry (à moins que ce ne soit celle de cette chère Ségolène…) ; les outsiders d’extrême gauche et d’extrême droite espèrent créer la surprise… Un suspens terrible ; un spectacle de premier choix…. Je n’en doute pas et je suis assez admiratif, pour un fois, à l’égard des journalistes qui vont essayer de convaincre le bon peuple de l’intérêt de la chose électorale et du fait que c’est Strauss Kahn qui incarne le mieux « l’espoir pour la gauche ». Imaginez un peu à quel point c’est bandant de voir la tronche omniprésente de Sarkozy remplacée par celle du « si télégénique » DSK. Centre droit, centre gauche, gauche du centre, droite du milieu, j’avoue franchement, je me tâte, je me tâte… J’attends avec impatience les arguments de ceux qui vont m’expliquer, l’air un peu affligé, qu’il faut « absolument » voter pour l’actuel président du FMI, chancre du socialisme, au second tour, afin d’éviter la victoire de cette droite néo-libérale et cynique qui vient de plumer les Français pendant 5, 10, 15…. années d’affilée. Je rentre les épaules pour être prêt à assumer les injures diverses que l’on profère à l’égard des abstentionnistes congénitaux dont je fais partie : « collabo », « Versaillais », « suppôt de Satan, Le Pen, Bayrou » (au choix). Perso, je serai plus branché par une compétition genre triathlon simultané brasse, vélo, tennis… Ce soir-là promis, je me collerai devant la télé avec une provision de bière de la brasserie locale et je baverai, les yeux injectés de sang, en hurlant mon soutien à l’équipe de France composée pour l’occasion. Autre fantasme pervers, je me dis que le jour où les philatélistes gouverneront le monde à la place des « footeux » on aura une émission tous les soirs en direct sur les sorties de timbres, les « enveloppes premier jour », ou l’avantage de l’auto-collant sur le truc à lécher…
Au panier la télé ou alors contentez-vous des reportages sur le panda géant. C’est mignon.
Retour à la case sérieuse… Pour l’instant, nous vivons dans l’attente, un singulier mélange de découragement et d’espoir. Cela donne une furieuse envie de ne plus s’intéresser qu’au désherbage de ses carottes et à la lecture du dernier roman à la mode… Du haut de la tour nous ne voyons pas venir l’étincelle qui pourrait embraser le feu qui couve. Les flammes sont maigrelettes et le dispositif anti-incendie trop efficace. La mainmise des puissances d’argent sur les médias est quasi totale et elle est redoutable. On monte en épingle certains faits mineurs tandis que d’autres, primordiaux, sont passés sous silence. On feint de présenter objectivement certains événements, puis peu à peu, on dénature ce que l’on a présenté au départ en choisissant habilement certaines formulations, certaines images, certains témoignages. Il suffit d’observer avec quel talent nos commentateurs politiques ont présenté, puis manipulé l’information sur l’affaire de la flottille pour Gaza : l’importance du choix des mots, la multiplication des insinuations perfides… J’en reparlerai dans le prochain « bric à blog » mais vous pouvez lire, en attendant l’excellente analyse réalisée par ACRIMED (*). C’est édifiant. On peut être étonné qu’après une telle présentation des faits, une bonne partie des sujets de sa majesté Sarkozy soient encore convaincus de la responsabilité des Israéliens dans cette affaire « mineure ».
 Tout est sous contrôle et les citoyens applaudissent des deux mains à la moindre exaction policière ? Pas si sûr… Il faut se méfier des clichés et des simplifications. Un coup d’œil dans le passé peut s’avérer instructif… Certes, à l’époque, il n’y avait pas le JT mais quand même… En 1750, les paysans français applaudissaient au passage des carrosses conduisant à Versailles les nobliaux enrubannés. En 1789, ils piquaient les fesses de ces mêmes intouchables et boutaient le feu à leurs demeures séculaires. Je choisis cet exemple, non pour suggérer le fait qu’il faut obligatoirement recommencer ce qui a déjà été fait ou repasser par les mêmes cheminements : en bref, je ne suis pas un fan de la guillotine à tout va… Je veux simplement exprimer l’une de mes convictions profondes : il faut se méfier de l’océan lorsqu’il paraît trop calme… Je crois que, malgré toutes les bassines de découragement que l’on nous déverse sur le dos, il nous faut garder confiance en un avenir meilleur. Il nous faut aussi témoigner la plus grande défiance à l’égard de l’image que les sondages sur commande donnent de nos concitoyens. Comme le disait Oscar Wilde, « l’opinion publique n’existe que là où il n’y a pas d’idées ». La route est longue et l’on n’est certes pas sortis de l’auberge, mais s’il y a bien une chose qu’il ne faut pas accepter, c’est la résignation. Notre destin nous appartient : nul ne peut en être le maître à notre place. Si vous avez des doutes concernant cette assertion, lisez l’excellentissime ouvrage d’Elisabeth Weissman, « la désobéissance éthique », chez Stock. Je suggère aux instituts de sondage de s’adresser aux gens dont il est question dans ce livre : les réponses à leurs questions vicieuses seront sans doute fort différentes !
Tout est sous contrôle et les citoyens applaudissent des deux mains à la moindre exaction policière ? Pas si sûr… Il faut se méfier des clichés et des simplifications. Un coup d’œil dans le passé peut s’avérer instructif… Certes, à l’époque, il n’y avait pas le JT mais quand même… En 1750, les paysans français applaudissaient au passage des carrosses conduisant à Versailles les nobliaux enrubannés. En 1789, ils piquaient les fesses de ces mêmes intouchables et boutaient le feu à leurs demeures séculaires. Je choisis cet exemple, non pour suggérer le fait qu’il faut obligatoirement recommencer ce qui a déjà été fait ou repasser par les mêmes cheminements : en bref, je ne suis pas un fan de la guillotine à tout va… Je veux simplement exprimer l’une de mes convictions profondes : il faut se méfier de l’océan lorsqu’il paraît trop calme… Je crois que, malgré toutes les bassines de découragement que l’on nous déverse sur le dos, il nous faut garder confiance en un avenir meilleur. Il nous faut aussi témoigner la plus grande défiance à l’égard de l’image que les sondages sur commande donnent de nos concitoyens. Comme le disait Oscar Wilde, « l’opinion publique n’existe que là où il n’y a pas d’idées ». La route est longue et l’on n’est certes pas sortis de l’auberge, mais s’il y a bien une chose qu’il ne faut pas accepter, c’est la résignation. Notre destin nous appartient : nul ne peut en être le maître à notre place. Si vous avez des doutes concernant cette assertion, lisez l’excellentissime ouvrage d’Elisabeth Weissman, « la désobéissance éthique », chez Stock. Je suggère aux instituts de sondage de s’adresser aux gens dont il est question dans ce livre : les réponses à leurs questions vicieuses seront sans doute fort différentes !
C’est promis, je rédige bientôt une chronique « lecture d’urgence » : mon panier déborde de livres peu recommandables à vous recommander… Et puis la météo du moment encourage la lecture !
Post scriptum : avec cette actualité tourbillonnante, je n’ai guère le temps de vous parler d’Eurosatory, le salon des marchands de mort. Pas grave, je l’ai déjà fait par le passé et il n’y a rien de neuf sous le ciel militaire : même les budgets ont une mine resplendissante. Un détail macabre, cette année le salon a lieu du 14 au 18 juin. 14-18 l’ont quand même pas fait exprès ?
Note – (*) deux articles à lire : « Raid sanglant de l’armée israélienne : quelques « bavures » médiatiques » – « Raid sanglant de l’armée israélienne : France 2 à l’assaut de l’information«
14juin2010
Posté par Paul dans la catégorie : Jeu de rôles; le verre et la casserole.
[ Où il arrive que l’on reparle de notre légume fétiche à l’occasion de la naissance du premier spécimen 2010. Promis, on s’intéressera à la coupe du monde de football, dès que le ballon aura pris la forme d’une courgette. ]
Le diplôme de “maître ès-courgettes” obtenu pour mon cinquantième anniversaire de la part de quelques amis experts en la matière (non point en horticulture mais plutôt en gastronomie et en fayotage) me donne, semble-t-il, une certaine légitimité pour aborder cette question délicate qu’est la cuisine de la courgette. Je vous délivre ci-dessous quelques pieux conseils concernant la préparation de ce légume aussi divin que délicat. Je m’adresse à vous en toute indépendance d’esprit, le gouvernement ayant refusé de m’investir d’une mission d’étude officielle, prétextant l’insuffisance des crédits dans ce domaine. Ma modeste tentative pour arguer du fait que la courgette valait bien la mondialisation comme thème de réflexion n’a pas été prise en compte ; quant à ma proposition de n’accepter que la moitié de la rétribution offerte mensuellement à Mme Boutin, elle a été écartée d’un geste méprisant. Visiblement nos gouvernants n’ont que peu de considération pour des experts acceptant de travailler pour des salaires de misère, ce qui explique leur mépris global à l’égard des salariés du secteur privé ou de la fonction publique, du moins en ce qui concerne ces derniers, pour ceux des échelons inférieurs… Mais trêve de placotage, revenons à nos cucurbitacées.
 La courgette est un légume facile à cultiver pour peu que l’on respecte quelques unes de ses exigences de base : une terre profonde, humide, et riche en humus ; des températures clémentes (inutile de semer ou de planter, tant que les températures descendent au dessous de 10° la nuit) et un arrosage régulier, au sol plutôt que par aspersion. Le plant de courgette est productif et ne nécessite aucune taille. Les bonnes années, on peut récolter (selon la taille à laquelle on effectue la cueillette) de cinq à dix kilos de fruits par pied. La courgette est un légume facile à cuisiner pourvu que l’on respecte quelques règles primordiales ; la principale d’entre-elles, qu’omettent beaucoup de cuisiniers inexpérimentés, c’est que ce fruit aux saveurs subtiles ne doit jamais cuire à grande eau, mais toujours à la vapeur ou à l’étouffée (le mieux). Les recettes proposées ci-après, varient selon la taille des fruits. On ne cuisine pas de la même manière petites et grosses courgettes. Les premières conservent leur peau et nécessitent une préparation minima avant cuisson ; les secondes doivent êtres épluchées et égrainées. La préparation des courgettes, dès lors que leur poids dépasse quelques centaines de grammes, ressemble fort à celle des courges. Nous en reparlerons. Une courgette bien fraiche est toujours plus savoureuse qu’un fruit ayant trainé à l’étalage ou en chambre froide. Sa peau doit être légèrement satinée, un peu duveteuse, un peu collante. En culture forcée (serre et engrais), ce fruit béni des dieux charbinois, perd les composantes les plus subtiles de son goût, notamment un léger goût de noisette. Avant d’allumer les feux et le four de votre cuisinière, sachez que les bébés courgettes peuvent être mangés crus (je sais, c’est cruel), assaisonnés, dans une salade mélangée, et qu’ils n’ont rien à envier, dans cet usage, à leur cousin concombre. Je ne vous apprendrai rien non plus je pense en vous rappelant que les fleurs (mâles de préférence, sinon vous n’aurez pas de fruit) permettent de confectionner de délicieux beignets, excellent élément de base pour un régime amaigrissant (je crois que je me laisse emporter par mon élan…). Il est temps que je vous livre, non point les quelques dizaines de recettes que je connais, mais quelques uns des fleurons de ma pratique culinaire en ce domaine. Pour en savoir plus, la meilleure solution c’est de vous inscrire à un stage gastronomique à la maison (tarif social, en fonction des revenus mensuels, donc plus élevé pour Mme Boutin – va de soi).
La courgette est un légume facile à cultiver pour peu que l’on respecte quelques unes de ses exigences de base : une terre profonde, humide, et riche en humus ; des températures clémentes (inutile de semer ou de planter, tant que les températures descendent au dessous de 10° la nuit) et un arrosage régulier, au sol plutôt que par aspersion. Le plant de courgette est productif et ne nécessite aucune taille. Les bonnes années, on peut récolter (selon la taille à laquelle on effectue la cueillette) de cinq à dix kilos de fruits par pied. La courgette est un légume facile à cuisiner pourvu que l’on respecte quelques règles primordiales ; la principale d’entre-elles, qu’omettent beaucoup de cuisiniers inexpérimentés, c’est que ce fruit aux saveurs subtiles ne doit jamais cuire à grande eau, mais toujours à la vapeur ou à l’étouffée (le mieux). Les recettes proposées ci-après, varient selon la taille des fruits. On ne cuisine pas de la même manière petites et grosses courgettes. Les premières conservent leur peau et nécessitent une préparation minima avant cuisson ; les secondes doivent êtres épluchées et égrainées. La préparation des courgettes, dès lors que leur poids dépasse quelques centaines de grammes, ressemble fort à celle des courges. Nous en reparlerons. Une courgette bien fraiche est toujours plus savoureuse qu’un fruit ayant trainé à l’étalage ou en chambre froide. Sa peau doit être légèrement satinée, un peu duveteuse, un peu collante. En culture forcée (serre et engrais), ce fruit béni des dieux charbinois, perd les composantes les plus subtiles de son goût, notamment un léger goût de noisette. Avant d’allumer les feux et le four de votre cuisinière, sachez que les bébés courgettes peuvent être mangés crus (je sais, c’est cruel), assaisonnés, dans une salade mélangée, et qu’ils n’ont rien à envier, dans cet usage, à leur cousin concombre. Je ne vous apprendrai rien non plus je pense en vous rappelant que les fleurs (mâles de préférence, sinon vous n’aurez pas de fruit) permettent de confectionner de délicieux beignets, excellent élément de base pour un régime amaigrissant (je crois que je me laisse emporter par mon élan…). Il est temps que je vous livre, non point les quelques dizaines de recettes que je connais, mais quelques uns des fleurons de ma pratique culinaire en ce domaine. Pour en savoir plus, la meilleure solution c’est de vous inscrire à un stage gastronomique à la maison (tarif social, en fonction des revenus mensuels, donc plus élevé pour Mme Boutin – va de soi).
 Sauté de courgettes au curry – Ingrédients d’accompagnement incontournables : oignons, vin blanc sec (1 verre) ou muscat (1/2 verre), sel, poivre, curry. On fait sauter les oignons dans deux ou trois cuillères d’huile d’olive ; lorsqu’ils sont dorés on ajoute les petites courgettes coupées en rondelles, le vin blanc, le sel et le poivre. On met un couvercle sur la sauteuse, on passe à feu doux et on oublie pendant quelques minutes. Lorsque les courgettes ont transpiré, on « touille » avec délicatesse, on remet le couvercle et on oublie un peu plus longtemps. Lorsque les courgettes paraissent à peu près cuites, on enlève le couvercle, on passe à feu vif, on touille et on retouille consciencieusement jusqu’à ce que le mélange soit rissolé à point. Variante : on peut ajouter des cubes de poivron rouge, mais en dose raisonnable. Précision : on « oublie » pour un cuisinier, cela ne veut pas dire que l’on est frappé d’amnésie et que l’on part regarder un long métrage à la télévision. Cela veut simplement dire que l’on peut faire autre chose, en conservant ses narines en activité de surveillance (à moins que l’on ne dispose d’un drone possédant un capteur olfactif).
Sauté de courgettes au curry – Ingrédients d’accompagnement incontournables : oignons, vin blanc sec (1 verre) ou muscat (1/2 verre), sel, poivre, curry. On fait sauter les oignons dans deux ou trois cuillères d’huile d’olive ; lorsqu’ils sont dorés on ajoute les petites courgettes coupées en rondelles, le vin blanc, le sel et le poivre. On met un couvercle sur la sauteuse, on passe à feu doux et on oublie pendant quelques minutes. Lorsque les courgettes ont transpiré, on « touille » avec délicatesse, on remet le couvercle et on oublie un peu plus longtemps. Lorsque les courgettes paraissent à peu près cuites, on enlève le couvercle, on passe à feu vif, on touille et on retouille consciencieusement jusqu’à ce que le mélange soit rissolé à point. Variante : on peut ajouter des cubes de poivron rouge, mais en dose raisonnable. Précision : on « oublie » pour un cuisinier, cela ne veut pas dire que l’on est frappé d’amnésie et que l’on part regarder un long métrage à la télévision. Cela veut simplement dire que l’on peut faire autre chose, en conservant ses narines en activité de surveillance (à moins que l’on ne dispose d’un drone possédant un capteur olfactif).
Tian de courgettes à la mode de chez nous – La base de la recette est la même que la précédente, sans curry, sans vin blanc, avec un peu de noix de muscade en option. Lorsque les courgettes ont bien mijoté et rendu leur eau, on les tasse bien comme il faut au fond de la sauteuse avec une cuillère, de façon à former une galette plutôt compacte. Dans un petit saladier, on prépare un flan tout simple : on mélange deux œufs et un verre de lait avec une fourchette, puis l’on verse la préparation sur les courgettes, sans changer de récipient. On place un couvercle sur la sauteuse puis on laisse cuire à feu doux jusqu’à ce que le flan ait pris au centre du plat. Cette préparation succulente peut se déguster chaude, tiède ou froide, avec ou sans sauce tomate en accompagnement. Démocratique n’est-ce pas ?
Tian de courgettes au four – Une fois les courgettes cuites selon la méthode n°1, on leur ajoute un mélange œuf (2), yaourt (un pot), farine (deux cuillères rases) ou mieux un verre de flocons de céréales (blé, épeautre ou mélange). Cette fois, l’épice dominante pour agrémenter le plat, ce sera du paprika. On ajoute aussi du Comté rapé, de la tomme d’Abondance ou du gruyère suisse (Alpenzell, délicieux). On verse le mélange soigneusement malaxé dans un plat à gratin et l’on fait dorer à four chaud (220 ° mais éviter le grill). Petite touche originale : ajouter deux ou trois cuillères de graines de sésame à la surface du gratin…
 Tian de courgettes au four (variante sophistiquée) – Au lieu de pré-cuire les bébés courgettes comme dans la recette précédente, on les coupe en rondelles fines que l’on dispose dans un plat, en reconstituant artistiquement chaque fruit, c’est à dire en replaçant la rondelle à l’emplacement exact où on l’a trouvée en entrant dans la pièce. On remplit ainsi avec habileté un plat à gratin un peu grand, mais pas trop haut de bord, en veillant à ce qu’il n’y ait qu’une couche de rondelles (inutile de placer des rondelles métalliques ou des joints de plombier pour séparer les fruits, cela ajoute à l’esthétique mais pas au goût). Si l’on a vraiment une âme d’artiste, on peut réaliser une très jolie déco en intercalant des lanières de poivron rouge. Limitez vous à des effets relativement simples car vos invités seront là dans quelques minutes… On verse alors sur le gratin un mélange type flan, assez liquide, mais dans lequel on aura pris soin d’incorporer une cuillère ou deux de maïzena histoire d’absorber un peu le liquide rendu en cours de cuisson. Le plat va cuire doucement à four moyen. Une trop grande chaleur initiale dessèche le mélange et donne un affreux goût de brûlé aux courgettes sacrées.
Tian de courgettes au four (variante sophistiquée) – Au lieu de pré-cuire les bébés courgettes comme dans la recette précédente, on les coupe en rondelles fines que l’on dispose dans un plat, en reconstituant artistiquement chaque fruit, c’est à dire en replaçant la rondelle à l’emplacement exact où on l’a trouvée en entrant dans la pièce. On remplit ainsi avec habileté un plat à gratin un peu grand, mais pas trop haut de bord, en veillant à ce qu’il n’y ait qu’une couche de rondelles (inutile de placer des rondelles métalliques ou des joints de plombier pour séparer les fruits, cela ajoute à l’esthétique mais pas au goût). Si l’on a vraiment une âme d’artiste, on peut réaliser une très jolie déco en intercalant des lanières de poivron rouge. Limitez vous à des effets relativement simples car vos invités seront là dans quelques minutes… On verse alors sur le gratin un mélange type flan, assez liquide, mais dans lequel on aura pris soin d’incorporer une cuillère ou deux de maïzena histoire d’absorber un peu le liquide rendu en cours de cuisson. Le plat va cuire doucement à four moyen. Une trop grande chaleur initiale dessèche le mélange et donne un affreux goût de brûlé aux courgettes sacrées.
Courgettes farcies – ce plat se réalise avec des courgettes longues de taille moyenne (5-6 cm) dont la peau doit être encore bien tendre (elle se perce facilement avec un ongle). On coupe les courgettes en deux dans le sens de la longueur et on enlève le cœur (graines et fibres) avec une cuillère. Si l’on a du temps devant soi, on met un peu de gros sel sur chaque demi courgette et on leur fait rendre leur eau pendant une heure environ. On peut profiter de ce répit pour préparer une farce succulente. De nombreuses options sont possibles, végétariennes ou non. On peut reprendre le même type de mélange que pour des tomates farcies : riz cuit, viande de bœuf, chair à saucisse, épices… ou en profiter pour innover un peu. Les farces à base de quinoa pré-cuite ou de flocons de céréales variées sont délicieuses. Si l’on choisit une option végétarienne, on peut ajouter du fromage de chèvre écrasé ou émietté, du tofu (bof !), ou simplement des œufs et des épices variées. Il faut veiller à ce que la farce soit suffisamment compacte pour qu’on puisse former une sorte de quenelle à disposer sur chaque courgette. Si l’on a été trop généreux en liquide (eau pour le gonflage des flocons, lait ou yaourt) la farce va s’étaler puis déborder de son support. La cuisson se fait au four à température moyenne et elle doit être assez longue. Le plat est prêt lorsque la farce est légèrement dorée et que la pointe du couteau pénètre facilement dans le légume. Les courgettes rondes sont souvent utilisées pour ce type de préparation, mais comme c’est d’un « classique » et d’une « banalité » navrante, j’ai préféré vous proposer l’option courgette longue.
 Gratin de courgettes – La meilleure façon d’utiliser ce légume lorsqu’il est gros. Dans ce cas, mieux vaut peler et égrainer les fruits. on les coupe en morceaux que l’on fait cuire à l’étouffé (rappel = sans eau), à feu doux, juste avec un peu de sel. Cela prend un certain temps pour que les cubes s’écrasent facilement à la fourchette et que l’eau en excédent s’évapore. Plutôt que d’utiliser une hotte, ouvrez plutôt la porte de votre cuisine (ou la fenêtre) ; la vapeur d’eau s’échappant de la marmite pourra alors librement monter au ciel. Arrivée dans la haute atmosphère, elle se condensera, formera des nuages et, lorsque les conditions jugées nécessaires par les météorologues de météo France seront réunies, il pleuvra des courgettes… On peut aussi égoutter ses courgettes cuites dans une passoire et perdre ainsi une partie du précieux liquide qui les compose. Sachez que dans ce cas vous perdez une bonne partie des sels minéraux que contient ce légume généreux. Mieux vaut faire réduire un peu et préparer une liaison plus épaisse si la purée est très aqueuse. En ce qui concerne la liaison, eh bien on fabrique une pâte à crêpes un peu épaisse en mélangeant 4 œufs, un verre de farine et du lait (en quantité variable selon la texture dont on a besoin pour épaissir la pâte – ça c’est le coup de main du cuistot). On mélange soigneusement courgettes et liaison, sans employer de mixer : le simple fait d’ajouter la farine change la consistance. On verse dans un plat à gratin ; on ajoute l’un des délicieux fromages rapés mentionnés dans un paragraphe antérieur ; on fait cuire à four chaud jusqu’à ce que la croûte soit dorée. Selon le goût de chacun on peut ajouter différentes épices : noix de muscade, cannelle, cumin, poivre ou paprika agrémentent agréablement le gratin (grr ! grr ! grr ! difficile à prononcer, heureusement qu’il s’agit là d’une transmission de savoir par écrit…).
Gratin de courgettes – La meilleure façon d’utiliser ce légume lorsqu’il est gros. Dans ce cas, mieux vaut peler et égrainer les fruits. on les coupe en morceaux que l’on fait cuire à l’étouffé (rappel = sans eau), à feu doux, juste avec un peu de sel. Cela prend un certain temps pour que les cubes s’écrasent facilement à la fourchette et que l’eau en excédent s’évapore. Plutôt que d’utiliser une hotte, ouvrez plutôt la porte de votre cuisine (ou la fenêtre) ; la vapeur d’eau s’échappant de la marmite pourra alors librement monter au ciel. Arrivée dans la haute atmosphère, elle se condensera, formera des nuages et, lorsque les conditions jugées nécessaires par les météorologues de météo France seront réunies, il pleuvra des courgettes… On peut aussi égoutter ses courgettes cuites dans une passoire et perdre ainsi une partie du précieux liquide qui les compose. Sachez que dans ce cas vous perdez une bonne partie des sels minéraux que contient ce légume généreux. Mieux vaut faire réduire un peu et préparer une liaison plus épaisse si la purée est très aqueuse. En ce qui concerne la liaison, eh bien on fabrique une pâte à crêpes un peu épaisse en mélangeant 4 œufs, un verre de farine et du lait (en quantité variable selon la texture dont on a besoin pour épaissir la pâte – ça c’est le coup de main du cuistot). On mélange soigneusement courgettes et liaison, sans employer de mixer : le simple fait d’ajouter la farine change la consistance. On verse dans un plat à gratin ; on ajoute l’un des délicieux fromages rapés mentionnés dans un paragraphe antérieur ; on fait cuire à four chaud jusqu’à ce que la croûte soit dorée. Selon le goût de chacun on peut ajouter différentes épices : noix de muscade, cannelle, cumin, poivre ou paprika agrémentent agréablement le gratin (grr ! grr ! grr ! difficile à prononcer, heureusement qu’il s’agit là d’une transmission de savoir par écrit…).
Terrine de courgettes – Une façon plus raffinée encore d’utiliser la chair des grosses courgettes. De plus, ce plat a le mérite de se manger froid, ce qui est bien agréable en saison estivale. Pour débuter la préparation, il faut d’abord faire cuire les courgettes (même méthode que pour le gratin) puis leur faire rendre leur eau en les pressant dans une passoire. Inutile de vous dire qu’il faut une quantité importante de fruits pour obtenir un volume de purée correct. Un camion de courgettes doit procurer à peu près une brouette de matière sèche, ce qui explique que ce légume soit vivement recommandé dans le cas des régimes amincissants (par contre, gare aux ingrédients ajoutés dans nos préparations – l’Alpenzell ou la tomme d’Abondance ne figurent pas dans la bible des régimes minceur). Pendant que vos rondelles (de courgette) mijotent, mélangez 3 œufs, 1 yaourt et 100 à 150 g de mie de pain. Ajoutez votre préparation aux courgettes cuites, épicez (muscade, poivre, cumin) et malaxez bien. Remplissez un moule à cake puis faites cuire pendant 45 minutes à four moyen (180 ° c’est pas mal). Laissez refroidir puis mettez votre plat au réfrigérateur jusqu’au lendemain. Servez froid avec un coulis de tomate : c’est extra et vous m’en direz des nouvelles…
 Le créateur contempla son œuvre et s’aperçut qu’il vous avait dévoilé sept recettes différentes pour préparer ce divin légume : une pour chaque jour de la semaine. Certes, il n’avait pas parlé des tagliatelles de courgettes, de la soupe (froide ou chaude) ou du clafoutis aux courgettes et à la tomme de chèvre, mais chaque chose en son temps. Rien n’empêchait un addenda à cette brillante chronique pendant la décennie à venir… Le créateur se dit qu’il avait rendu grand service à l’humanité et qu’il méritait bien quarante jours de repos. Il soumit son charabia à sa correctrice préférée, puis s’empara d’une bière fraîche, d’un polar bien ficelé, et se livra sans vergogne à l’un de ses vices favoris. Chose odieuse s’il en est : il s’avérait, en page 47, que l’assassin avait dissimulé son arme dans une courgette opulente. Certains êtres abjects ne reculaient vraiment devant aucune pratique barbare… La sieste terminée, promis, le créateur écrirait au brillant Saint-Nicolas pour qu’il nous ponde une loi à ce sujet…
Le créateur contempla son œuvre et s’aperçut qu’il vous avait dévoilé sept recettes différentes pour préparer ce divin légume : une pour chaque jour de la semaine. Certes, il n’avait pas parlé des tagliatelles de courgettes, de la soupe (froide ou chaude) ou du clafoutis aux courgettes et à la tomme de chèvre, mais chaque chose en son temps. Rien n’empêchait un addenda à cette brillante chronique pendant la décennie à venir… Le créateur se dit qu’il avait rendu grand service à l’humanité et qu’il méritait bien quarante jours de repos. Il soumit son charabia à sa correctrice préférée, puis s’empara d’une bière fraîche, d’un polar bien ficelé, et se livra sans vergogne à l’un de ses vices favoris. Chose odieuse s’il en est : il s’avérait, en page 47, que l’assassin avait dissimulé son arme dans une courgette opulente. Certains êtres abjects ne reculaient vraiment devant aucune pratique barbare… La sieste terminée, promis, le créateur écrirait au brillant Saint-Nicolas pour qu’il nous ponde une loi à ce sujet…
NDLR – Merci aux marchands de graines potagères pour leur aimable participation à l’illustration de cette chronique culturelle. Ceux qui sont avides de culture maraichère et gastronomique peuvent aussi se rapporter au petit livre « Courgettes, je vous aime… », de Béatrice Vigot-Lagandré aux éditions du Sureau. C’est très complet ; il est dommage que l’auteure ne connaisse pas la courgette du Charbinat ; elle serait au bord de l’extase… Une seule réserve en ce qui me concerne : la confiture de courgettes… euh… permettez que je tape en touche !
9juin2010
Posté par Paul dans la catégorie : les histoires d'Oncle Paul; Petites histoires du temps passé.
« Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes, si d’ici à six heures, nous prononçons le nom de ton maître et le nôtre, le bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage. À cette condition, tu nous transporteras, à travers les airs, au lieu où nous voulons aller, et tu nous ramèneras de même au chantier ! Acabris ! Acabras ! Acabram !
Fais-nous voyager par-dessus les montagnes !
À peine avions-nous prononcé les dernières paroles que nous sentîmes le canot s’élever dans l’air à une hauteur de cinq ou six cents pieds…» (H. Beaugrand)
La chasse-galerie a commencé. Les hommes, un groupe de bûcherons canadiens, dont le camp de travail est situé loin dans le grand Nord du Québec, vont pouvoir aller rendre hommage à leur blonde dans un petit village de la vallée du Saint-Laurent. Pour une nuitée de bonheur et de rêve, ils ont confié leur âme au diable. Le canot d’écorce, ultra-léger, vogue dans les cieux, répondant avec souplesse aux vigoureux coups d’aviron des matelots de fortune qui le conduisent. La nuit sera longue ; le péril est grand ; la peur se lit sur leur visage. Dans ce pays où la religion pèse un poids considérable, ils sont en affaire avec le diable. Nombreux sont ceux qui ont tenté de faire comme eux et qui, selon la légende, bien vivante, de la « chasse-galerie », ont tout perdu à la dernière minute, aux premières lueurs de l’aube, oubliant dans leur affolement de respecter l’un des termes du marché qu’ils ont passé…

Ce thème de la chasse-galerie, très présent dans l’univers des contes et légendes au Québec, est en réalité connu dans différents autres pays mais sous d’autres appellations. L’expression québécoise désignant cette expédition dans les bras du diable, sur les ailes du vent, est sans doute originaire du centre de la France : Anjou, Poitou ou bien Saintonge. Dans le folklore de ces provinces françaises existent des mythes très proches, baptisés parfois chasse Gallery (peut-être à cause du nom d’un seigneur local), chasse-galerit ou chasse gallière. En Normandie, on parle de Menée-Hellequin… Galerie se rattacherait à des termes de l’ancien français ou de certains parlers régionaux évoquant le cheval. L’expression chasse-galerie, dans le centre de la France, évoquerait donc une chasse à courre céleste menée par des cavaliers : une troupe infernale parcourant le ciel pendant la nuit. Dans les Vosges, ce sont des musiciens invisibles qui arpentent le ciel et troublent le sommeil des paisibles terriens. La transposition du cheval au canot d’écorce semble être spécifique au folklore québécois, le fait de se déplacer dans une embarcation étant plus courant dans ce pays que dans le Poitou ! Plusieurs histoires de la tradition orale amérindienne font appel à un canoë volant. La chasse-galerie de la Belle province serait donc le produit d’un métissage de plusieurs légendes d’origines différentes. Ceci est une pratique courante dans le domaine des traditions populaires.
 Au Québec la version la plus connue de la chasse galerie a été rédigée par Honoré Beaugrand, en 1900 (brefs extraits tout au long de cette chronique *). Ce texte est à rapprocher d’une légende française racontant l’histoire d’un noble passionné de chasse. Il aimait tellement cette activité qu’un dimanche, il s’abstint d’aller à la messe pour ne pas manquer une partie. Il fut condamné à errer dans le ciel, poursuivi par une meute de chiens hurlants et de chevaux sauvages déchaînés. Depuis, on entend le passage de la meute dans le ciel, lorsque la tempête se déchaîne. Le récit d’Honoré Beaugrand commence lors d’une veillée. L’un des héros de l’histoire raconte son aventure, du temps de sa jeunesse, quand il ne craignait ni Dieu ni diable. C’était la veille du Jour de l’An… Les bûcherons étaient réunis dans la cambuse et le cuistot avait apporté un petit baril de rhum pour égayer la soirée. En pleine nuit, Joe, le récitant, est réveillé par Baptiste Durand, le boss des piqueurs. Celui-ci lui propose de l’accompagner dans sa virée pour aller voir sa blonde à plus de cent lieues du campement. Joe comprend très vite quel moyen compte utiliser Baptiste pour arriver à ses fins et il est plutôt inquiet…
Au Québec la version la plus connue de la chasse galerie a été rédigée par Honoré Beaugrand, en 1900 (brefs extraits tout au long de cette chronique *). Ce texte est à rapprocher d’une légende française racontant l’histoire d’un noble passionné de chasse. Il aimait tellement cette activité qu’un dimanche, il s’abstint d’aller à la messe pour ne pas manquer une partie. Il fut condamné à errer dans le ciel, poursuivi par une meute de chiens hurlants et de chevaux sauvages déchaînés. Depuis, on entend le passage de la meute dans le ciel, lorsque la tempête se déchaîne. Le récit d’Honoré Beaugrand commence lors d’une veillée. L’un des héros de l’histoire raconte son aventure, du temps de sa jeunesse, quand il ne craignait ni Dieu ni diable. C’était la veille du Jour de l’An… Les bûcherons étaient réunis dans la cambuse et le cuistot avait apporté un petit baril de rhum pour égayer la soirée. En pleine nuit, Joe, le récitant, est réveillé par Baptiste Durand, le boss des piqueurs. Celui-ci lui propose de l’accompagner dans sa virée pour aller voir sa blonde à plus de cent lieues du campement. Joe comprend très vite quel moyen compte utiliser Baptiste pour arriver à ses fins et il est plutôt inquiet…
« Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d’aller embrasser ma blonde au village. C’était raide ! Il était bien vrai que j’étais un peu ivrogne et débauché et que la religion ne me fatiguait pas à cette époque, mais risquer de vendre mon âme au diable, ça me surpassait.
– Cré poule mouillée ! continua Baptiste, tu sais bien qu’il n’y a pas de danger. Il s’agit d’aller à Lavaltrie et de revenir dans six heures. Tu sais bien qu’avec la chasse-galerie, on fait au moins cinquante lieues à l’heure quand on sait manier l’aviron comme nous. Il s’agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet, et de ne pas s’accrocher aux croix des clochers en voyageant. C’est facile à faire et pour éviter tout danger, il faut penser à ce qu’on dit, avoir l’œil où l’on va et ne pas prendre de boisson en route. J’ai fait le voyage cinq fois et tu vois bien qu’il ne m’est jamais arrivé malheur. Allons, mon vieux, prends ton courage à deux mains et si le cœur t’en dit, dans deux heures de temps, nous serons à Lavaltrie. Pense à la petite Liza Guimbette, et au plaisir de l’embrasser. Nous sommes déjà sept pour faire le voyage, mais il faut être deux, quatre, six ou huit, et tu seras le huitième. »
L’histoire se déroule plutôt bien, si ce n’est qu’au cours de la nuit Baptiste boit plus que de raison et qu’il n’est plus capable de diriger l’embarcation. Le canot s’écrase dans un banc de neige molle de la montagne de Montréal. Les sept autres membres de l’équipage sont obligés de maitriser, ligoter et bâillonner l’ivrogne qui ne rêve plus que de chopes à vider et de bonnes rencontres. Le canot décolle à nouveau et remonte la rivière Outaouais jusqu’à la Pointe-à-Gatineau. Au moment d’arriver à bon port, le Baptiste défait ses liens et commence à hurler diverses imprécations, jurant et sacrant avec la pire des grossièretés sans que ses coéquipiers n’arrivent à le maitriser à nouveau. Le canot s’enfonce dans la neige non loin du campement, et, sous la violence du choc, les « matelots » s’évanouissent. Joe se réveille dans son lit quelques heures plus tard. Nul n’a pipé mot sur cette étrange équipée, et les compagnons de bûche sont persuadés d’avoir retrouvé la fine équipe d’ivrognes en train de cuver son rhum dans la neige…
« Tout ce que je puis vous dire, mes amis, c’est que ce n’est pas si drôle qu’on le pense que d’aller voir sa blonde en canot d’écorce, en plein cœur d’hiver, en courant la chasse-galerie ; surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. Si vous m’en croyez, vous attendrez à l’été prochain pour aller embrasser vos petits cœurs, sans courir le risque de voyager au profit du diable. »
 Dans le répertoire folklorique français, la version originelle de cette histoire n’est plus guère présente, mais il faut dire que la renaissance de la pratique du conte est relativement récente, du moins en tant qu’activité destinée à des adultes. Il n’en est pas de même au Québec où certains pans de la tradition restent bien vivants. De nombreux conteurs québécois ont retravaillé et raconté cette légende de la « chasse-galerie » à leur gré, prenant soin d’en créer un grand nombre de variantes. La version racontée par Jocelyn Bérubé, artiste aux multiples talents, est particulièrement plaisante à lire et à entendre. La chasse-galerie, comme l’indique Bérubé, « n’a pas fait couler beaucoup d’encre sur le papier, mais a brassé beaucoup de salive dans la bouche des conteurs d’ici » ! Mais ce n’est pas tout ! Le « maudit canot » est apprécié dans bien des domaines ! On le retrouve par exemple sur l’étiquette d’une bière délicieuse, « la Maudite », très appréciée au Québec… Un manège du parc d’attraction La Ronde à Montréal, appelé « la Pitoune » (buche de bois) est basé sur cette histoire. Plusieurs poètes et musiciens ont sans doute été inspirés à la fois par les récits des anciens et par la consommation du breuvage brassé à Chambly. Vous pouvez écouter par exemple la chanson de Michel Rivard, « Martin de la chasse galerie » interprétée par le groupe de musique traditionnelle « la bottine souriante » (album « le Mistrine »). D’autres groupes en proposent une interprétation personnalisée.
Dans le répertoire folklorique français, la version originelle de cette histoire n’est plus guère présente, mais il faut dire que la renaissance de la pratique du conte est relativement récente, du moins en tant qu’activité destinée à des adultes. Il n’en est pas de même au Québec où certains pans de la tradition restent bien vivants. De nombreux conteurs québécois ont retravaillé et raconté cette légende de la « chasse-galerie » à leur gré, prenant soin d’en créer un grand nombre de variantes. La version racontée par Jocelyn Bérubé, artiste aux multiples talents, est particulièrement plaisante à lire et à entendre. La chasse-galerie, comme l’indique Bérubé, « n’a pas fait couler beaucoup d’encre sur le papier, mais a brassé beaucoup de salive dans la bouche des conteurs d’ici » ! Mais ce n’est pas tout ! Le « maudit canot » est apprécié dans bien des domaines ! On le retrouve par exemple sur l’étiquette d’une bière délicieuse, « la Maudite », très appréciée au Québec… Un manège du parc d’attraction La Ronde à Montréal, appelé « la Pitoune » (buche de bois) est basé sur cette histoire. Plusieurs poètes et musiciens ont sans doute été inspirés à la fois par les récits des anciens et par la consommation du breuvage brassé à Chambly. Vous pouvez écouter par exemple la chanson de Michel Rivard, « Martin de la chasse galerie » interprétée par le groupe de musique traditionnelle « la bottine souriante » (album « le Mistrine »). D’autres groupes en proposent une interprétation personnalisée.
En voici les premières paroles…
« Vous connaissez l’histoire
Nous bûchions au chantier
Loin de nos êtres chers
Dix gars bien esseulés.
Dans notre désespoir
Le soir du jour de l’An
Nous avons fait, ciboère!
Un pacte avec Satan!
Dans le ciel du pays
Le canot fendit l’air
Et nous mena, ravis
Aux maisons de nos pères!
Toute la nuit, en famille
Nous pûmes rire et boire
Mais sans toucher aux filles
Le diable veut rien savoir !… »
De nos jours, il est de plus en plus rare de voir passer ce canot infernal dans le ciel illuminé des grandes villes. Les habitants de Montréal et de Québec ont plus de chance de voir l’un des multiples avions survoler la belle province qu’un léger canoë en écorce de bouleau. Eh pourtant ? Qui sait si de mystérieuses embarcations ne sillonnent pas encore le ciel là-bas ou bien ici ? Qui peut affirmer que les longues trainées blanches que l’on aperçoit certains soirs de pleine lune déchirant le bleu sombre du ciel ne sont pas les traces ondoyantes de voyageurs aussi mystérieux que pressés ? Passer une soirée dans les bras de sa blonde, lorsque l’on ne l’a pas vue depuis des jours et des jours, cela vaut bien la peine que l’on brade son âme. Et puis, que deviendrait le diable si personne n’alimentait son petit commerce… On s’ennuie ici bas ; heureusement qu’il y a l’enfer pour alimenter nos fantasmes…
Notes : (*) disponible en intégralité sur Wikisource.
3juin2010
Posté par Paul dans la catégorie : Carnets de voyage.
 La tombe se dresse face à nos yeux, imposante sculpture taillée dans le roc. Elle fait partie de la nécropole de Sovana et date du IIIème siècle av. JC. « Ilbebranda », le nom me fait penser, sur le coup, à une mystérieuse princesse, étrusque comme il se doit… Ce n’est pas le cas, mais j’ai gardé cette vision romantique du site jusqu’à ce qu’un complément d’information vienne changer ma perception des choses. Un couloir s’enfonce dans le sol, au pied de la colline et deux escaliers s’élèvent de part et d’autre d’un édifice étrange, aux formes estompées par l’usure du temps, mais évoquant sans trop de doutes un temple soutenu par une série de colonnes. Nous n’avons pas le temps d’explorer les lieux comme nous le voudrions : la nuit tombe, nous sommes arrivés trop tard. Nous reviendrons car nous n’avons fait qu’effleurer l’ambiance mystérieuse qui entoure ce décor étrange. Nous avons visité plusieurs autres nécropoles au cours de l’après-midi et nous avons largement pris notre temps de façon à découvrir les sites les plus reculés. Une heure auparavant nous étions au pied de la tombe de la Sirène à Soprapipa. Nous avons été surpris par la variété des styles employés dans les différentes sépultures réparties sur les collines entourant Sovana : cubes, édicules, temples… La plupart des emplacements sont entourés d’une riche végétation et il faut un certain temps pour distinguer ce qui a été réalisé par la main de l’homme des formes étranges que la nature a elle-même sculptées dans les rochers.
La tombe se dresse face à nos yeux, imposante sculpture taillée dans le roc. Elle fait partie de la nécropole de Sovana et date du IIIème siècle av. JC. « Ilbebranda », le nom me fait penser, sur le coup, à une mystérieuse princesse, étrusque comme il se doit… Ce n’est pas le cas, mais j’ai gardé cette vision romantique du site jusqu’à ce qu’un complément d’information vienne changer ma perception des choses. Un couloir s’enfonce dans le sol, au pied de la colline et deux escaliers s’élèvent de part et d’autre d’un édifice étrange, aux formes estompées par l’usure du temps, mais évoquant sans trop de doutes un temple soutenu par une série de colonnes. Nous n’avons pas le temps d’explorer les lieux comme nous le voudrions : la nuit tombe, nous sommes arrivés trop tard. Nous reviendrons car nous n’avons fait qu’effleurer l’ambiance mystérieuse qui entoure ce décor étrange. Nous avons visité plusieurs autres nécropoles au cours de l’après-midi et nous avons largement pris notre temps de façon à découvrir les sites les plus reculés. Une heure auparavant nous étions au pied de la tombe de la Sirène à Soprapipa. Nous avons été surpris par la variété des styles employés dans les différentes sépultures réparties sur les collines entourant Sovana : cubes, édicules, temples… La plupart des emplacements sont entourés d’une riche végétation et il faut un certain temps pour distinguer ce qui a été réalisé par la main de l’homme des formes étranges que la nature a elle-même sculptées dans les rochers.
 Le programme de la journée du lendemain est conçu de manière à ne pas renouveler la même erreur. Il faut du temps pour arpenter la nécropole de Poggo Felceto qui est un élément essentiel de l’ensemble funéraire situé aux environs de Sovana. Après avoir consacré le délai nécessaire à la visite des villages de Pitigliano et de Saturnia (incontournable baignade dans les eaux chaudes des termes), nous sommes prêts à rendre à nouveau hommage à Ildebranda. Le nom a été donné à cette tombe, en hommage au moine Ildebrando, né au début du XIème siècle, futur pape Grégoire VII et découvreur du site. Une fouille méthodique des lieux a été conduite à partir de 1925 et a permis une reconstitution graphique à peu près complète du monument. Celui-ci comprend deux parties distinctes, la chambre funéraire située dans la partie basse et un podium surélevé consacré à la mémoire du défunt, accessible par deux escaliers latéraux. C’est cette partie haute qui était la plus richement décorée. Elle avait l’apparence d’un fronton de temple grec avec une douzaine de colonnes sculptées dans la masse du rocher. De toutes les nécropoles étrusques que nous avons visitées, c’est certainement l’une des plus ouvragées. La chambre mortuaire ne comporte qu’un seul socle : ce tombeau n’a donc abrité qu’un seul défunt. Compte tenu de l’importance de l’édifice, il est évident qu’il s’agissait d’un notable. Les restes d’une frise, ornementation constituée de représentations d’animaux et de plantes, sont encore visibles au dessus de la colonnade sculptée en façade. Les Etrusques aimaient les couleurs vives, mais ce genre de détail artistique n’est malheureusement plus perceptible.
Le programme de la journée du lendemain est conçu de manière à ne pas renouveler la même erreur. Il faut du temps pour arpenter la nécropole de Poggo Felceto qui est un élément essentiel de l’ensemble funéraire situé aux environs de Sovana. Après avoir consacré le délai nécessaire à la visite des villages de Pitigliano et de Saturnia (incontournable baignade dans les eaux chaudes des termes), nous sommes prêts à rendre à nouveau hommage à Ildebranda. Le nom a été donné à cette tombe, en hommage au moine Ildebrando, né au début du XIème siècle, futur pape Grégoire VII et découvreur du site. Une fouille méthodique des lieux a été conduite à partir de 1925 et a permis une reconstitution graphique à peu près complète du monument. Celui-ci comprend deux parties distinctes, la chambre funéraire située dans la partie basse et un podium surélevé consacré à la mémoire du défunt, accessible par deux escaliers latéraux. C’est cette partie haute qui était la plus richement décorée. Elle avait l’apparence d’un fronton de temple grec avec une douzaine de colonnes sculptées dans la masse du rocher. De toutes les nécropoles étrusques que nous avons visitées, c’est certainement l’une des plus ouvragées. La chambre mortuaire ne comporte qu’un seul socle : ce tombeau n’a donc abrité qu’un seul défunt. Compte tenu de l’importance de l’édifice, il est évident qu’il s’agissait d’un notable. Les restes d’une frise, ornementation constituée de représentations d’animaux et de plantes, sont encore visibles au dessus de la colonnade sculptée en façade. Les Etrusques aimaient les couleurs vives, mais ce genre de détail artistique n’est malheureusement plus perceptible.
 Nous sommes au début du mois de novembre ; la saison touristique est pratiquement terminée et les visiteurs ne se bousculent pas dans ces lieux un peu sinistres. Le soleil rend un peu plus angoissant le trou noir qui s’ouvre au pied de la falaise. L’envie est plus grande d’emprunter l’un des deux escaliers qui permettent de grimper vers le haut de l’édifice et d’en faire le tour. Nous n’hésitons pas cependant à descendre dans le sous sol ; il est tôt dans l’après-midi et les fantômes ne sont pas encore réveillés. Je me demande ce qui se serait passé si nous avions prolongé notre visite la veille au soir. Qui était l’occupant de ces lieux, puisqu’il ne s’agit point d’une jeune princesse morte d’un chagrin d’amour ? Riche marchand, notable au fait de sa gloire, prince à l’ambition démesurée ? D’après tous les documents que j’ai consultés, rien ne permet de le savoir. Beaucoup de choses restent à découvrir en ce qui concerne cette civilisation des Etrusques. Peut-être cela explique-t-il l’attrait irrésistible qu’elle exerce sur certains amateurs d’histoire.
Nous sommes au début du mois de novembre ; la saison touristique est pratiquement terminée et les visiteurs ne se bousculent pas dans ces lieux un peu sinistres. Le soleil rend un peu plus angoissant le trou noir qui s’ouvre au pied de la falaise. L’envie est plus grande d’emprunter l’un des deux escaliers qui permettent de grimper vers le haut de l’édifice et d’en faire le tour. Nous n’hésitons pas cependant à descendre dans le sous sol ; il est tôt dans l’après-midi et les fantômes ne sont pas encore réveillés. Je me demande ce qui se serait passé si nous avions prolongé notre visite la veille au soir. Qui était l’occupant de ces lieux, puisqu’il ne s’agit point d’une jeune princesse morte d’un chagrin d’amour ? Riche marchand, notable au fait de sa gloire, prince à l’ambition démesurée ? D’après tous les documents que j’ai consultés, rien ne permet de le savoir. Beaucoup de choses restent à découvrir en ce qui concerne cette civilisation des Etrusques. Peut-être cela explique-t-il l’attrait irrésistible qu’elle exerce sur certains amateurs d’histoire.

 Nous quittons Poggo Felceto pour nous retrouver très vite dans un autre lieu étrange : la via cava de San Sebastiano. Nous parcourons plusieurs centaines de mètres à pied sur un chemin étroit qui s’enfonce entre deux falaises élevées. Ce n’est pas notre premier contact avec les voies excavées ; nous en avons déjà parcouru plusieurs la veille. Elles sont nombreuses dans cette région de la vallée de la Fiora. Elles datent du temps des Etrusques, mais ont été utilisées longtemps après, pendant l’occupation romaine et jusqu’au Moyen-Âge. Durant cette période, les voyageurs qui les empruntaient devaient sans doute avoir quelques angoisses à surmonter car, en différents points, l’on trouve des représentations de la Vierge censées éloigner les « mauvais » esprits des lieux. Une quinzaine de fragments de ces « vie cave » subsistent à notre époque. Elles étaient intégrées, à l’époque romaine, à la via Clodia reliant Rome à Saturnia.
Nous quittons Poggo Felceto pour nous retrouver très vite dans un autre lieu étrange : la via cava de San Sebastiano. Nous parcourons plusieurs centaines de mètres à pied sur un chemin étroit qui s’enfonce entre deux falaises élevées. Ce n’est pas notre premier contact avec les voies excavées ; nous en avons déjà parcouru plusieurs la veille. Elles sont nombreuses dans cette région de la vallée de la Fiora. Elles datent du temps des Etrusques, mais ont été utilisées longtemps après, pendant l’occupation romaine et jusqu’au Moyen-Âge. Durant cette période, les voyageurs qui les empruntaient devaient sans doute avoir quelques angoisses à surmonter car, en différents points, l’on trouve des représentations de la Vierge censées éloigner les « mauvais » esprits des lieux. Une quinzaine de fragments de ces « vie cave » subsistent à notre époque. Elles étaient intégrées, à l’époque romaine, à la via Clodia reliant Rome à Saturnia.
Certaines de ces voies sont très étroites, permettant juste le croisement de deux piétons ; d’autres sont plus larges, soit parce que le contexte le permettait, soit parce qu’elles ont été mises aux normes romaines et permettaient le passage des chars. Les tracés sont sinueux… Lorsque c’était possible, les bâtisseurs ont exploité des failles naturelles, suivant le lit de petits cours d’eau, mais certains tronçons, parfois bordés de falaises d’une vingtaine de mètres, ont été totalement creusés à la main. On peut s’interroger sur les raisons d’un tel travail. La réponse semble être double d’après ce que nous avons pu découvrir : accélérer la circulation en facilitant le passage entre deux vallons, mais aussi assurer la défense en interdisant une approche trop facile de certains villages. Il est plus aisé de contrôler et de barrer un passage de deux ou trois mètres de large qu’une voie sans limites dans les hauteurs. La région magnifique du « valle dei fiori » attisait les convoitises des Romains, mais ils n’étaient pas les seuls visiteurs indésirables. Des pillards débarquaient aussi régulièrement sur la côte toute proche (ce qui explique en partie les villages perchés sur des plateaux escarpés).
 Via San Sebastiano… encore un lieu dont nous sommes les seuls visiteurs à cette heure tardive. Nous prenons longuement le temps de l’explorer. Elle doit son nom à un oratoire abandonné, construit sur le bord du chemin. La lumière est magnifique. Le soleil décline à l’horizon et les ombres envahissent peu à peu le paysage. Nous n’avons aucun mal à nous mettre dans la peau d’un personnage de l’époque : paysan rentrant du champ ou colporteur déambulant d’un village à un autre. De temps en temps nous lançons un coup d’œil inquiet vers le haut de la falaise, mais nul danger ne nous guette. La végétation, accrochée à la falaise, dissimule une grande partie de notre progression. Il est difficile de nous voir depuis le haut du plateau. Le seul risque que nous courrons c’est de trainer trop longtemps et d’arriver en retard pour notre collation du soir. Nous avons établi notre camp de base à Bolsène, au bord du lac du même nom. Depuis quelques jours nous explorons cette région magnifique à la limite entre l’Ombrie, la Toscane et le Latium, autrefois partie intégrante du royaume des Etrusques… Sorano, Sovana, Pitigliano, Orvieto, Saturnia, autant de noms qui me font encore rêver : villages bâtis sur de hauts plateaux rocheux, dédales de ruelles dans lesquels on se perd sans cesse, petites épiceries aux senteurs épicées évoquant déjà l’Orient alors que nous ne sommes qu’à quelques centaines de kilomètres de chez nous…
Via San Sebastiano… encore un lieu dont nous sommes les seuls visiteurs à cette heure tardive. Nous prenons longuement le temps de l’explorer. Elle doit son nom à un oratoire abandonné, construit sur le bord du chemin. La lumière est magnifique. Le soleil décline à l’horizon et les ombres envahissent peu à peu le paysage. Nous n’avons aucun mal à nous mettre dans la peau d’un personnage de l’époque : paysan rentrant du champ ou colporteur déambulant d’un village à un autre. De temps en temps nous lançons un coup d’œil inquiet vers le haut de la falaise, mais nul danger ne nous guette. La végétation, accrochée à la falaise, dissimule une grande partie de notre progression. Il est difficile de nous voir depuis le haut du plateau. Le seul risque que nous courrons c’est de trainer trop longtemps et d’arriver en retard pour notre collation du soir. Nous avons établi notre camp de base à Bolsène, au bord du lac du même nom. Depuis quelques jours nous explorons cette région magnifique à la limite entre l’Ombrie, la Toscane et le Latium, autrefois partie intégrante du royaume des Etrusques… Sorano, Sovana, Pitigliano, Orvieto, Saturnia, autant de noms qui me font encore rêver : villages bâtis sur de hauts plateaux rocheux, dédales de ruelles dans lesquels on se perd sans cesse, petites épiceries aux senteurs épicées évoquant déjà l’Orient alors que nous ne sommes qu’à quelques centaines de kilomètres de chez nous…
 J’espère que cette brève évocation d’un voyage maintenant ancien (cinq ans) dont les souvenirs sont encore très présents dans ma mémoire, aura éveillé votre intérêt ou tout au moins votre curiosité. Je n’ai guère l’habitude dans ces « carnets de voyage » de parler du passé, mais, ces derniers temps, les circonstances un peu particulières expliquent ma démarche. Depuis quelques mois nous n’avons plus quitté notre petit royaume et il est des petits matins où l’envie de poser mes pas dans des ornières inconnues me démange. Un coup d’œil dans les albums de photos, un détour avant-hier dans le rayon « voyage » d’une librairie, et c’est fait : mon esprit vagabonde… Mes mains fouillent la terre du jardin mais ma tête cherche de nouveaux itinéraires !
J’espère que cette brève évocation d’un voyage maintenant ancien (cinq ans) dont les souvenirs sont encore très présents dans ma mémoire, aura éveillé votre intérêt ou tout au moins votre curiosité. Je n’ai guère l’habitude dans ces « carnets de voyage » de parler du passé, mais, ces derniers temps, les circonstances un peu particulières expliquent ma démarche. Depuis quelques mois nous n’avons plus quitté notre petit royaume et il est des petits matins où l’envie de poser mes pas dans des ornières inconnues me démange. Un coup d’œil dans les albums de photos, un détour avant-hier dans le rayon « voyage » d’une librairie, et c’est fait : mon esprit vagabonde… Mes mains fouillent la terre du jardin mais ma tête cherche de nouveaux itinéraires !

 Le 22 novembre 1889, une journaliste américaine de 25 ans rencontre l’écrivain Jules Verne à Amiens. Ce rendez-vous est programmé depuis plusieurs semaines déjà. La jeune femme a embarqué le 14 novembre à New York, à bord du paquebot Augusta Victoria, s’est arrêtée à Londres puis a débarqué à Calais. Son départ des Etats-Unis s’est fait en tambour et trompette. Il faut dire qu’elle s’est fixé un objectif ambitieux pour l’époque : elle a lancé le pari qu’elle ferait mieux que Phileas Fogg, le héros de l’écrivain français, et réaliserait un tour du monde en moins de 80 jours, ce qui serait une première dans l’histoire. L’entrevue entre Nellie Bly et Jules Verne est très cordiale. La jeune femme lui fait part de ses espoirs, de ses projets. L’écrivain lui montre l’abondante documentation qu’il a rassemblée pour écrire son roman, et il est très ému de rencontrer celle qui va donner corps à son héros imaginaire. La seule déception du Français vient du fait que la jeune Américaine refuse de goûter à l’excellente bouteille qu’il a choisie dans sa cave à cette occasion. Miss Bly n’aime pas l’alcool ! Cela ne l’empêche pas de prodiguer de nombreux encouragements à la jeune aventurière lors de son départ, le lendemain. Cette rencontre marque l’écrivain au point qu’il décide que les héros de son prochain roman seront américains, et il se lance dans la rédaction de « Mistress Branigan », l’épopée d’une femme qui part à la recherche de son mari, disparu en mer… Jules Verne est informé par des dépêches que lui adresse le journal new-yorkais, des progrès du tour du monde de Nellie Bly.
Le 22 novembre 1889, une journaliste américaine de 25 ans rencontre l’écrivain Jules Verne à Amiens. Ce rendez-vous est programmé depuis plusieurs semaines déjà. La jeune femme a embarqué le 14 novembre à New York, à bord du paquebot Augusta Victoria, s’est arrêtée à Londres puis a débarqué à Calais. Son départ des Etats-Unis s’est fait en tambour et trompette. Il faut dire qu’elle s’est fixé un objectif ambitieux pour l’époque : elle a lancé le pari qu’elle ferait mieux que Phileas Fogg, le héros de l’écrivain français, et réaliserait un tour du monde en moins de 80 jours, ce qui serait une première dans l’histoire. L’entrevue entre Nellie Bly et Jules Verne est très cordiale. La jeune femme lui fait part de ses espoirs, de ses projets. L’écrivain lui montre l’abondante documentation qu’il a rassemblée pour écrire son roman, et il est très ému de rencontrer celle qui va donner corps à son héros imaginaire. La seule déception du Français vient du fait que la jeune Américaine refuse de goûter à l’excellente bouteille qu’il a choisie dans sa cave à cette occasion. Miss Bly n’aime pas l’alcool ! Cela ne l’empêche pas de prodiguer de nombreux encouragements à la jeune aventurière lors de son départ, le lendemain. Cette rencontre marque l’écrivain au point qu’il décide que les héros de son prochain roman seront américains, et il se lance dans la rédaction de « Mistress Branigan », l’épopée d’une femme qui part à la recherche de son mari, disparu en mer… Jules Verne est informé par des dépêches que lui adresse le journal new-yorkais, des progrès du tour du monde de Nellie Bly.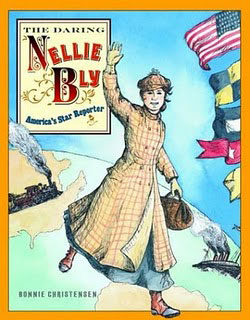 Au moment où son exploit l’amène sous la lumière des projecteurs, Nellie Bly a réussi quelques coups spectaculaires qui lui valent déjà une solide réputation parmi ses confrères. Le premier article qu’elle doit écrire pour le « New York World », journal appartenant à Joseph Pulitzer, a pour thème « la vie quotidienne dans un asile de fous réservé aux femmes ». Histoire de recueillir des informations directement à la source et non dans les bibliothèques comme le font nombre de ses confrères, la jeune journaliste décide de simuler une maladie mentale. Elle est internée pendant quelques temps au Blackwells Island Hospital, et peut ainsi témoigner, avec beaucoup de sincérité, des conditions de vie épouvantable des femmes qui sont enfermées dans ce lieu maudit. Son article provoque pas mal de remous et a sans doute comme conséquence directe le fait d’entrainer une sérieuse rénovation de l’institution et de ses pratiques cruelles. Elle aura recours à plusieurs reprises à ce procédé d’immersion pour rédiger ses reportages et cette façon de procéder, mise en valeur par un « talent de plume » indéniable va contribuer à faire d’elle une journaliste renommée. Sa destinée va être brillante, ce qui ne l’empêchera pas de continuer à s’intéresser au sort réservé aux plus humbles, plus particulièrement aux femmes qui luttent pour obtenir l’égalité des droits avec les hommes. La célébrité et la richesse ne l’empêchent pas de conserver une vision profondément sociale du monde. Ce qu’elle croyait à ses débuts, elle n’y a pas renoncé et va rester toute sa vie sur la même trajectoire idéologique, fait suffisamment rare pour être mentionné, la notoriété ayant tendance parfois à faire tourner la tête en direction des nuages.
Au moment où son exploit l’amène sous la lumière des projecteurs, Nellie Bly a réussi quelques coups spectaculaires qui lui valent déjà une solide réputation parmi ses confrères. Le premier article qu’elle doit écrire pour le « New York World », journal appartenant à Joseph Pulitzer, a pour thème « la vie quotidienne dans un asile de fous réservé aux femmes ». Histoire de recueillir des informations directement à la source et non dans les bibliothèques comme le font nombre de ses confrères, la jeune journaliste décide de simuler une maladie mentale. Elle est internée pendant quelques temps au Blackwells Island Hospital, et peut ainsi témoigner, avec beaucoup de sincérité, des conditions de vie épouvantable des femmes qui sont enfermées dans ce lieu maudit. Son article provoque pas mal de remous et a sans doute comme conséquence directe le fait d’entrainer une sérieuse rénovation de l’institution et de ses pratiques cruelles. Elle aura recours à plusieurs reprises à ce procédé d’immersion pour rédiger ses reportages et cette façon de procéder, mise en valeur par un « talent de plume » indéniable va contribuer à faire d’elle une journaliste renommée. Sa destinée va être brillante, ce qui ne l’empêchera pas de continuer à s’intéresser au sort réservé aux plus humbles, plus particulièrement aux femmes qui luttent pour obtenir l’égalité des droits avec les hommes. La célébrité et la richesse ne l’empêchent pas de conserver une vision profondément sociale du monde. Ce qu’elle croyait à ses débuts, elle n’y a pas renoncé et va rester toute sa vie sur la même trajectoire idéologique, fait suffisamment rare pour être mentionné, la notoriété ayant tendance parfois à faire tourner la tête en direction des nuages. Elisabeth Jane Cochran (Nellie Bly est le pseudonyme qu’elle utilisera pour signer ses articles) est née en Pennsylvanie le 5 mai 1864. Peu d’informations sont connues sur le début de sa vie. On sait par contre comment a débuté sa carrière de journaliste, puisqu’il s’agit d’un épisode plutôt original. Le journal local, le « Pittsburgh Dispatch » publie une chronique dont elle estime le contenu violemment sexiste. La jeune femme réagit vigoureusement à cet article en envoyant une lettre incendiaire au rédacteur en chef. Celui-ci apprécie le ton qu’emploie la jeune femme et surtout la haute tenue littéraire de sa missive. Il lui propose donc de collaborer régulièrement au journal, et lui offre ainsi une occasion de faire valoir son point de vue sur différents sujets d’actualité. Les articles de la nouvelle rédactrice (qui signe Nellie Bly, en faisant allusion à l’héroïne d’une chanson populaire du moment), ne laissent personne indifférent. La façon dont elle décrit les conditions de vie des ouvrières et des ouvriers de la région, l’ardeur de ses convictions féministes et surtout ses prises de positions enflammées lors des conflits sociaux, provoquent la colère des industriels locaux. Face à la levée de boucliers, et surtout au retrait des annonces payantes qui menacent la survie même du journal, le rédacteur en chef du « Pittsburgh Dispatch » propose à Nellie Bly de traiter de sujets plus consensuels, et, en fait, plus féminins. Voilà notre journaliste « sociale », reléguée aux pages maisons, cuisine et mode… ce qui ne lui convient guère ! Elle démissionne rapidement et part pour le Mexique, dans l’intention d’écrire des reportages sur la pauvreté des habitants et sur la corruption qui règne à tous les niveaux de l’administration. Cette fois-ci, c’est le gouvernement mexicain qui n’apprécie pas la teneur de ses textes et il lui est très vite signifié qu’elle est « persona non grata » dans le pays. Il n’est pas question pour elle de quémander quoi que ce soit en retournant à Pittsburgh. L’ambition ne lui manque pas, ni la détermination, et elle décide de s’installer à New York et de devenir journaliste au « New York World », dont elle apprécie le ton et l’indépendance relative des articles. Sa réussite est loin d’être assurée car le milieu journalistique est alors essentiellement masculin et il n’est pas évident pour une femme de percer dans la profession. Le reportage qu’elle écrit à ce moment là sur l’asile pour les femmes lui ouvre les portes du journal.
Elisabeth Jane Cochran (Nellie Bly est le pseudonyme qu’elle utilisera pour signer ses articles) est née en Pennsylvanie le 5 mai 1864. Peu d’informations sont connues sur le début de sa vie. On sait par contre comment a débuté sa carrière de journaliste, puisqu’il s’agit d’un épisode plutôt original. Le journal local, le « Pittsburgh Dispatch » publie une chronique dont elle estime le contenu violemment sexiste. La jeune femme réagit vigoureusement à cet article en envoyant une lettre incendiaire au rédacteur en chef. Celui-ci apprécie le ton qu’emploie la jeune femme et surtout la haute tenue littéraire de sa missive. Il lui propose donc de collaborer régulièrement au journal, et lui offre ainsi une occasion de faire valoir son point de vue sur différents sujets d’actualité. Les articles de la nouvelle rédactrice (qui signe Nellie Bly, en faisant allusion à l’héroïne d’une chanson populaire du moment), ne laissent personne indifférent. La façon dont elle décrit les conditions de vie des ouvrières et des ouvriers de la région, l’ardeur de ses convictions féministes et surtout ses prises de positions enflammées lors des conflits sociaux, provoquent la colère des industriels locaux. Face à la levée de boucliers, et surtout au retrait des annonces payantes qui menacent la survie même du journal, le rédacteur en chef du « Pittsburgh Dispatch » propose à Nellie Bly de traiter de sujets plus consensuels, et, en fait, plus féminins. Voilà notre journaliste « sociale », reléguée aux pages maisons, cuisine et mode… ce qui ne lui convient guère ! Elle démissionne rapidement et part pour le Mexique, dans l’intention d’écrire des reportages sur la pauvreté des habitants et sur la corruption qui règne à tous les niveaux de l’administration. Cette fois-ci, c’est le gouvernement mexicain qui n’apprécie pas la teneur de ses textes et il lui est très vite signifié qu’elle est « persona non grata » dans le pays. Il n’est pas question pour elle de quémander quoi que ce soit en retournant à Pittsburgh. L’ambition ne lui manque pas, ni la détermination, et elle décide de s’installer à New York et de devenir journaliste au « New York World », dont elle apprécie le ton et l’indépendance relative des articles. Sa réussite est loin d’être assurée car le milieu journalistique est alors essentiellement masculin et il n’est pas évident pour une femme de percer dans la profession. Le reportage qu’elle écrit à ce moment là sur l’asile pour les femmes lui ouvre les portes du journal. Le fait d’être devenue, quelques années plus tard, la « Phileas Fog » féminine, va influer sur le cours de sa vie, mais non sur ses idées, ainsi que je l’ai indiqué auparavant. En 1895 elle fait la connaissance d’un riche industriel, Robert Seaman, et devient son épouse. Elle renonce temporairement au journalisme pour se consacrer à sa nouvelle vie. Le mariage ne dure que neuf ans et, suite au décès de son compagnon, en 1904, elle se retrouve à la tête de son entreprise métallurgique et de sa fortune. Elle fait alors des choix de gestion plutôt singuliers pour la veuve d’un capitaine d’industrie, mais guère surprenants lorsque l’on sait à quel personnage on a affaire précisément. Nellie Bly décide de réformer fondamentalement le fonctionnement de son usine de fabrication de tôles. Elle supprime la rémunération à la pièce et introduit un salaire journalier indépendant de la productivité, et elle dépense une bonne part de ses capitaux pour réaliser des investissements sociaux dans l’entreprise : centre de loisirs, bibliothèque, club de pêche… Toutes ces « loufoqueries » sociales ne sont guère appréciées par ses pairs. La nouvelle patronne n’est pas une très bonne gestionnaire et la situation financière de l’usine devient catastrophique. Pour échapper aux pressions de ses créanciers, Nellie Bly quitte les Etats-Unis et se réfugie en Grande Bretagne. Elle décide de se consacrer à ce qui l’a fait vivre avant son mariage et qui est sa véritable passion : le journalisme. Nous sommes en 1914 et le monde est sur le point de basculer dans le chaos. Lorsque le conflit éclate, Nellie Bly devient correspondante de guerre. Jusqu’en 1919, elle se rend sur de nombreux fronts et publie une longue série de reportages sur la vie des soldats et l’évolution du conflit. La première guerre mondiale terminée, elle décide de tourner la page et de rentrer à New York. Elle devient collaboratrice au « New York Evening Journal » et consacre la quasi totalité de ses chroniques aux enfants abandonnés de la grande métropole. Elle meurt le 27 janvier 1922 des suites d’une pneumonie.
Le fait d’être devenue, quelques années plus tard, la « Phileas Fog » féminine, va influer sur le cours de sa vie, mais non sur ses idées, ainsi que je l’ai indiqué auparavant. En 1895 elle fait la connaissance d’un riche industriel, Robert Seaman, et devient son épouse. Elle renonce temporairement au journalisme pour se consacrer à sa nouvelle vie. Le mariage ne dure que neuf ans et, suite au décès de son compagnon, en 1904, elle se retrouve à la tête de son entreprise métallurgique et de sa fortune. Elle fait alors des choix de gestion plutôt singuliers pour la veuve d’un capitaine d’industrie, mais guère surprenants lorsque l’on sait à quel personnage on a affaire précisément. Nellie Bly décide de réformer fondamentalement le fonctionnement de son usine de fabrication de tôles. Elle supprime la rémunération à la pièce et introduit un salaire journalier indépendant de la productivité, et elle dépense une bonne part de ses capitaux pour réaliser des investissements sociaux dans l’entreprise : centre de loisirs, bibliothèque, club de pêche… Toutes ces « loufoqueries » sociales ne sont guère appréciées par ses pairs. La nouvelle patronne n’est pas une très bonne gestionnaire et la situation financière de l’usine devient catastrophique. Pour échapper aux pressions de ses créanciers, Nellie Bly quitte les Etats-Unis et se réfugie en Grande Bretagne. Elle décide de se consacrer à ce qui l’a fait vivre avant son mariage et qui est sa véritable passion : le journalisme. Nous sommes en 1914 et le monde est sur le point de basculer dans le chaos. Lorsque le conflit éclate, Nellie Bly devient correspondante de guerre. Jusqu’en 1919, elle se rend sur de nombreux fronts et publie une longue série de reportages sur la vie des soldats et l’évolution du conflit. La première guerre mondiale terminée, elle décide de tourner la page et de rentrer à New York. Elle devient collaboratrice au « New York Evening Journal » et consacre la quasi totalité de ses chroniques aux enfants abandonnés de la grande métropole. Elle meurt le 27 janvier 1922 des suites d’une pneumonie.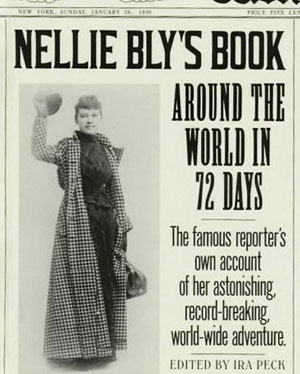 Figure marquante du féminisme américain, Nellie Bly est considérée, de nos jours, comme l’une des pionnières du journalisme d’investigation, n’hésitant pas à s’immerger dans la réalité sociale pour mieux en témoigner, ne reculant devant aucune prise de risque. Elle incarne une certaine image de la déontologie professionnelle que bien de ses confrères ou consœurs actuelles se devraient d’imiter quelque peu. Bien qu’elle n’ait jamais milité pour une idéologie politique particulière et n’ait jamais été membre d’aucun parti ou d’aucune organisation ouvrière, Nellie Bly a su montrer, tout au long de sa carrière, qu’elle était attachée à un idéal de justice et d’égalité, et qu’elle ne supportait pas la morgue des riches possédants et des hommes de pouvoir à leur solde. Elle a combattu l’oppression des femmes et des pauvres gens dans leur ensemble, avec les armes qui étaient les siennes : la plume, l’amour de la vérité et un courage indéniable dont elle a fait montre à de nombreuses occasions. A une époque où l’on voit certains journalistes de la presse écrite ou télévisée devenir de simples courroies de transmission du pouvoir, se contentant de recopier et/ou de répéter à n’en plus finir le contenu des dépêches d’agence, son histoire méritait d’être contée.
Figure marquante du féminisme américain, Nellie Bly est considérée, de nos jours, comme l’une des pionnières du journalisme d’investigation, n’hésitant pas à s’immerger dans la réalité sociale pour mieux en témoigner, ne reculant devant aucune prise de risque. Elle incarne une certaine image de la déontologie professionnelle que bien de ses confrères ou consœurs actuelles se devraient d’imiter quelque peu. Bien qu’elle n’ait jamais milité pour une idéologie politique particulière et n’ait jamais été membre d’aucun parti ou d’aucune organisation ouvrière, Nellie Bly a su montrer, tout au long de sa carrière, qu’elle était attachée à un idéal de justice et d’égalité, et qu’elle ne supportait pas la morgue des riches possédants et des hommes de pouvoir à leur solde. Elle a combattu l’oppression des femmes et des pauvres gens dans leur ensemble, avec les armes qui étaient les siennes : la plume, l’amour de la vérité et un courage indéniable dont elle a fait montre à de nombreuses occasions. A une époque où l’on voit certains journalistes de la presse écrite ou télévisée devenir de simples courroies de transmission du pouvoir, se contentant de recopier et/ou de répéter à n’en plus finir le contenu des dépêches d’agence, son histoire méritait d’être contée.
















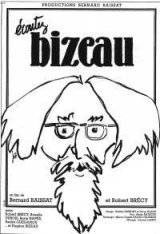



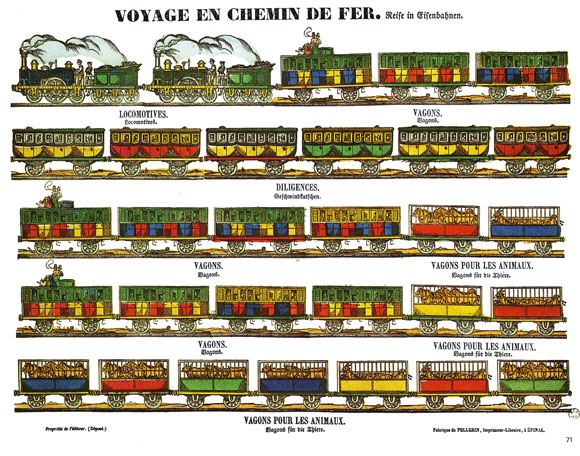









 La courgette est un légume facile à cultiver pour peu que l’on respecte quelques unes de ses exigences de base : une terre profonde, humide, et riche en humus ; des températures clémentes (inutile de semer ou de planter, tant que les températures descendent au dessous de 10° la nuit) et un arrosage régulier, au sol plutôt que par aspersion. Le plant de courgette est productif et ne nécessite aucune taille. Les bonnes années, on peut récolter (selon la taille à laquelle on effectue la cueillette) de cinq à dix kilos de fruits par pied. La courgette est un légume facile à cuisiner pourvu que l’on respecte quelques règles primordiales ; la principale d’entre-elles, qu’omettent beaucoup de cuisiniers inexpérimentés, c’est que ce fruit aux saveurs subtiles ne doit jamais cuire à grande eau, mais toujours à la vapeur ou à l’étouffée (le mieux). Les recettes proposées ci-après, varient selon la taille des fruits. On ne cuisine pas de la même manière petites et grosses courgettes. Les premières conservent leur peau et nécessitent une préparation minima avant cuisson ; les secondes doivent êtres épluchées et égrainées. La préparation des courgettes, dès lors que leur poids dépasse quelques centaines de grammes, ressemble fort à celle des courges. Nous en reparlerons. Une courgette bien fraiche est toujours plus savoureuse qu’un fruit ayant trainé à l’étalage ou en chambre froide. Sa peau doit être légèrement satinée, un peu duveteuse, un peu collante. En culture forcée (serre et engrais), ce fruit béni des dieux charbinois, perd les composantes les plus subtiles de son goût, notamment un léger goût de noisette. Avant d’allumer les feux et le four de votre cuisinière, sachez que les bébés courgettes peuvent être mangés crus (je sais, c’est cruel), assaisonnés, dans une salade mélangée, et qu’ils n’ont rien à envier, dans cet usage, à leur cousin concombre. Je ne vous apprendrai rien non plus je pense en vous rappelant que les fleurs (mâles de préférence, sinon vous n’aurez pas de fruit) permettent de confectionner de délicieux beignets, excellent élément de base pour un régime amaigrissant (je crois que je me laisse emporter par mon élan…). Il est temps que je vous livre, non point les quelques dizaines de recettes que je connais, mais quelques uns des fleurons de ma pratique culinaire en ce domaine. Pour en savoir plus, la meilleure solution c’est de vous inscrire à un stage gastronomique à la maison (tarif social, en fonction des revenus mensuels, donc plus élevé pour Mme Boutin – va de soi).
La courgette est un légume facile à cultiver pour peu que l’on respecte quelques unes de ses exigences de base : une terre profonde, humide, et riche en humus ; des températures clémentes (inutile de semer ou de planter, tant que les températures descendent au dessous de 10° la nuit) et un arrosage régulier, au sol plutôt que par aspersion. Le plant de courgette est productif et ne nécessite aucune taille. Les bonnes années, on peut récolter (selon la taille à laquelle on effectue la cueillette) de cinq à dix kilos de fruits par pied. La courgette est un légume facile à cuisiner pourvu que l’on respecte quelques règles primordiales ; la principale d’entre-elles, qu’omettent beaucoup de cuisiniers inexpérimentés, c’est que ce fruit aux saveurs subtiles ne doit jamais cuire à grande eau, mais toujours à la vapeur ou à l’étouffée (le mieux). Les recettes proposées ci-après, varient selon la taille des fruits. On ne cuisine pas de la même manière petites et grosses courgettes. Les premières conservent leur peau et nécessitent une préparation minima avant cuisson ; les secondes doivent êtres épluchées et égrainées. La préparation des courgettes, dès lors que leur poids dépasse quelques centaines de grammes, ressemble fort à celle des courges. Nous en reparlerons. Une courgette bien fraiche est toujours plus savoureuse qu’un fruit ayant trainé à l’étalage ou en chambre froide. Sa peau doit être légèrement satinée, un peu duveteuse, un peu collante. En culture forcée (serre et engrais), ce fruit béni des dieux charbinois, perd les composantes les plus subtiles de son goût, notamment un léger goût de noisette. Avant d’allumer les feux et le four de votre cuisinière, sachez que les bébés courgettes peuvent être mangés crus (je sais, c’est cruel), assaisonnés, dans une salade mélangée, et qu’ils n’ont rien à envier, dans cet usage, à leur cousin concombre. Je ne vous apprendrai rien non plus je pense en vous rappelant que les fleurs (mâles de préférence, sinon vous n’aurez pas de fruit) permettent de confectionner de délicieux beignets, excellent élément de base pour un régime amaigrissant (je crois que je me laisse emporter par mon élan…). Il est temps que je vous livre, non point les quelques dizaines de recettes que je connais, mais quelques uns des fleurons de ma pratique culinaire en ce domaine. Pour en savoir plus, la meilleure solution c’est de vous inscrire à un stage gastronomique à la maison (tarif social, en fonction des revenus mensuels, donc plus élevé pour Mme Boutin – va de soi). Sauté de courgettes au curry – Ingrédients d’accompagnement incontournables : oignons, vin blanc sec (1 verre) ou muscat (1/2 verre), sel, poivre, curry. On fait sauter les oignons dans deux ou trois cuillères d’huile d’olive ; lorsqu’ils sont dorés on ajoute les petites courgettes coupées en rondelles, le vin blanc, le sel et le poivre. On met un couvercle sur la sauteuse, on passe à feu doux et on oublie pendant quelques minutes. Lorsque les courgettes ont transpiré, on « touille » avec délicatesse, on remet le couvercle et on oublie un peu plus longtemps. Lorsque les courgettes paraissent à peu près cuites, on enlève le couvercle, on passe à feu vif, on touille et on retouille consciencieusement jusqu’à ce que le mélange soit rissolé à point. Variante : on peut ajouter des cubes de poivron rouge, mais en dose raisonnable. Précision : on « oublie » pour un cuisinier, cela ne veut pas dire que l’on est frappé d’amnésie et que l’on part regarder un long métrage à la télévision. Cela veut simplement dire que l’on peut faire autre chose, en conservant ses narines en activité de surveillance (à moins que l’on ne dispose d’un drone possédant un capteur olfactif).
Sauté de courgettes au curry – Ingrédients d’accompagnement incontournables : oignons, vin blanc sec (1 verre) ou muscat (1/2 verre), sel, poivre, curry. On fait sauter les oignons dans deux ou trois cuillères d’huile d’olive ; lorsqu’ils sont dorés on ajoute les petites courgettes coupées en rondelles, le vin blanc, le sel et le poivre. On met un couvercle sur la sauteuse, on passe à feu doux et on oublie pendant quelques minutes. Lorsque les courgettes ont transpiré, on « touille » avec délicatesse, on remet le couvercle et on oublie un peu plus longtemps. Lorsque les courgettes paraissent à peu près cuites, on enlève le couvercle, on passe à feu vif, on touille et on retouille consciencieusement jusqu’à ce que le mélange soit rissolé à point. Variante : on peut ajouter des cubes de poivron rouge, mais en dose raisonnable. Précision : on « oublie » pour un cuisinier, cela ne veut pas dire que l’on est frappé d’amnésie et que l’on part regarder un long métrage à la télévision. Cela veut simplement dire que l’on peut faire autre chose, en conservant ses narines en activité de surveillance (à moins que l’on ne dispose d’un drone possédant un capteur olfactif). Tian de courgettes au four (variante sophistiquée) – Au lieu de pré-cuire les bébés courgettes comme dans la recette précédente, on les coupe en rondelles fines que l’on dispose dans un plat, en reconstituant artistiquement chaque fruit, c’est à dire en replaçant la rondelle à l’emplacement exact où on l’a trouvée en entrant dans la pièce. On remplit ainsi avec habileté un plat à gratin un peu grand, mais pas trop haut de bord, en veillant à ce qu’il n’y ait qu’une couche de rondelles (inutile de placer des rondelles métalliques ou des joints de plombier pour séparer les fruits, cela ajoute à l’esthétique mais pas au goût). Si l’on a vraiment une âme d’artiste, on peut réaliser une très jolie déco en intercalant des lanières de poivron rouge. Limitez vous à des effets relativement simples car vos invités seront là dans quelques minutes… On verse alors sur le gratin un mélange type flan, assez liquide, mais dans lequel on aura pris soin d’incorporer une cuillère ou deux de maïzena histoire d’absorber un peu le liquide rendu en cours de cuisson. Le plat va cuire doucement à four moyen. Une trop grande chaleur initiale dessèche le mélange et donne un affreux goût de brûlé aux courgettes sacrées.
Tian de courgettes au four (variante sophistiquée) – Au lieu de pré-cuire les bébés courgettes comme dans la recette précédente, on les coupe en rondelles fines que l’on dispose dans un plat, en reconstituant artistiquement chaque fruit, c’est à dire en replaçant la rondelle à l’emplacement exact où on l’a trouvée en entrant dans la pièce. On remplit ainsi avec habileté un plat à gratin un peu grand, mais pas trop haut de bord, en veillant à ce qu’il n’y ait qu’une couche de rondelles (inutile de placer des rondelles métalliques ou des joints de plombier pour séparer les fruits, cela ajoute à l’esthétique mais pas au goût). Si l’on a vraiment une âme d’artiste, on peut réaliser une très jolie déco en intercalant des lanières de poivron rouge. Limitez vous à des effets relativement simples car vos invités seront là dans quelques minutes… On verse alors sur le gratin un mélange type flan, assez liquide, mais dans lequel on aura pris soin d’incorporer une cuillère ou deux de maïzena histoire d’absorber un peu le liquide rendu en cours de cuisson. Le plat va cuire doucement à four moyen. Une trop grande chaleur initiale dessèche le mélange et donne un affreux goût de brûlé aux courgettes sacrées. Gratin de courgettes – La meilleure façon d’utiliser ce légume lorsqu’il est gros. Dans ce cas, mieux vaut peler et égrainer les fruits. on les coupe en morceaux que l’on fait cuire à l’étouffé (rappel = sans eau), à feu doux, juste avec un peu de sel. Cela prend un certain temps pour que les cubes s’écrasent facilement à la fourchette et que l’eau en excédent s’évapore. Plutôt que d’utiliser une hotte, ouvrez plutôt la porte de votre cuisine (ou la fenêtre) ; la vapeur d’eau s’échappant de la marmite pourra alors librement monter au ciel. Arrivée dans la haute atmosphère, elle se condensera, formera des nuages et, lorsque les conditions jugées nécessaires par les météorologues de météo France seront réunies, il pleuvra des courgettes… On peut aussi égoutter ses courgettes cuites dans une passoire et perdre ainsi une partie du précieux liquide qui les compose. Sachez que dans ce cas vous perdez une bonne partie des sels minéraux que contient ce légume généreux. Mieux vaut faire réduire un peu et préparer une liaison plus épaisse si la purée est très aqueuse. En ce qui concerne la liaison, eh bien on fabrique une pâte à crêpes un peu épaisse en mélangeant 4 œufs, un verre de farine et du lait (en quantité variable selon la texture dont on a besoin pour épaissir la pâte – ça c’est le coup de main du cuistot). On mélange soigneusement courgettes et liaison, sans employer de mixer : le simple fait d’ajouter la farine change la consistance. On verse dans un plat à gratin ; on ajoute l’un des délicieux fromages rapés mentionnés dans un paragraphe antérieur ; on fait cuire à four chaud jusqu’à ce que la croûte soit dorée. Selon le goût de chacun on peut ajouter différentes épices : noix de muscade, cannelle, cumin, poivre ou paprika agrémentent agréablement le gratin (grr ! grr ! grr ! difficile à prononcer, heureusement qu’il s’agit là d’une transmission de savoir par écrit…).
Gratin de courgettes – La meilleure façon d’utiliser ce légume lorsqu’il est gros. Dans ce cas, mieux vaut peler et égrainer les fruits. on les coupe en morceaux que l’on fait cuire à l’étouffé (rappel = sans eau), à feu doux, juste avec un peu de sel. Cela prend un certain temps pour que les cubes s’écrasent facilement à la fourchette et que l’eau en excédent s’évapore. Plutôt que d’utiliser une hotte, ouvrez plutôt la porte de votre cuisine (ou la fenêtre) ; la vapeur d’eau s’échappant de la marmite pourra alors librement monter au ciel. Arrivée dans la haute atmosphère, elle se condensera, formera des nuages et, lorsque les conditions jugées nécessaires par les météorologues de météo France seront réunies, il pleuvra des courgettes… On peut aussi égoutter ses courgettes cuites dans une passoire et perdre ainsi une partie du précieux liquide qui les compose. Sachez que dans ce cas vous perdez une bonne partie des sels minéraux que contient ce légume généreux. Mieux vaut faire réduire un peu et préparer une liaison plus épaisse si la purée est très aqueuse. En ce qui concerne la liaison, eh bien on fabrique une pâte à crêpes un peu épaisse en mélangeant 4 œufs, un verre de farine et du lait (en quantité variable selon la texture dont on a besoin pour épaissir la pâte – ça c’est le coup de main du cuistot). On mélange soigneusement courgettes et liaison, sans employer de mixer : le simple fait d’ajouter la farine change la consistance. On verse dans un plat à gratin ; on ajoute l’un des délicieux fromages rapés mentionnés dans un paragraphe antérieur ; on fait cuire à four chaud jusqu’à ce que la croûte soit dorée. Selon le goût de chacun on peut ajouter différentes épices : noix de muscade, cannelle, cumin, poivre ou paprika agrémentent agréablement le gratin (grr ! grr ! grr ! difficile à prononcer, heureusement qu’il s’agit là d’une transmission de savoir par écrit…). Le créateur contempla son œuvre et s’aperçut qu’il vous avait dévoilé sept recettes différentes pour préparer ce divin légume : une pour chaque jour de la semaine. Certes, il n’avait pas parlé des tagliatelles de courgettes, de la soupe (froide ou chaude) ou du clafoutis aux courgettes et à la tomme de chèvre, mais chaque chose en son temps. Rien n’empêchait un addenda à cette brillante chronique pendant la décennie à venir… Le créateur se dit qu’il avait rendu grand service à l’humanité et qu’il méritait bien quarante jours de repos. Il soumit son charabia à sa correctrice préférée, puis s’empara d’une bière fraîche, d’un polar bien ficelé, et se livra sans vergogne à l’un de ses vices favoris. Chose odieuse s’il en est : il s’avérait, en page 47, que l’assassin avait dissimulé son arme dans une courgette opulente. Certains êtres abjects ne reculaient vraiment devant aucune pratique barbare… La sieste terminée, promis, le créateur écrirait au brillant Saint-Nicolas pour qu’il nous ponde une loi à ce sujet…
Le créateur contempla son œuvre et s’aperçut qu’il vous avait dévoilé sept recettes différentes pour préparer ce divin légume : une pour chaque jour de la semaine. Certes, il n’avait pas parlé des tagliatelles de courgettes, de la soupe (froide ou chaude) ou du clafoutis aux courgettes et à la tomme de chèvre, mais chaque chose en son temps. Rien n’empêchait un addenda à cette brillante chronique pendant la décennie à venir… Le créateur se dit qu’il avait rendu grand service à l’humanité et qu’il méritait bien quarante jours de repos. Il soumit son charabia à sa correctrice préférée, puis s’empara d’une bière fraîche, d’un polar bien ficelé, et se livra sans vergogne à l’un de ses vices favoris. Chose odieuse s’il en est : il s’avérait, en page 47, que l’assassin avait dissimulé son arme dans une courgette opulente. Certains êtres abjects ne reculaient vraiment devant aucune pratique barbare… La sieste terminée, promis, le créateur écrirait au brillant Saint-Nicolas pour qu’il nous ponde une loi à ce sujet…
 Au Québec la version la plus connue de la chasse galerie a été rédigée par Honoré Beaugrand, en 1900 (brefs extraits tout au long de cette chronique *). Ce texte est à rapprocher d’une légende française racontant l’histoire d’un noble passionné de chasse. Il aimait tellement cette activité qu’un dimanche, il s’abstint d’aller à la messe pour ne pas manquer une partie. Il fut condamné à errer dans le ciel, poursuivi par une meute de chiens hurlants et de chevaux sauvages déchaînés. Depuis, on entend le passage de la meute dans le ciel, lorsque la tempête se déchaîne. Le récit d’Honoré Beaugrand commence lors d’une veillée. L’un des héros de l’histoire raconte son aventure, du temps de sa jeunesse, quand il ne craignait ni Dieu ni diable. C’était la veille du Jour de l’An… Les bûcherons étaient réunis dans la cambuse et le cuistot avait apporté un petit baril de rhum pour égayer la soirée. En pleine nuit, Joe, le récitant, est réveillé par Baptiste Durand, le boss des piqueurs. Celui-ci lui propose de l’accompagner dans sa virée pour aller voir sa blonde à plus de cent lieues du campement. Joe comprend très vite quel moyen compte utiliser Baptiste pour arriver à ses fins et il est plutôt inquiet…
Au Québec la version la plus connue de la chasse galerie a été rédigée par Honoré Beaugrand, en 1900 (brefs extraits tout au long de cette chronique *). Ce texte est à rapprocher d’une légende française racontant l’histoire d’un noble passionné de chasse. Il aimait tellement cette activité qu’un dimanche, il s’abstint d’aller à la messe pour ne pas manquer une partie. Il fut condamné à errer dans le ciel, poursuivi par une meute de chiens hurlants et de chevaux sauvages déchaînés. Depuis, on entend le passage de la meute dans le ciel, lorsque la tempête se déchaîne. Le récit d’Honoré Beaugrand commence lors d’une veillée. L’un des héros de l’histoire raconte son aventure, du temps de sa jeunesse, quand il ne craignait ni Dieu ni diable. C’était la veille du Jour de l’An… Les bûcherons étaient réunis dans la cambuse et le cuistot avait apporté un petit baril de rhum pour égayer la soirée. En pleine nuit, Joe, le récitant, est réveillé par Baptiste Durand, le boss des piqueurs. Celui-ci lui propose de l’accompagner dans sa virée pour aller voir sa blonde à plus de cent lieues du campement. Joe comprend très vite quel moyen compte utiliser Baptiste pour arriver à ses fins et il est plutôt inquiet… Dans le répertoire folklorique français, la version originelle de cette histoire n’est plus guère présente, mais il faut dire que la renaissance de la pratique du conte est relativement récente, du moins en tant qu’activité destinée à des adultes. Il n’en est pas de même au Québec où certains pans de la tradition restent bien vivants. De nombreux conteurs québécois ont retravaillé et raconté cette légende de la « chasse-galerie » à leur gré, prenant soin d’en créer un grand nombre de variantes. La version racontée par Jocelyn Bérubé, artiste aux multiples talents, est particulièrement plaisante à lire et à entendre. La chasse-galerie, comme l’indique Bérubé, « n’a pas fait couler beaucoup d’encre sur le papier, mais a brassé beaucoup de salive dans la bouche des conteurs d’ici » ! Mais ce n’est pas tout ! Le « maudit canot » est apprécié dans bien des domaines ! On le retrouve par exemple sur l’étiquette d’une bière délicieuse, « la Maudite », très appréciée au Québec… Un manège du parc d’attraction La Ronde à Montréal, appelé « la Pitoune » (buche de bois) est basé sur cette histoire. Plusieurs poètes et musiciens ont sans doute été inspirés à la fois par les récits des anciens et par la consommation du breuvage brassé à Chambly. Vous pouvez écouter par exemple la chanson de Michel Rivard, «
Dans le répertoire folklorique français, la version originelle de cette histoire n’est plus guère présente, mais il faut dire que la renaissance de la pratique du conte est relativement récente, du moins en tant qu’activité destinée à des adultes. Il n’en est pas de même au Québec où certains pans de la tradition restent bien vivants. De nombreux conteurs québécois ont retravaillé et raconté cette légende de la « chasse-galerie » à leur gré, prenant soin d’en créer un grand nombre de variantes. La version racontée par Jocelyn Bérubé, artiste aux multiples talents, est particulièrement plaisante à lire et à entendre. La chasse-galerie, comme l’indique Bérubé, « n’a pas fait couler beaucoup d’encre sur le papier, mais a brassé beaucoup de salive dans la bouche des conteurs d’ici » ! Mais ce n’est pas tout ! Le « maudit canot » est apprécié dans bien des domaines ! On le retrouve par exemple sur l’étiquette d’une bière délicieuse, « la Maudite », très appréciée au Québec… Un manège du parc d’attraction La Ronde à Montréal, appelé « la Pitoune » (buche de bois) est basé sur cette histoire. Plusieurs poètes et musiciens ont sans doute été inspirés à la fois par les récits des anciens et par la consommation du breuvage brassé à Chambly. Vous pouvez écouter par exemple la chanson de Michel Rivard, « 
 Le programme de la journée du lendemain est conçu de manière à ne pas renouveler la même erreur. Il faut du temps pour arpenter la nécropole de Poggo Felceto qui est un élément essentiel de l’ensemble funéraire situé aux environs de Sovana. Après avoir consacré le délai nécessaire à la visite des villages de Pitigliano et de Saturnia (incontournable baignade dans les eaux chaudes des termes), nous sommes prêts à rendre à nouveau hommage à Ildebranda. Le nom a été donné à cette tombe, en hommage au moine Ildebrando, né au début du XIème siècle, futur pape Grégoire VII et découvreur du site. Une fouille méthodique des lieux a été conduite à partir de 1925 et a permis une reconstitution graphique à peu près complète du monument. Celui-ci comprend deux parties distinctes, la chambre funéraire située dans la partie basse et un podium surélevé consacré à la mémoire du défunt, accessible par deux escaliers latéraux. C’est cette partie haute qui était la plus richement décorée. Elle avait l’apparence d’un fronton de temple grec avec une douzaine de colonnes sculptées dans la masse du rocher. De toutes les nécropoles étrusques que nous avons visitées, c’est certainement l’une des plus ouvragées. La chambre mortuaire ne comporte qu’un seul socle : ce tombeau n’a donc abrité qu’un seul défunt. Compte tenu de l’importance de l’édifice, il est évident qu’il s’agissait d’un notable. Les restes d’une frise, ornementation constituée de représentations d’animaux et de plantes, sont encore visibles au dessus de la colonnade sculptée en façade. Les Etrusques aimaient les couleurs vives, mais ce genre de détail artistique n’est malheureusement plus perceptible.
Le programme de la journée du lendemain est conçu de manière à ne pas renouveler la même erreur. Il faut du temps pour arpenter la nécropole de Poggo Felceto qui est un élément essentiel de l’ensemble funéraire situé aux environs de Sovana. Après avoir consacré le délai nécessaire à la visite des villages de Pitigliano et de Saturnia (incontournable baignade dans les eaux chaudes des termes), nous sommes prêts à rendre à nouveau hommage à Ildebranda. Le nom a été donné à cette tombe, en hommage au moine Ildebrando, né au début du XIème siècle, futur pape Grégoire VII et découvreur du site. Une fouille méthodique des lieux a été conduite à partir de 1925 et a permis une reconstitution graphique à peu près complète du monument. Celui-ci comprend deux parties distinctes, la chambre funéraire située dans la partie basse et un podium surélevé consacré à la mémoire du défunt, accessible par deux escaliers latéraux. C’est cette partie haute qui était la plus richement décorée. Elle avait l’apparence d’un fronton de temple grec avec une douzaine de colonnes sculptées dans la masse du rocher. De toutes les nécropoles étrusques que nous avons visitées, c’est certainement l’une des plus ouvragées. La chambre mortuaire ne comporte qu’un seul socle : ce tombeau n’a donc abrité qu’un seul défunt. Compte tenu de l’importance de l’édifice, il est évident qu’il s’agissait d’un notable. Les restes d’une frise, ornementation constituée de représentations d’animaux et de plantes, sont encore visibles au dessus de la colonnade sculptée en façade. Les Etrusques aimaient les couleurs vives, mais ce genre de détail artistique n’est malheureusement plus perceptible. Nous sommes au début du mois de novembre ; la saison touristique est pratiquement terminée et les visiteurs ne se bousculent pas dans ces lieux un peu sinistres. Le soleil rend un peu plus angoissant le trou noir qui s’ouvre au pied de la falaise. L’envie est plus grande d’emprunter l’un des deux escaliers qui permettent de grimper vers le haut de l’édifice et d’en faire le tour. Nous n’hésitons pas cependant à descendre dans le sous sol ; il est tôt dans l’après-midi et les fantômes ne sont pas encore réveillés. Je me demande ce qui se serait passé si nous avions prolongé notre visite la veille au soir. Qui était l’occupant de ces lieux, puisqu’il ne s’agit point d’une jeune princesse morte d’un chagrin d’amour ? Riche marchand, notable au fait de sa gloire, prince à l’ambition démesurée ? D’après tous les documents que j’ai consultés, rien ne permet de le savoir. Beaucoup de choses restent à découvrir en ce qui concerne cette civilisation des Etrusques. Peut-être cela explique-t-il l’attrait irrésistible qu’elle exerce sur certains amateurs d’histoire.
Nous sommes au début du mois de novembre ; la saison touristique est pratiquement terminée et les visiteurs ne se bousculent pas dans ces lieux un peu sinistres. Le soleil rend un peu plus angoissant le trou noir qui s’ouvre au pied de la falaise. L’envie est plus grande d’emprunter l’un des deux escaliers qui permettent de grimper vers le haut de l’édifice et d’en faire le tour. Nous n’hésitons pas cependant à descendre dans le sous sol ; il est tôt dans l’après-midi et les fantômes ne sont pas encore réveillés. Je me demande ce qui se serait passé si nous avions prolongé notre visite la veille au soir. Qui était l’occupant de ces lieux, puisqu’il ne s’agit point d’une jeune princesse morte d’un chagrin d’amour ? Riche marchand, notable au fait de sa gloire, prince à l’ambition démesurée ? D’après tous les documents que j’ai consultés, rien ne permet de le savoir. Beaucoup de choses restent à découvrir en ce qui concerne cette civilisation des Etrusques. Peut-être cela explique-t-il l’attrait irrésistible qu’elle exerce sur certains amateurs d’histoire.
 Nous quittons Poggo Felceto pour nous retrouver très vite dans un autre lieu étrange : la via cava de San Sebastiano. Nous parcourons plusieurs centaines de mètres à pied sur un chemin étroit qui s’enfonce entre deux falaises élevées. Ce n’est pas notre premier contact avec les voies excavées ; nous en avons déjà parcouru plusieurs la veille. Elles sont nombreuses dans cette région de la vallée de la Fiora. Elles datent du temps des Etrusques, mais ont été utilisées longtemps après, pendant l’occupation romaine et jusqu’au Moyen-Âge. Durant cette période, les voyageurs qui les empruntaient devaient sans doute avoir quelques angoisses à surmonter car, en différents points, l’on trouve des représentations de la Vierge censées éloigner les « mauvais » esprits des lieux. Une quinzaine de fragments de ces « vie cave » subsistent à notre époque. Elles étaient intégrées, à l’époque romaine, à la via Clodia reliant Rome à Saturnia.
Nous quittons Poggo Felceto pour nous retrouver très vite dans un autre lieu étrange : la via cava de San Sebastiano. Nous parcourons plusieurs centaines de mètres à pied sur un chemin étroit qui s’enfonce entre deux falaises élevées. Ce n’est pas notre premier contact avec les voies excavées ; nous en avons déjà parcouru plusieurs la veille. Elles sont nombreuses dans cette région de la vallée de la Fiora. Elles datent du temps des Etrusques, mais ont été utilisées longtemps après, pendant l’occupation romaine et jusqu’au Moyen-Âge. Durant cette période, les voyageurs qui les empruntaient devaient sans doute avoir quelques angoisses à surmonter car, en différents points, l’on trouve des représentations de la Vierge censées éloigner les « mauvais » esprits des lieux. Une quinzaine de fragments de ces « vie cave » subsistent à notre époque. Elles étaient intégrées, à l’époque romaine, à la via Clodia reliant Rome à Saturnia. Via San Sebastiano… encore un lieu dont nous sommes les seuls visiteurs à cette heure tardive. Nous prenons longuement le temps de l’explorer. Elle doit son nom à un oratoire abandonné, construit sur le bord du chemin. La lumière est magnifique. Le soleil décline à l’horizon et les ombres envahissent peu à peu le paysage. Nous n’avons aucun mal à nous mettre dans la peau d’un personnage de l’époque : paysan rentrant du champ ou colporteur déambulant d’un village à un autre. De temps en temps nous lançons un coup d’œil inquiet vers le haut de la falaise, mais nul danger ne nous guette. La végétation, accrochée à la falaise, dissimule une grande partie de notre progression. Il est difficile de nous voir depuis le haut du plateau. Le seul risque que nous courrons c’est de trainer trop longtemps et d’arriver en retard pour notre collation du soir. Nous avons établi notre camp de base à Bolsène, au bord du lac du même nom. Depuis quelques jours nous explorons cette région magnifique à la limite entre l’Ombrie, la Toscane et le Latium, autrefois partie intégrante du royaume des Etrusques… Sorano, Sovana, Pitigliano, Orvieto, Saturnia, autant de noms qui me font encore rêver : villages bâtis sur de hauts plateaux rocheux, dédales de ruelles dans lesquels on se perd sans cesse, petites épiceries aux senteurs épicées évoquant déjà l’Orient alors que nous ne sommes qu’à quelques centaines de kilomètres de chez nous…
Via San Sebastiano… encore un lieu dont nous sommes les seuls visiteurs à cette heure tardive. Nous prenons longuement le temps de l’explorer. Elle doit son nom à un oratoire abandonné, construit sur le bord du chemin. La lumière est magnifique. Le soleil décline à l’horizon et les ombres envahissent peu à peu le paysage. Nous n’avons aucun mal à nous mettre dans la peau d’un personnage de l’époque : paysan rentrant du champ ou colporteur déambulant d’un village à un autre. De temps en temps nous lançons un coup d’œil inquiet vers le haut de la falaise, mais nul danger ne nous guette. La végétation, accrochée à la falaise, dissimule une grande partie de notre progression. Il est difficile de nous voir depuis le haut du plateau. Le seul risque que nous courrons c’est de trainer trop longtemps et d’arriver en retard pour notre collation du soir. Nous avons établi notre camp de base à Bolsène, au bord du lac du même nom. Depuis quelques jours nous explorons cette région magnifique à la limite entre l’Ombrie, la Toscane et le Latium, autrefois partie intégrante du royaume des Etrusques… Sorano, Sovana, Pitigliano, Orvieto, Saturnia, autant de noms qui me font encore rêver : villages bâtis sur de hauts plateaux rocheux, dédales de ruelles dans lesquels on se perd sans cesse, petites épiceries aux senteurs épicées évoquant déjà l’Orient alors que nous ne sommes qu’à quelques centaines de kilomètres de chez nous… J’espère que cette brève évocation d’un voyage maintenant ancien (cinq ans) dont les souvenirs sont encore très présents dans ma mémoire, aura éveillé votre intérêt ou tout au moins votre curiosité. Je n’ai guère l’habitude dans ces « carnets de voyage » de parler du passé, mais, ces derniers temps, les circonstances un peu particulières expliquent ma démarche. Depuis quelques mois nous n’avons plus quitté notre petit royaume et il est des petits matins où l’envie de poser mes pas dans des ornières inconnues me démange. Un coup d’œil dans les albums de photos, un détour avant-hier dans le rayon « voyage » d’une librairie, et c’est fait : mon esprit vagabonde… Mes mains fouillent la terre du jardin mais ma tête cherche de nouveaux itinéraires !
J’espère que cette brève évocation d’un voyage maintenant ancien (cinq ans) dont les souvenirs sont encore très présents dans ma mémoire, aura éveillé votre intérêt ou tout au moins votre curiosité. Je n’ai guère l’habitude dans ces « carnets de voyage » de parler du passé, mais, ces derniers temps, les circonstances un peu particulières expliquent ma démarche. Depuis quelques mois nous n’avons plus quitté notre petit royaume et il est des petits matins où l’envie de poser mes pas dans des ornières inconnues me démange. Un coup d’œil dans les albums de photos, un détour avant-hier dans le rayon « voyage » d’une librairie, et c’est fait : mon esprit vagabonde… Mes mains fouillent la terre du jardin mais ma tête cherche de nouveaux itinéraires !