13mars2019
Posté par Paul dans la catégorie : Philosophes, trublions, agitateurs et agitatrices du bon vieux temps.
 Contrairement à ce qu’enseigne trop souvent l’histoire officielle, à la fin du XIXème siècle, tous les anarchistes ne sont pas occupés à poser des bombes ou à assassiner des chefs d’état… Il en est certains qui s’adonnent à des activités plus calmes, mais tout aussi révolutionnaires dans leur domaine. Prenons par l’exemple la liste des géographes qui se revendiquent du drapeau noir ; ils sont assez nombreux… Je pense à Elisée Reclus, Pierre Kropotkine, Patrick Geddes, Charles Perron, Léon Metchnikoff, Mikhail Dragomanov… et j’en oublie sans doute. Les deux premiers sont connus, le second surtout pour ses écrits politiques… J’ai déjà eu l’occasion de vous dire tout le bien que je pense d’Elisée Reclus dont les travaux ont été largement remis à l’honneur depuis quelques dizaines d’années. Il en est un autre, personnage pittoresque lui aussi, dont j’aimerais vous parler aujourd’hui : il s’agit de Patrick Geddes, un géographe d’origine écossaise, connu dans un petit milieu de spécialistes, mais en partie oublié du public, notamment dans notre pays. Les sources documentaires en anglais sont abondantes mais ce n’est pas le cas en français, bien que Geddes ait fréquemment séjourné en France. Ses travaux touchent à divers domaines puisqu’il fut à la fois biologiste, sociologue, géographe et urbaniste. Comme Reclus, lui aussi a de nouveau droit de cité dans les travaux de chercheurs contemporains (il faudra un jour que l’on s’interroge sur ce phénomène, qui n’a rien de comparable à une « mode » !). Dans leurs divers écrits, par exemple, Kenneth White, fondateur de la géopoétique, José Cornuault, essayiste, ou Frederico Ferretti, enseignant chercheur en géographie, font souvent référence à son œuvre.
Contrairement à ce qu’enseigne trop souvent l’histoire officielle, à la fin du XIXème siècle, tous les anarchistes ne sont pas occupés à poser des bombes ou à assassiner des chefs d’état… Il en est certains qui s’adonnent à des activités plus calmes, mais tout aussi révolutionnaires dans leur domaine. Prenons par l’exemple la liste des géographes qui se revendiquent du drapeau noir ; ils sont assez nombreux… Je pense à Elisée Reclus, Pierre Kropotkine, Patrick Geddes, Charles Perron, Léon Metchnikoff, Mikhail Dragomanov… et j’en oublie sans doute. Les deux premiers sont connus, le second surtout pour ses écrits politiques… J’ai déjà eu l’occasion de vous dire tout le bien que je pense d’Elisée Reclus dont les travaux ont été largement remis à l’honneur depuis quelques dizaines d’années. Il en est un autre, personnage pittoresque lui aussi, dont j’aimerais vous parler aujourd’hui : il s’agit de Patrick Geddes, un géographe d’origine écossaise, connu dans un petit milieu de spécialistes, mais en partie oublié du public, notamment dans notre pays. Les sources documentaires en anglais sont abondantes mais ce n’est pas le cas en français, bien que Geddes ait fréquemment séjourné en France. Ses travaux touchent à divers domaines puisqu’il fut à la fois biologiste, sociologue, géographe et urbaniste. Comme Reclus, lui aussi a de nouveau droit de cité dans les travaux de chercheurs contemporains (il faudra un jour que l’on s’interroge sur ce phénomène, qui n’a rien de comparable à une « mode » !). Dans leurs divers écrits, par exemple, Kenneth White, fondateur de la géopoétique, José Cornuault, essayiste, ou Frederico Ferretti, enseignant chercheur en géographie, font souvent référence à son œuvre.
 Patrick Geddes a soulevé, de son vivant, des problèmes, comme celui de l’indépendance de son pays natal, l’Ecosse, ou celui de l’aménagement des grandes cités, qui sont tout à fait d’actualité. Je pense entre autres au référendum qui a eu lieu en 2014… Le « oui » n’était pas loin de l’emporter car nombreux sont les Ecossais qui souhaitent se séparer de la Grande Bretagne. Cet homme à l’imagination fertile fut également un collaborateur occasionnel d’Elisée Reclus, notamment lorsque ce dernier voulut se lancer dans la construction d’un globe terrestre de dimension colossale pour permettre à ses concitoyens d’avoir une meilleure approche de la dimension des continents et surtout du relief montagneux. Anarchiste, Patrick Geddes l’a été pendant de longues années, même s’il s’est éloigné de ses orientations politiques à la fin de sa vie. « Sur la route de la liberté, nous trouvons le drapeau rouge du Socialisme et le drapeau noir de l’Anarchisme, symboles des tendances contrastées qui existent en nous. Et en miroir de ces symboles, le développement de l’immense richesse, mais aussi de la grande pauvreté ». Il partage avec Reclus une conviction profonde sur l’importance de l’éducation, notamment pour les adultes, et une méfiance, justifiée à mes yeux, sur la spécialisation outrancière des recherches scientifiques. Ces positions « ouvertes » le conduisent à s’opposer à nombre de ses collègues universitaires. « C’est en faisant que l’on apprend » considère-t-il et ce principe explique sans doute le grand nombre de domaines auxquels il va s’intéresser, et la vie aventureuse qui va être la sienne.
Patrick Geddes a soulevé, de son vivant, des problèmes, comme celui de l’indépendance de son pays natal, l’Ecosse, ou celui de l’aménagement des grandes cités, qui sont tout à fait d’actualité. Je pense entre autres au référendum qui a eu lieu en 2014… Le « oui » n’était pas loin de l’emporter car nombreux sont les Ecossais qui souhaitent se séparer de la Grande Bretagne. Cet homme à l’imagination fertile fut également un collaborateur occasionnel d’Elisée Reclus, notamment lorsque ce dernier voulut se lancer dans la construction d’un globe terrestre de dimension colossale pour permettre à ses concitoyens d’avoir une meilleure approche de la dimension des continents et surtout du relief montagneux. Anarchiste, Patrick Geddes l’a été pendant de longues années, même s’il s’est éloigné de ses orientations politiques à la fin de sa vie. « Sur la route de la liberté, nous trouvons le drapeau rouge du Socialisme et le drapeau noir de l’Anarchisme, symboles des tendances contrastées qui existent en nous. Et en miroir de ces symboles, le développement de l’immense richesse, mais aussi de la grande pauvreté ». Il partage avec Reclus une conviction profonde sur l’importance de l’éducation, notamment pour les adultes, et une méfiance, justifiée à mes yeux, sur la spécialisation outrancière des recherches scientifiques. Ces positions « ouvertes » le conduisent à s’opposer à nombre de ses collègues universitaires. « C’est en faisant que l’on apprend » considère-t-il et ce principe explique sans doute le grand nombre de domaines auxquels il va s’intéresser, et la vie aventureuse qui va être la sienne.

Patrick Geddes et ses étudiants à Bombay
Patrick Geddes naît le 2 octobre 1854 à Balater dans le comté d’Aberdeen en Ecosse. Dès l’enfance, il témoigne d’un grand intérêt pour tout ce qui touche à la nature : « j’ai grandi dans un jardin » dira-t-il plus tard. L’éducation qu’il reçoit encourage son goût pour l’aventure. Il est scolarisé au sein de la « Free Church of Scotland » – une institution qui professe des idées plutôt libérales. Il fait de brillantes études secondaires et universitaires, même s’il formule très rapidement des critiques acerbes à l’égard des différents systèmes éducatifs qu’il côtoie par la suite. Il a pour professeurs quelques célébrités de l’époque dont Charles Darwin et Thomas Huxley. Il soutient brillamment sa thèse en zoologie à l’université de la Sorbonne à Paris. C’est à cette époque qu’il sympathise avec les idées libertaires, après avoir lu, entre autres, les écrits de Pierre Kropotkine. De retour en Ecosse, il débute une carrière d’enseignant à l’université d’Edimbourg, de 1880 à 1888 et se marie avec Anna Morton. Il crée une université d’été ouverte à des étudiants provenant de divers horizons et invite les savants avec lesquels il est en relation à venir y donner des cours (Elisée Reclus, entre autres, répondra à cette invitation). Sa carrière se poursuit à Dundee, où il occupe une chaire de botanique cette fois, jusqu’en 1919. Finalement il part pour Bombay en Inde où il occupe un poste d’enseignant dans le domaine de la sociologie. Mais ce parcours atypique est loin d’occuper tout son temps et ses centres d’intérêt personnels le conduisent à entretenir des rapports d’amitiés avec de nombreuses personnalités et à se lancer dans de multiples projets. Son réseau de relation est étendu, de ses professeurs tout d’abord à d’autres personnages importants de l’époque : Lewis Mumford, John Dewey, Albert Einstein, Pierre Kropotkine, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tragore, Henri Bergson, Elisée et Paul Reclus…
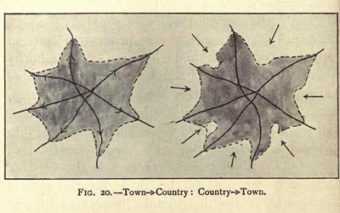 Lors de son séjour prolongé à Dundee il développe et met en pratique ses idées sur l’urbanisme ; l’une de ses convictions, novatrice pour l’époque, étant qu’il faut associer le plus possible les utilisateurs, les citoyens, à la gestion, à l’entretien et à l’administration de leur cadre de vie. Le développement urbain doit être accompagné d’un souci constant de respect de la nature. Il préconise le maintien d’espaces verts importants lors de la construction, et valorise la présence de jardins botaniques et potagers urbains. Ces réalisations doivent favoriser le maintien et l’observation de la biodiversité, ainsi que permettre d’approcher de l’autosuffisance alimentaire pour les nouveaux citadins… Tout cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? On peut facilement établir des liens entre les travaux anciens de Geddes et les écrits contemporains de Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire, même si la dimension politique est beaucoup plus approfondie chez Bookchin. Ce travail sur l’urbanisme deviendra l’une de ses préoccupations principales à la fin de sa vie et il sera à l’origine de travaux d’aménagement à Edimbourg puis à Jérusalem et à Tel Aviv en Palestine plus tard dans sa vie.
Lors de son séjour prolongé à Dundee il développe et met en pratique ses idées sur l’urbanisme ; l’une de ses convictions, novatrice pour l’époque, étant qu’il faut associer le plus possible les utilisateurs, les citoyens, à la gestion, à l’entretien et à l’administration de leur cadre de vie. Le développement urbain doit être accompagné d’un souci constant de respect de la nature. Il préconise le maintien d’espaces verts importants lors de la construction, et valorise la présence de jardins botaniques et potagers urbains. Ces réalisations doivent favoriser le maintien et l’observation de la biodiversité, ainsi que permettre d’approcher de l’autosuffisance alimentaire pour les nouveaux citadins… Tout cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? On peut facilement établir des liens entre les travaux anciens de Geddes et les écrits contemporains de Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire, même si la dimension politique est beaucoup plus approfondie chez Bookchin. Ce travail sur l’urbanisme deviendra l’une de ses préoccupations principales à la fin de sa vie et il sera à l’origine de travaux d’aménagement à Edimbourg puis à Jérusalem et à Tel Aviv en Palestine plus tard dans sa vie.
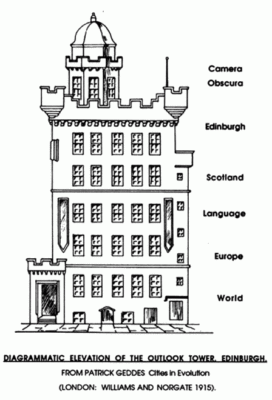 Patrick Geddes va également œuvrer pour une reconnaissance de la culture et de la nation écossaises et s’impliquer dans la rédaction de plusieurs revues. Parallèlement à son travail à Dundee il assure également des cours à l’University College de Dublin, et il est très impressionné par la vigueur du nationalisme irlandais et de la culture celte. Il souhaite enclencher le même dynamisme en Ecosse et pense que pour que ce phénomène dure, il est essentiel de mettre en avant la culture de son pays natal. On peut s’étonner de cette cohabitation entre l’idée nationaliste et le rejet de l’état et des frontières chez les anarchistes. Mais, aux yeux des géographes libertaires, l’Etat et la Nation ne représentent pas la même chose. Le signifiant du mot « Nation » n’est guère comparable à sa définition classique… « Les géographes anarchistes ne reconnaissaient pas l’État, mais ils considéraient la nation, dans le sens à la fois culturel et géographique, comme un objet sur lequel ils pouvaient travailler à « plusieurs échelles ». (citation extraite d’un texte de Frederico Ferretti au sujet de Geddes). « Le savoir national était présenté ici, non pas comme un enjeu chauviniste ou économico-fiscal (du genre « gardons notre argent pour nous »), mais plutôt comme une amélioration collective et publique de la communauté nationale, insérée pacifiquement dans une plus vaste communauté universelle qu’elle se doit de connaître à travers la géographie. » (idem)
Patrick Geddes va également œuvrer pour une reconnaissance de la culture et de la nation écossaises et s’impliquer dans la rédaction de plusieurs revues. Parallèlement à son travail à Dundee il assure également des cours à l’University College de Dublin, et il est très impressionné par la vigueur du nationalisme irlandais et de la culture celte. Il souhaite enclencher le même dynamisme en Ecosse et pense que pour que ce phénomène dure, il est essentiel de mettre en avant la culture de son pays natal. On peut s’étonner de cette cohabitation entre l’idée nationaliste et le rejet de l’état et des frontières chez les anarchistes. Mais, aux yeux des géographes libertaires, l’Etat et la Nation ne représentent pas la même chose. Le signifiant du mot « Nation » n’est guère comparable à sa définition classique… « Les géographes anarchistes ne reconnaissaient pas l’État, mais ils considéraient la nation, dans le sens à la fois culturel et géographique, comme un objet sur lequel ils pouvaient travailler à « plusieurs échelles ». (citation extraite d’un texte de Frederico Ferretti au sujet de Geddes). « Le savoir national était présenté ici, non pas comme un enjeu chauviniste ou économico-fiscal (du genre « gardons notre argent pour nous »), mais plutôt comme une amélioration collective et publique de la communauté nationale, insérée pacifiquement dans une plus vaste communauté universelle qu’elle se doit de connaître à travers la géographie. » (idem)
 Geddes entretient une correspondance suivie avec Reclus et s’enthousiasme pour le projet de globe que le géographe souhaite construire à l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 1900. En résonance avec ce projet, il rachète et il fait aménager à Edimbourg une tour observatoire (l’Outlook tower) qui se veut à la fois Musée, lieu d’expositions géographiques, laboratoire de sociologie. L’édifice est inauguré en 1892. Geddes espère permettre à ses concitoyens de mieux connaître, grâce à l’observation, la ville et sa région. Il souhaite également promouvoir la géographie et amener les personnalités du monde entier à s’intéresser à l’Ecosse. Dans son ouvrage intitulé « cities in evolution » voici comment l’universitaire parle de sa tour : « Ses six étages superposés représentent dans leur empilement comme une série de cercles concentriques dont les destinations vont en se rétrécissant, depuis le rez-de-chaussée, consacré au monde entier, ou le premier étage, attribué à l’Europe, jusqu’au cinquième étage, réservé à la cité même, surmonté d’une terrasse et d’une chambre obscure qui projette sur un écran tabulaire la perspective animée de ce centre régional de l’étude mondiale. » Lorsque les visiteurs sont guidés par le concepteur en personne, la découverte du lieu est passionnante ; lorsqu’il est absent, il semble que le lieu perde une bonne partie de son intérêt ! Voici ce que déclarent les premiers visiteurs. On se rend compte à quel point ce projet est fortement imprégné des idées de son concepteur. Le problème c’est que la vie agitée de Geddes l’amène à se déplacer en de nombreux autres lieux ! Données assez peu connues, Geddes va construire deux autres « outlook tower » en France. L’une au collège des Ecosssais à Montpellier en 1924 ; la seconde à Domme en Dordogne sera achevée par le neveu d’Elisée Reclus, Paul, après le décès de son ami. Quant au projet de globe, il sera abandonné en cours de route faute du financement nécessaire. Si vous souhaitez approfondir cette histoire de l’Outlook tower, je vous invite à lire une interview de Patrick Geddes publiée à l’origine dans la revue politique et parlementaire en avril 1910 et reproduite sur le blog « la vie quotidienne à Roscoff ».
Geddes entretient une correspondance suivie avec Reclus et s’enthousiasme pour le projet de globe que le géographe souhaite construire à l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 1900. En résonance avec ce projet, il rachète et il fait aménager à Edimbourg une tour observatoire (l’Outlook tower) qui se veut à la fois Musée, lieu d’expositions géographiques, laboratoire de sociologie. L’édifice est inauguré en 1892. Geddes espère permettre à ses concitoyens de mieux connaître, grâce à l’observation, la ville et sa région. Il souhaite également promouvoir la géographie et amener les personnalités du monde entier à s’intéresser à l’Ecosse. Dans son ouvrage intitulé « cities in evolution » voici comment l’universitaire parle de sa tour : « Ses six étages superposés représentent dans leur empilement comme une série de cercles concentriques dont les destinations vont en se rétrécissant, depuis le rez-de-chaussée, consacré au monde entier, ou le premier étage, attribué à l’Europe, jusqu’au cinquième étage, réservé à la cité même, surmonté d’une terrasse et d’une chambre obscure qui projette sur un écran tabulaire la perspective animée de ce centre régional de l’étude mondiale. » Lorsque les visiteurs sont guidés par le concepteur en personne, la découverte du lieu est passionnante ; lorsqu’il est absent, il semble que le lieu perde une bonne partie de son intérêt ! Voici ce que déclarent les premiers visiteurs. On se rend compte à quel point ce projet est fortement imprégné des idées de son concepteur. Le problème c’est que la vie agitée de Geddes l’amène à se déplacer en de nombreux autres lieux ! Données assez peu connues, Geddes va construire deux autres « outlook tower » en France. L’une au collège des Ecosssais à Montpellier en 1924 ; la seconde à Domme en Dordogne sera achevée par le neveu d’Elisée Reclus, Paul, après le décès de son ami. Quant au projet de globe, il sera abandonné en cours de route faute du financement nécessaire. Si vous souhaitez approfondir cette histoire de l’Outlook tower, je vous invite à lire une interview de Patrick Geddes publiée à l’origine dans la revue politique et parlementaire en avril 1910 et reproduite sur le blog « la vie quotidienne à Roscoff ».
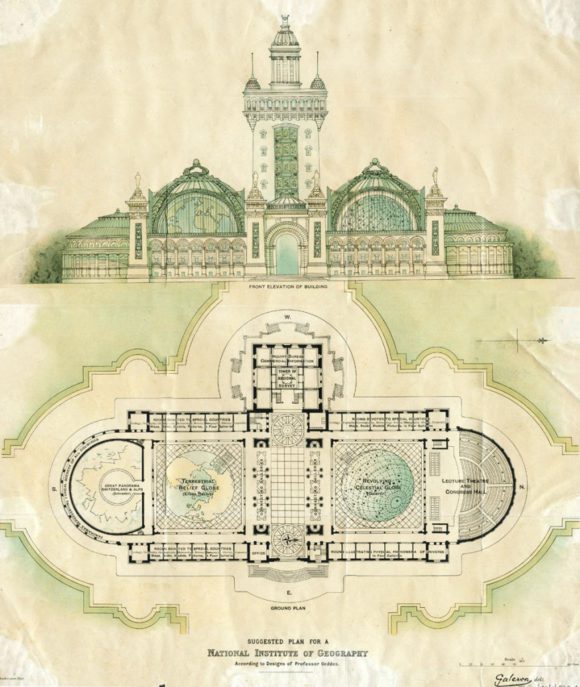
Un autre projet conçu par Patrick Geddes pour Edimbourg. Celui-ci ne sortira jamais des cartons.
 L’évocation, certes rapide, de la vie de ce singulier chercheur, ne serait pas complète si l’on n’évoque pas le combat qu’il a mené pour l’égalité des droits entre femme et homme ainsi que ses convictions pacifistes.
L’évocation, certes rapide, de la vie de ce singulier chercheur, ne serait pas complète si l’on n’évoque pas le combat qu’il a mené pour l’égalité des droits entre femme et homme ainsi que ses convictions pacifistes.
« Pour Geddes, les femmes ont un rôle primordial dans la transmission des idéaux culturels, et des traditions dont elles sont en quelque sorte les gardiennes. Cette conception est radicale en ce sens qu’elle reconnaît enfin la femme comme l’égale de l’homme, mais conservatrice parce qu’elle accepte le rôle traditionnel de la femme dans la famille. » (citation extraite d’un texte de Tom Steele – autre source documentaire importante utilisée pour rédiger ce billet). Le combat des suffragettes ne présente par contre guère d’intérêt à ses yeux. Les raisons « biologiques » qu’il avance pour expliquer son désintérêt paraissent plutôt désuètes en ce début de XXIème siècle. Mais il fait preuve par contre d’une certaine lucidité quant à la possible transition vers le socialisme par le biais du vote. Il n’est pas le seul à réclamer pour les femmes des droits d’une toute autre importance que le fait de déléguer son pouvoir en mettant périodiquement un bulletin dans une urne. Ce combat est aussi celui de militantes anarcha-féministes comme Voltairine de Cleyre ou Emma Goldman. Précisons que le public sera très choqué par le livre qu’il consacre à cette question : « The evolution of Sex ». N’oublions pas que nous sommes en pleine période victorienne, en Grande Bretagne, lorsqu’il le publie… !

Collège des Ecossais à Montpellier
Patrick Geddes meurt le 17 avril 1932, à Montpellier. Les Français l’ont oublié mais il reste présent dans la mémoire collective de nombreux autres pays. Ses liens avec le mouvement sioniste, dans la dernière période de sa vie, lui ont valu quelques détracteurs. Mais il n’était pas homme à s’arrêter à de telles considérations… Le fait qu’il ait été l’un des urbanistes concepteur de la ville de Tel Aviv, ne signifie nullement qu’il aurait accepté le comportement impérialiste et colonisateur de l’Etat d’Israël après la seconde guerre mondiale. Il s’agit là d’un chercheur dont les travaux ont une importance exceptionnelle, tant ses idées étaient innovantes. Espérons qu’une attention croissante lui sera consacrée par ceux qui s’intéressent à l’urbanisme et à l’écologie (entre autres sujets !).
Pour finir, je vous propose de méditer sur ces belles paroles :
 « C’est par les feuilles que nous vivons. Certains ont l’idée étrange que ce serait la monnaie qui les fait vivre. Ils croient que l’énergie est générée par la circulation de l’argent. Alors que le monde est essentiellement une gigantesque colonie de feuillage, se développant et formant non seulement une masse minérale mais une véritable terre de feuilles. Ce n’est pas le tintement des pièces qui nous fait vivre mais bel et bien la plénitude de nos moissons. »
« C’est par les feuilles que nous vivons. Certains ont l’idée étrange que ce serait la monnaie qui les fait vivre. Ils croient que l’énergie est générée par la circulation de l’argent. Alors que le monde est essentiellement une gigantesque colonie de feuillage, se développant et formant non seulement une masse minérale mais une véritable terre de feuilles. Ce n’est pas le tintement des pièces qui nous fait vivre mais bel et bien la plénitude de nos moissons. »
28février2019
Posté par Paul dans la catégorie : au jour le jour...; Notre nature à nous.

Les planches cultivées plus tard restent couvertes.
La tête et les bras dans le jardin, les jambes sur le vélo… Voici le résultat de toutes ces belles journées lumineuses que nous avons eues en février. Je ne sais pas si c’est bien pour la planète, mais c’est bon pour mon moral. En plus je ne respecte ni les bonnes vieilles règles de la sagesse populaire ni les enseignements rigoureux de ma mythique grand-mère lituanienne… J’ai commencé à semer, planter, en sachant très bien que l’habit ne fait pas le moine, qu’un printemps précoce ne met pas à l’abri des gelées tardives, qu’en matière de jardinage il ne faut pas aller plus vite que la musique… et patin couffin ! Que faire alors qu’il est trop tôt pour se lancer dans d’ambitieux projets ? Des choses simples comme nettoyer le potager. Mieux vaut, en fin d’hiver, enlever la couverture végétale de protection sur les parcelles qui vont être cultivées en premier. Si le sol est suffisamment sec on peut aussi commencer à le travailler en choisissant un outil adapté à ses convictions et à la superficie. Pour ma part j’utilise encore fréquemment la motobineuse plutôt que la grelinette. Je crois que je vais recevoir mon premier point noir de la chronique ! Ma terre est riche et profonde et une agitation raisonnable de la couche superficielle ne crée pas vraiment de problème. Il suffit de ne pas faire tourner les fraises à la vitesse d’un mixer de cuisine et de limiter à un passage ou deux par an ce genre de travail. Inutile aussi d’aller chercher trop profond une terre qui ne présente guère d’intérêt.

tamisage du compost pour apport dans la serre
On peut procéder aussi à quelques épandages de compost et surtout s’occuper de celui qui est en cours de fabrication. Printemps et automne sont deux saisons importantes pour cela. On trouve de nombreux déchets végétaux sur le terrain, des fanes de haricots aux tiges de courgettes en passant par les précieuses feuilles mortes et les premiers seaux de plantes provenant du désherbage. Quant au compost ancien, s’il est à peu près mûr, il est temps de le brasser un peu, de le tamiser pour avoir matière à apporter aux premières cultures. J’utilise la même technique que pour les yaourts : le résidu de tamisage rejoint le nouveau tas en formation et sert de ferment. Je suis très content de ce système même s’il est une nouvelle occasion de s’abimer le dos. Je rêve d’un tamis circulaire à moteur (ça existe, mais ça va sûrement me coûter un second point noir !) pour systématiser ce genre de pratique. La solution écolo est indubitablement coopérative. Ce genre de matériel, tondeuse, hache-paille, tamis, motobineuse, houe maraichère… peut être facilement acheté en commun. Vive les CUMA de jardiniers !

élevage en batterie de batavias
Ce qu’il y a de bien c’est qu’on est en avance sur le programme de saison, alors on peut prendre tout son temps pour bien observer autour de soi. La brouette que l’on pousse peut très bien être posée le temps que j’aille surveiller la poussée des jonquilles tardives. Et puis, le soleil est là : comment résister au plaisir de donner quelques bons coups de pioche en se positionnant habilement pour que le soleil chauffe doucement le pauvre dos qui souffre ? Impossible… Pour moi l’appel du dehors est irrésistible et je dois pallier le manque de lumens que m’ont imposé les grisailles hivernales. Même tôt le matin, il fait déjà chaud dans ma serre… Alors il faut bichonner les salades : les arroser, les recoiffer lorsqu’elles sont froissées, leur parler avec un vocabulaire adapté…. Bref créer une ambiance propice à la croissance en leur expliquant que si elles se caillent un peu la nuit ce n’est pas bien grave. Leurs copines, les jonquilles, ne s’arrêtent pas pour si peu, et leurs jolies fleurs jaunes sont déjà épanouies. De temps à autre, on pose l’outil et l’on va observer de plus près quelque chose qui nous intrigue. Si la rangée de fraisiers n’est pas désherbée le soir même, eh bien elle le sera demain !

Cette année ils ont percé tout ce que l’on veut mais pas la neige !
Dans l’ambiance de pénurie végétative qui règne à la fin de l’hiver, on est amené à faire attention au moindre détail : les premières fleurs de Cornus Mas, l’apparition des violettes, la blancheur flamboyante des perce-neige… On aurait presque envie de mesurer au pied à coulisse la croissance de certains bourgeons. Rien à voir avec l’abondance du mois de mai. Je sais qu’à cette période il y aura tant à voir que je ne m’intéresserai plus qu’à la globalité du paysage : taches rouges, jaunes, violettes… exquis tableau multicolore d’un peintre qui se déchaine. Rien de comparable en ces derniers jours de février : il faut une loupe parfois pour détecter les premières nuances de vert, mais quelle décharge d’énergie ! Comme pour les plantes, c’est la croissance de la lumière qui me stimule et, bien entendu, lorsqu’elle est amplifiée par l’ensoleillement quotidien, c’est le nirvana. Bien sûr, je devrais m’inquiéter un peu : est-ce bien normal de commencer à porter des arrosoirs si tôt dans l’année, d’autant que le mois de janvier a été plutôt sec et que la neige s’est principalement contentée d’orner le sommet des montagnes voisines ? Mais je n’envie pas la situation de nos amis canadiens chez qui la saison a été plutôt rigoureuse jusqu’à présent. Egoïsme profond : leurs records de température à moins trente, moins quarante degrés, me font plutôt froid dans le dos même s’ils voient plus souvent le soleil que nous au cœur de l’hiver.

Halte à l’anonymat sur le web. Voici ma photo pour les fichiers de la DCRI. (**)
Je ne suis vraiment pas un mec sérieux. Je fais encore l’effort de m’informer, quotidiennement, mais j’ai besoin des jonquilles, des bleuets et des coquelicots pour résister au côté anxiogène des infos nationales et internationales. J’admire les gilets jaunes qui continuent à résister contre vents et marées, malgré la désinformation et la haine de ceux qui défendent bec et ongles leurs privilèges. Je ne sais que faire lorsque je vois les portraits de ces enfants squelettiques du Yémen, pays auquel on vend des armes avant « d’offrir » du sparadrap. Pas mieux lorsque je réalise qu’à tout instant le dictateur turc peut mettre fin aux expériences sociales précieuses et instructives qui se déroulent au sein de la société kurde du Rojava. Terrifiant de penser que les fous furieux qui dirigent la planète peuvent semer la terreur et la désolation en d’autres contrées que l’on pensait pourtant préservées. Une grande lassitude m’envahit quand on me parle de nouveaux développements de l’industrie nucléaire mortifère ou des ventes d’armes croissantes de la France. Il faut une dose d’insouciance et une carrure solide pour résister à tout cela, à moins que ce ne soit, encore une fois de l’égoïsme…

Qui a dit qu’il n’y avait pas de belles couleurs en février ?
La nature, les randonnées, le jardin me permettent en tout cas de me ressourcer et de récupérer un peu d’énergie et de combattivité, mais c’est de plus en plus dur. Pour résister au sentiment d’être submergé par les pires aspects de l’humanité, je me documente le plus possible sur les actions courageuses de ceux qui rament à contre courant : heureusement, il y en a, même si certains croient, avec un peu trop de facilité, que leur propre bien-être constitue un pas en avant pour l’humanité. Je ne fais pas partie de ceux-là et je reste convaincu que s’il est essentiel d’expérimenter de nouvelles façons de vivre, celles-ci doivent s’extérioriser, se partager, s’élargir… Bonne vieille théorie de la propagande par le fait, sauf qu’il ne s’agit plus cette fois de bâtons de dynamite, mais de monnaies alternatives, d’autogestion, de protection des environnements fragiles, de réseaux horizontaux… Il y en a en tout cas qui se lancent dans des projets coopératifs pour cultiver la terre de façon saine ; d’autres qui cherchent des façons différentes de produire et de gérer de l’énergie, de construire et d’habiter des logements conviviaux ; la solidarité a sa place dans tout cela et c’est formidable. Le dernier DVD que j’ai regardé après avoir bien œuvré de mes mains s’intitule « Nul homme n’est une île », et il est passionnant. Je vous en reparlerai.

Vous noterez que je me rends même à la médiathèque en vélo !
La lenteur de la marche à pied ou celle du vélo me conviennent et les grandes envolées vers de lointaines contrées à portée de réacteurs me tentent moins. Il y a beaucoup à voir à notre porte ou dans le quartier voisin… Je ne me désintéresse pas des Papous de Bornéo ou des Bushman d’Afrique du Sud, mais je me dis que la Sardaigne, le Limousin, ou les Apennins c’est pas mal non plus et plus économique en kérosène. J’ai découvert aussi le vélo. Honte sur moi (mais qui ne me perturbe pas trop non plus), l’assistance électrique subvient à mon dos fatigué, à mes muscles défaillants et à mes genoux inquiets de tant d’agitation. Je supporte vaillamment le regard moqueur de certains pros qui font le tour du pâté de maison en attendant le Tour de France. C’est comme ça ! Ils ont l’arrogance de la jeunesse… Suite à la conférence Négawatt à laquelle j’ai assisté l’un de ces soirs, je me dis que je n’ai pas tout bon pour la décroissance… mais je ne me sens pas non plus responsable de l’état actuel de la planète. On aura du mal à convaincre ceux qui n’ont presque rien ou pas grand chose que notre exemple de développement est mauvais et qu’il faut qu’ils se satisfassent de leur sobriété qu’on qualifiera d’heureuse. Je reviendrai sur ce sujet hautement polémique qui me travaille. Le vélo à assistance m’a en tout cas permis d’améliorer mon rayon de découverte local et je m’en porte fort bien sans que le lithium ne dévore trop mon bien-être musculaire.

Les hémérocalles font une poussée significative dès le mois de février
Vous pensez peut-être que je dévie de ma ligne conductrice en parlant de jardin, puis d’état de la planète en terminant par un bilan de santé de ma musculature. Que non, que non ! Et puis, je vous ai prévenus, je ne suis pas un mec sérieux, pas un de ces blocs de cohérence qui font les militants de choc. Je m’appréhende comme un libertaire non encarté, quelqu’un pour qui l’éthique a plus d’importance que la politique des politicards, un être humain qui a besoin d’une bonne dose d’hédonisme pour respirer sans contrainte et être ouvert aux autres (ce qui n’est pas toujours facile, je le reconnais). Je ne suis ni violent, ni non-violent. Je ne suis ni viandard, ni végétarien. Je supporte une certaine dose d’agressivité, mais, à terme, je deviens vite rancunier. Si l’on me frappe la joue gauche, j’aurais plutôt tendance à chercher une massue pour mettre un terme au débat. La nature, telle que je la vois en œuvre dans mon jardin, mini laboratoire d’expérimentation, me fascine. Essayez donc d’observer, un soir de mai, vers huit heures, une fleur d’onagre qui s’ouvre en dépliant ses pétales et vous comprendrez ce que je veux dire… J’ai une grande soif de connaissances et si mon squelette grince de plus en plus, ma curiosité reste intacte. Comme me le dit un ami ostéopathe (ce qui me fait gentiment sourire) : mon corps terrestre est un peu fatigué, mais mon « enveloppe énergétique » est en bon état. Là-dessus, je retourne au jardin : l’autocélébration de mon nombril a atteint la côte d’alerte !
Notes de fin : (*) j’ai carrément volé le titre de ce billet à celui d’une chanson d’un gars que j’aimais bien mais qu’est plus là pour me le reprocher – Jehan Jonas – et c’est une chouette chanson.
(**) Image n°5. Toutes les photos sont « maison » ; la numéro 5 provient d’une prodigieuse expo de personnages « grandeur nature » dans le village sympathique de Miremont dans le Puy de Dôme (visité à l’automne).
19février2019
Posté par Paul dans la catégorie : Histoire locale, nationale, internationale : pages de mémoire; Portraits d'artistes, de militantes et militants libertaires d'ici et d'ailleurs.

Un petit saut en arrière dans le temps. Un peu plus d’un siècle exactement… Londres 1912. Petit portrait de groupe dans le milieu anarchiste de la capitale. A gauche, un couple. L’homme aux petites lunettes rondes à l’arrière c’est Rudolf Rocker, un militant d’origine allemande, en exil. Il va devenir l’un des théoriciens importants de l’anarchisme (même si ses travaux sont plutôt méconnus en France). Devant lui, une jeune femme avec un chapeau de dimension respectable, fixe le photographe l’air très sérieux. C’est Milly Witcop une militante d’origine ukrainienne, en exil, le sujet principal de cette chronique. Cela fait déjà une quinzaine d’années qu’elle est devenue la compagne de Rocker, l’orateur séduisant qu’elle a rencontré en 1895 lors d’une réunion avec un petit groupe d’activistes juifs dans le quartier d’East End. En 1912, ils ont déjà vécu pas mal d’aventures en commun, dont un voyage aller-retour à New York, mais elle ne se doute pas encore que leur union va durer cinquante huit années au total. La jeune femme va jouer un rôle considérable dans la vie et dans l’œuvre de son compagnon. On conserve le souvenir des personnages importants dans l’histoire sociale ; on oublie trop souvent que certains ont bénéficié, dans l’ombre, du soutien incessant de leur conjoint. Vous me direz qu’il en va de même pour les écrivains, les peintres ou les savants les plus connus… Certes ! Dans le cas du couple Rocker, particulièrement fusionnel, il est important de rendre à Milly la place qui est la sienne : compagne de lutte, inspiratrice, soutien de tous les instants, même si cette femme courageuse n’a signé de son nom aucun écrit important pour la postérité.
 Rien ne prédispose Milly à devenir une activiste féministe, anarchiste, militante infatigable pour la paix, contre le racisme, l’antisémitisme et l’exploitation des travailleurs par le Capital tout-puissant. Elle est née dans la petite ville de Zlatopol en Ukraine. La famille Vitkopsky, de confession juive, est d’origine russe et ukrainienne. Ainée de quatre sœurs, elle est la première à quitter son pays d’origine pour rejoindre la Grande Bretagne, en 1894. Elle espère trouver à Londres un travail suffisamment bien rémunéré pour permettre ensuite au restant de sa famille, dont l’existence est sans cesse menacée par les persécutions, de la rejoindre. Les conditions de travail sont particulièrement dures, même si une solidarité remarquable dans le quartier juif de l’East End permet aux émigrants de survivre. Ce n’est qu’en travaillant sans relâche qu’elle arrive à faire quelques économies pour atteindre son objectif. Elle prend très vite conscience des conditions invraisemblables dans lesquelles elle travaille, ainsi que ses compagnes. La lecture de la brochure rédigée par un anarchiste déjà célèbre à l’époque, Pierre Kropotkine, l’impressionne vivement et l’amène à rompre avec son ancien mode de pensée et ses traditions d’origine. Elle prend contact et s’implique dans l’équipe de militants qui rédige et diffuse le journal de propagande anarchiste « Arbeyter Fraynd ». Un an après son arrivée, elle fait la connaissance de Rudolf Rocker…
Rien ne prédispose Milly à devenir une activiste féministe, anarchiste, militante infatigable pour la paix, contre le racisme, l’antisémitisme et l’exploitation des travailleurs par le Capital tout-puissant. Elle est née dans la petite ville de Zlatopol en Ukraine. La famille Vitkopsky, de confession juive, est d’origine russe et ukrainienne. Ainée de quatre sœurs, elle est la première à quitter son pays d’origine pour rejoindre la Grande Bretagne, en 1894. Elle espère trouver à Londres un travail suffisamment bien rémunéré pour permettre ensuite au restant de sa famille, dont l’existence est sans cesse menacée par les persécutions, de la rejoindre. Les conditions de travail sont particulièrement dures, même si une solidarité remarquable dans le quartier juif de l’East End permet aux émigrants de survivre. Ce n’est qu’en travaillant sans relâche qu’elle arrive à faire quelques économies pour atteindre son objectif. Elle prend très vite conscience des conditions invraisemblables dans lesquelles elle travaille, ainsi que ses compagnes. La lecture de la brochure rédigée par un anarchiste déjà célèbre à l’époque, Pierre Kropotkine, l’impressionne vivement et l’amène à rompre avec son ancien mode de pensée et ses traditions d’origine. Elle prend contact et s’implique dans l’équipe de militants qui rédige et diffuse le journal de propagande anarchiste « Arbeyter Fraynd ». Un an après son arrivée, elle fait la connaissance de Rudolf Rocker…

Milly ayant relativement peu écrit, la majorité des informations sur leur vie commune provient des divers hommages que Rudolf lui a rendus. Voici le portrait qu’il dresse de sa future conjointe lorsqu’il la rencontre :
« Comment et pourquoi la vie nous a-t-elle réunis ? Le comment pourrait encore s’expliquer, mais le pourquoi demeure insondable, comme la vie elle-même […] Pour Milly et moi, voilà donc comment les choses se sont passées : nous nous sommes trouvés et, bien que chacun de nous provint de sphères parfaitement étrangères, nous avons construit notre propre monde. Cela et seulement cela fut l’essentiel de notre vie. Quand j’ai rencontré Milly, il y a soixante ans, à Londres, je faisais partie du groupe Arbeyter Fraynd et travaillais à cette cause autant que je le pouvais. Milly, qui, de par ses origines, était quelqu’un de profondément religieux, trouva en Angleterre une atmosphère très différente de la vie juive qu’elle avait connue dans sa petite ville ukrainienne. Dans les célèbres sweatingshops (exploitations ouvrières) du grand Ghetto de Londres, où elle gagnait tout juste sa vie, il lui arrivait de travailler le jour du shabbath et même d’exécuter des taches qui contrariaient les principes de la religion juive. La jeune fille s’y refusait parfois, et, pour cette raison, perdit plus d’une fois son emploi et traversa des périodes difficiles. […] Le hasard voulut qu’un militant actif du mouvement libertaire de l’East End fut admis dans l’atelier où elle travaillait, et, au cours de discussions, Milly entendit pour la première fois, des choses qui, jusque-là, lui avaient été totalement étrangères et qui provoquèrent en elle un très grand trouble…»
 Dès 1898, il lui propose de l’accompagner à New York où il espère trouver un meilleur emploi. Milly accepte, mais le projet fait long feu. Les nouveaux immigrants sont repoussés à la frontière et rembarquent sur le bateau qui les a amenés. Entre autres éléments reconnus à charge par la très pudibonde Amérique, le fait que leur couple soit illégitime… Dès leur retour à Londres, ils reprennent leurs activités militantes. Outre le journal auquel ils collaboraient déjà, ils lancent une autre revue, « Germinal », dont l’orientation est plus culturelle. En 1907, nait leur fils, Fermin. Rudolf et Milly sont tous deux de farouches opposants à la guerre qui s’en vient à grands pas, ce qui les amène à prendre quelque distance avec Pierre Kropotkine avec lequel ils sont en désaccord complet. Leur militantisme pacifiste n’est pas du goût des autorités gouvernementales anglaises. A la fin de l’année 1914, Rudolf est emprisonné en tant que ressortissant d’un pays ennemi. Milly continue son action et organise notamment des soupes populaires pour les familles de chômeurs. Elle participe également aux manifestations de protestation organisées contre le choix qui est laissé aux immigrants russes : s’enrôler dans l’armée ou être déportés. Elle est arrêtée à son tour en 1916 et condamnée à deux années et demi de prison pour sa rébellion pleinement assumée… On lui promet une libération rapide si elle s’engage à renoncer à toute propagande antiguerre. Elle refuse et reste en prison jusqu’à l’automne 1918. Pendant ce temps, Rudolf est expulsé vers la Hollande en mars 1918. Le gouvernement hollandais ne veut pas de ce personnage important et souhaite le renvoyer en Allemagne, mais les douaniers refusent son entrée sur le territoire et il reste en Hollande jusqu’en novembre 1918, date à laquelle la famille est enfin réunie au complet.
Dès 1898, il lui propose de l’accompagner à New York où il espère trouver un meilleur emploi. Milly accepte, mais le projet fait long feu. Les nouveaux immigrants sont repoussés à la frontière et rembarquent sur le bateau qui les a amenés. Entre autres éléments reconnus à charge par la très pudibonde Amérique, le fait que leur couple soit illégitime… Dès leur retour à Londres, ils reprennent leurs activités militantes. Outre le journal auquel ils collaboraient déjà, ils lancent une autre revue, « Germinal », dont l’orientation est plus culturelle. En 1907, nait leur fils, Fermin. Rudolf et Milly sont tous deux de farouches opposants à la guerre qui s’en vient à grands pas, ce qui les amène à prendre quelque distance avec Pierre Kropotkine avec lequel ils sont en désaccord complet. Leur militantisme pacifiste n’est pas du goût des autorités gouvernementales anglaises. A la fin de l’année 1914, Rudolf est emprisonné en tant que ressortissant d’un pays ennemi. Milly continue son action et organise notamment des soupes populaires pour les familles de chômeurs. Elle participe également aux manifestations de protestation organisées contre le choix qui est laissé aux immigrants russes : s’enrôler dans l’armée ou être déportés. Elle est arrêtée à son tour en 1916 et condamnée à deux années et demi de prison pour sa rébellion pleinement assumée… On lui promet une libération rapide si elle s’engage à renoncer à toute propagande antiguerre. Elle refuse et reste en prison jusqu’à l’automne 1918. Pendant ce temps, Rudolf est expulsé vers la Hollande en mars 1918. Le gouvernement hollandais ne veut pas de ce personnage important et souhaite le renvoyer en Allemagne, mais les douaniers refusent son entrée sur le territoire et il reste en Hollande jusqu’en novembre 1918, date à laquelle la famille est enfin réunie au complet.
 En novembre 1918, profitant du chaos et de la désorganisation, Rocker retourne enfin en Allemagne, vingt-six années après avoir quitté son pays natal. La famille s’installe à Berlin… et reprend ses activités militantes au sein du mouvement syndicaliste révolutionnaire, et notamment de la toute nouvelle formation, la FAUD (Freie Arbeiter Union Deutschlands). Rudolf devient rapidement un personnage clé de ce syndicat aux côtés de ses amis Gustav Landauer et Eric Mühsam. Après l’écrasement de la République de Bavière, et à l’initiative du social démocrate Noske qui fait tirer sur les ouvriers en grève de Berlin, en février 1920, Rocker est emprisonné un mois. Pendant cette période, Milly s’engage aux côtés des femmes du syndicat pour que leur voix soit enfin entendue et que les militantes occupent les places qui doivent être les leurs. Elle participe à la création de l’Union des Femmes, à Berlin, et rédige une brochure intitulée Was will der Syndikalistische Frauenbund? (Qu’est-ce que les syndicats féminins veulent ?). Milly considère que les femmes sont victimes, comme les hommes, de l’exploitation capitaliste, mais qu’elles « bénéficient » d’une seconde exploitation par leurs partenaires masculins. Elle pense que le travail domestique doit être considéré comme tout aussi précieux que le travail salarié. Elle se bat pour une organisation autonome des femmes au sein de la FAUD. Très rapidement, une revue spécifique à la défense des droits des femmes est publiée comme supplément à la revue du syndicat. Des sujets importants sont abordés dans chaque numéro. Le débat sur la sexualité est l’un des plus vigoureux. Milly réclame un accès à la contraception et préconise une « grève de la procréation » pour que ce droit soit obtenu.
En novembre 1918, profitant du chaos et de la désorganisation, Rocker retourne enfin en Allemagne, vingt-six années après avoir quitté son pays natal. La famille s’installe à Berlin… et reprend ses activités militantes au sein du mouvement syndicaliste révolutionnaire, et notamment de la toute nouvelle formation, la FAUD (Freie Arbeiter Union Deutschlands). Rudolf devient rapidement un personnage clé de ce syndicat aux côtés de ses amis Gustav Landauer et Eric Mühsam. Après l’écrasement de la République de Bavière, et à l’initiative du social démocrate Noske qui fait tirer sur les ouvriers en grève de Berlin, en février 1920, Rocker est emprisonné un mois. Pendant cette période, Milly s’engage aux côtés des femmes du syndicat pour que leur voix soit enfin entendue et que les militantes occupent les places qui doivent être les leurs. Elle participe à la création de l’Union des Femmes, à Berlin, et rédige une brochure intitulée Was will der Syndikalistische Frauenbund? (Qu’est-ce que les syndicats féminins veulent ?). Milly considère que les femmes sont victimes, comme les hommes, de l’exploitation capitaliste, mais qu’elles « bénéficient » d’une seconde exploitation par leurs partenaires masculins. Elle pense que le travail domestique doit être considéré comme tout aussi précieux que le travail salarié. Elle se bat pour une organisation autonome des femmes au sein de la FAUD. Très rapidement, une revue spécifique à la défense des droits des femmes est publiée comme supplément à la revue du syndicat. Des sujets importants sont abordés dans chaque numéro. Le débat sur la sexualité est l’un des plus vigoureux. Milly réclame un accès à la contraception et préconise une « grève de la procréation » pour que ce droit soit obtenu.

la revue Germinal
Un autre combat important livré par Milly Witcop est celui qu’elle mène contre l’antisémitisme, bien trop présent à ses yeux au sein du mouvement ouvrier. Dès 1921, la montée en puissance du nouveau parti national socialiste l’inquiète gravement. La situation devient rapidement dangereuse pour les militants révolutionnaires. Même si elle a largement pris ses distances avec ses convictions religieuses, elle n’oublie pas que c’est en grande partie à cause des pogroms que sa famille et elle ont fui la Russie une trentaine d’année auparavant. Peu de temps après l’incendie du Reichstag en février 1933, la famille Rocker fuit à nouveau l’Allemagne pour trouver refuge aux Etats-Unis, après un long périple à travers Suisse, France et Grande-Bretagne. A l’automne 1937, quelques temps après leur arrivée aux USA, les Rocker s’installent à Mohegan, une communauté anarchiste dans le comté de Westchester, où ils résideront jusqu’à la fin de leur vie. Milly, comme Rudolf, combat sur tous les fronts. Tous deux s’engagent à fond pour soutenir le mouvement révolutionnaire en Espagne en juillet 1936. Leur déception est grande lorsqu’ils prennent conscience du fait que les camarades espagnols n’ont plus aucune chance de triompher. Contrairement à l’attitude anti-guerre qu’ils avaient adoptée en 1914, le couple estime que la lutte contre le fascisme sous toutes ses formes est incontournable, et soutient l’engagement des Etats-Unis dans le nouveau conflit mondial en cours. Comme d’autres militants anarchistes, ils estiment que le nazisme ne peut pas être vaincu par une solution pacifiste.

Milly et Rudolf en 1955
A la fin de la deuxième guerre mondiale, Milly s’intéresse au combat du mouvement sioniste, mais elle se questionne rapidement sur la validité de l’idée de création d’un Etat juif comme solution au problème des persécutions. Elle investit beaucoup de son temps dans la solidarité avec le mouvement anarchiste allemand que quelques compagnons essaient de faire renaître de ses cendres. Les libertaires envoient des colis pour aider les survivants pendant la période de ruine de l’après-guerre. Ce militantisme intense est interrompu au milieu des années 50 par de graves soucis de santé. Des problèmes pulmonaires entraînent son hospitalisation. Son état général décline rapidement, même si elle connaît quelques périodes de rémission. Milly décède le 23 novembre 1955. Pendant de longues semaines, Rudolf, Fermin, son fils, ainsi que d’autres compagnes et compagnons ont veillé à son chevet. Je donne à nouveau la parole à son conjoint :
« La nouvelle de sa mort se propagea rapidement. De tous les coins du monde me parvinrent des messages de vieux amis, de groupes libertaires, de syndicats et d’organisations corporatives. De belles paroles furent prononcées à son sujet, si belles qu’elles agirent comme un baume sur cette blessure qui ne se refermera pas avant longtemps. Je suis heureux d’avoir des amis si fidèles qu’ils ont été capables d’atténuer, en cette période douloureuse de ma vie, ce sentiment d’abandon, de solitude provoquée par la mort de Milly. […] Un de ces amis, connaissant bien la nature de la relation qui nous unissait, Milly et moi, m’écrivit, en ces jours : « Vous avez vécu l’un pour l’autre si intensément que rien ne pourra briser ce lien ». Ces paroles, je les ressens au plus profond de moi. »
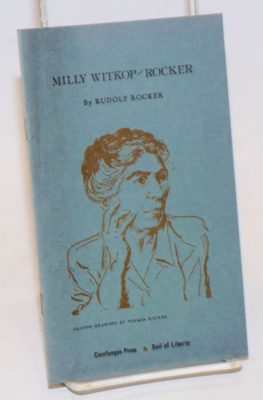 Rudolf Rocker mourut, à son tour, trois années plus tard, en septembre 1958. Durant cette période il continua à écrire et rédigea, entre autres, une brochure en hommage à sa compagne. Ce fait est suffisamment rare pour être signalé ! Bien que ce ne soit pas l’objet de mon propos, je tiens à vous signaler également que l’une des sœurs de Milly, Rose, était également une militante importante au sein du mouvement anarcha-féministe américain. Quant à leur fils Fermin, il devint un peintre réputé dont plusieurs œuvres peuvent être admirées sur le Web. Milly Witcop ayant peu écrit, certains mettront peut-être en doute l’importance du rôle qu’elle a eu dans l’œuvre de son mari. Je conclurai cette chronique en citant un autre extrait de la brochure que lui a consacré Rudolf :
Rudolf Rocker mourut, à son tour, trois années plus tard, en septembre 1958. Durant cette période il continua à écrire et rédigea, entre autres, une brochure en hommage à sa compagne. Ce fait est suffisamment rare pour être signalé ! Bien que ce ne soit pas l’objet de mon propos, je tiens à vous signaler également que l’une des sœurs de Milly, Rose, était également une militante importante au sein du mouvement anarcha-féministe américain. Quant à leur fils Fermin, il devint un peintre réputé dont plusieurs œuvres peuvent être admirées sur le Web. Milly Witcop ayant peu écrit, certains mettront peut-être en doute l’importance du rôle qu’elle a eu dans l’œuvre de son mari. Je conclurai cette chronique en citant un autre extrait de la brochure que lui a consacré Rudolf :
« Cette harmonie qui présida à notre vie commune n’évitait pas, fort heureusement, les points de désaccord. Son intelligence la portait à se faire sa propre opinion sur toute chose et à être capable d’argumenter avec beaucoup d’habileté. Quand, parfois, une discussion nous opposait et que nous nous enflammions, il lui arrivait de me dire, pleine de joie : « Nous sommes un couple singulier. » »

un portrait de sa mère réalisé par Fermin Rocker.
Sources documentaires : sur la Toile, entre autres, Wikipédia et le site « Margaret Sanger Papers Project » ; côté livre, le très remarquable « Rudolf Rocker ou la liberté par en bas », collection « A Contretemps » reprise par les éditions libertaires – le numéro de la revue « Itinéraire » consacré à Rudolf Rocker… Pour les illustrations, les sources indiquées plus les archives du site Anarcoefemèrides.
11février2019
Posté par Paul dans la catégorie : l'alambic culturel; mes lectures.
La première chronique « lecture de l’hiver » était parrainée par le vigneron… mais quoi de plus craquant que l’odeur du pain chaud sorti du four ? La seconde est donc chapeautée par le petit mitron. Désolé Prince de l’Elysée, mais il y a des jours où nous avons envie de bon pain bio ET de brioche, de belles amitiés ET de bons livres… Cinq plats pour le menu du jour… C’est Byzance !
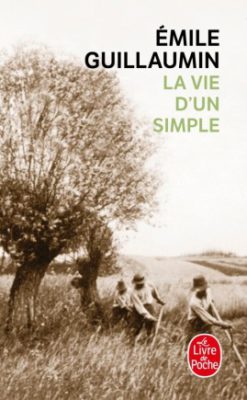 Ces temps-ci, je vous promène pas mal à la campagne (normal c’est mon environnement au quotidien !)… Eh bien, restons-y avec un excellent bouquin qui est loin d’être une nouveauté puisque publié pour la première fois en 1904 : La vie d’un simple, d’Emile Guillaumin. J’ai tardé à lire ce livre bien que j’en ai entendu parler depuis longtemps, notamment dans les écrits de Poulaille. Ayant déjà eu pas mal de déceptions avec des romans basés sur la vie paysanne, je craignais de découvrir un énième roman de terroir, chronique larmoyante d’une famille méritante… En fait, cela a été une belle surprise que ce livre. La beauté du style et la richesse des descriptions ethnologiques rendent sa lecture passionnante. Dès les premières pages on comprend que l’auteur est partie prenante dans son récit et qu’il connait, non seulement par sa réflexion mais aussi par le « toucher » de ses mains, le sujet qu’il traite en profondeur. Il s’agit d’un véritable témoignage sur la vie paysanne au XIXème siècle et les mutations qu’elle va connaître. Emile Guillaumin s’est impliqué dans la naissance du syndicalisme paysan, mais son ouvrage n’a rien d’un cahier de doléances ou de revendications. Il n’a que peu d’estime pour les politiques et quelques descriptions pittoresques témoignent de cette indifférence proche du mépris. Les notables socialisants ne sont pas épargnés. Proche d’un certain nombre d’idées exprimées par les Libertaires, l’auteur, ami de Griffuelhes, de Mirbeau ou de Poulaille, ne s’est jamais impliqué dans un quelconque mouvement. Sa dure vie de paysan-écrivain a mobilisé toute son énergie. Un bon demi-siècle s’écoule entre le début et la fin de « la vie d’un simple » (mi XIXème siècle – début XXème). Une période de changements lents mais réguliers dans le mode de vie. Au fil des pages de ce récit vibrant d’humanité, on se rend compte des aléas multiples auxquels tenait la survie de ces laboureurs, mais on prend aussi conscience de la cupidité de la majorité des propriétaires. Dans l’esprit de certains de ces bourgeois aisés, la place sociale de celui à qui ils louaient leurs terres n’était pas très éloignée de celle du serf au Moyen-Âge. Le héros de l’histoire dénonce toutes les injustices dont il est témoin avec une certaine modération. Il est souvent au bord de la révolte, mais le bon sens paysan domine et limite les propos outranciers. Sans être vraiment ni « partageux » ni socialiste, on sent, tout au long des pages, l’espérance de l’auteur en une évolution de la condition paysanne vers plus d’égalité et de justice. Une belle lecture.
Ces temps-ci, je vous promène pas mal à la campagne (normal c’est mon environnement au quotidien !)… Eh bien, restons-y avec un excellent bouquin qui est loin d’être une nouveauté puisque publié pour la première fois en 1904 : La vie d’un simple, d’Emile Guillaumin. J’ai tardé à lire ce livre bien que j’en ai entendu parler depuis longtemps, notamment dans les écrits de Poulaille. Ayant déjà eu pas mal de déceptions avec des romans basés sur la vie paysanne, je craignais de découvrir un énième roman de terroir, chronique larmoyante d’une famille méritante… En fait, cela a été une belle surprise que ce livre. La beauté du style et la richesse des descriptions ethnologiques rendent sa lecture passionnante. Dès les premières pages on comprend que l’auteur est partie prenante dans son récit et qu’il connait, non seulement par sa réflexion mais aussi par le « toucher » de ses mains, le sujet qu’il traite en profondeur. Il s’agit d’un véritable témoignage sur la vie paysanne au XIXème siècle et les mutations qu’elle va connaître. Emile Guillaumin s’est impliqué dans la naissance du syndicalisme paysan, mais son ouvrage n’a rien d’un cahier de doléances ou de revendications. Il n’a que peu d’estime pour les politiques et quelques descriptions pittoresques témoignent de cette indifférence proche du mépris. Les notables socialisants ne sont pas épargnés. Proche d’un certain nombre d’idées exprimées par les Libertaires, l’auteur, ami de Griffuelhes, de Mirbeau ou de Poulaille, ne s’est jamais impliqué dans un quelconque mouvement. Sa dure vie de paysan-écrivain a mobilisé toute son énergie. Un bon demi-siècle s’écoule entre le début et la fin de « la vie d’un simple » (mi XIXème siècle – début XXème). Une période de changements lents mais réguliers dans le mode de vie. Au fil des pages de ce récit vibrant d’humanité, on se rend compte des aléas multiples auxquels tenait la survie de ces laboureurs, mais on prend aussi conscience de la cupidité de la majorité des propriétaires. Dans l’esprit de certains de ces bourgeois aisés, la place sociale de celui à qui ils louaient leurs terres n’était pas très éloignée de celle du serf au Moyen-Âge. Le héros de l’histoire dénonce toutes les injustices dont il est témoin avec une certaine modération. Il est souvent au bord de la révolte, mais le bon sens paysan domine et limite les propos outranciers. Sans être vraiment ni « partageux » ni socialiste, on sent, tout au long des pages, l’espérance de l’auteur en une évolution de la condition paysanne vers plus d’égalité et de justice. Une belle lecture.
 Guère de points communs entre mon premier et mon second choix, si ce n’est qu’il s’agit encore une fois d’un récit empreint d’une profonde humanité. J’ai découvert, un peu par hasard (mais avec aussi un coup de pouce de la bibliothèque en ligne « Babelio », seul « réseau social » doit je sois membre) « La jeune fille et le fleuve » de Bernard Housseau, aux éditions Passiflore. J’ai tiré grand plaisir de cette lecture et je voudrais vous inciter à faire une découverte que les chroniqueurs de la énième rentrée littéraire n’ont, semble-t-il, pas faite pour l’instant…
Guère de points communs entre mon premier et mon second choix, si ce n’est qu’il s’agit encore une fois d’un récit empreint d’une profonde humanité. J’ai découvert, un peu par hasard (mais avec aussi un coup de pouce de la bibliothèque en ligne « Babelio », seul « réseau social » doit je sois membre) « La jeune fille et le fleuve » de Bernard Housseau, aux éditions Passiflore. J’ai tiré grand plaisir de cette lecture et je voudrais vous inciter à faire une découverte que les chroniqueurs de la énième rentrée littéraire n’ont, semble-t-il, pas faite pour l’instant…
Trois acteurs principaux dans cette histoire : deux êtres humains, un vieil homme dont la vie n’a plus guère de sens (pour une raison qui apparaît assez tard dans le récit), une jeune fille qui erre dans le brouillard et peine à trouver sa voie, et un fleuve, la Garonne, dont les humeurs imprévisibles ne sont pas sans influence sur la vie des riverains. Les deux créatures vont raconter, à tour de rôle, leur rencontre surprenante ; la Garonne est présente, en toile de fond et donne au récit, non seulement son décor, mais également son rythme. C’est un livre qui m’a très vite captivé et que j’ai eu bien du mal à poser. La dernière page tournée, j’ai eu envie de revenir au début, en me disant que ma lecture, trop rapide, m’avait sûrement fait passer à côté de détails précieux (J’ai eu le même sentiment en lisant « Dans la forêt » de Jean Hegland). « La jeune fille et le Fleuve », ce n’est pas un conte de fées, mais une tranche de vie singulière ; certains détails, tristement réalistes, sont là pour rappeler que la vie n’épargne personne et encore moins celles et ceux qui sont issus de quartiers abandonnés et discriminés. C’est toutefois un récit profondément optimiste qui met en valeur le fait qu’un peu de chaleur humaine, un effort de communication, peuvent permettre un rapprochement entre deux êtres que tout semble séparer : non seulement le mode de vie, les préoccupations, mais aussi la barrière qui trop souvent s’impose entre les générations. Il ne s’agit là que d’un roman, certes, pas d’un traité de philosophie, mais il en émane quelques graines de sagesse que l’on peut recueillir et faire pousser avec bonheur dans son jardin intime. Celui qui est différent mérite d’être connu et non repoussé d’un geste méprisant. C’est parfois en se tournant vers « l’autre », que l’on peut espérer résoudre certains problèmes apparemment insolubles. J’ai retrouvé, à travers les dialogues des personnages, des situations que nous avons parfois effleurées lorsque nous discutons avec les « voyageurs » plus ou moins jeunes que nous hébergeons à la belle saison. Leur présence apporte un gain de vitalité ; nos points de vue, appuyés sur une expérience de vie un peu plus longue, les aident à certaines occasions à avancer dans leur propre réflexion. Ce facteur a sans doute joué son rôle dans mon approche du livre ; je dois dire aussi que le style de l’auteur, très plaisant, ainsi que notre amour commun pour le bois, ont eu leur influence !
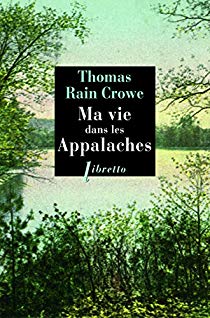 Les fans de Thoreau vont se régaler avec « Ma vie dans les Appalaches » de Thomas Rain Crowe. La filiation entre cet ouvrage et « Walden ou la vie dans les bois » est évidente et revendiquée par l’auteur. Son idée de départ, avant de se lancer dans l’expérience qu’il décrit dans son livre, est de faire comme son mentor – vivre dans une cabane en autarcie partielle – mais de prolonger son expérience pendant plusieurs années plutôt que de la limiter à une douzaine de mois. J’ai beaucoup aimé ce livre ; certains chapitres m’ont un peu moins accroché que d’autres mais j’ai apprécié la dernière partie malgré la nostalgie dont elle est pétrie. Au bout du compte, je me demande même si je n’ai pas préféré ce récit-là au Walden de Thoreau. Je craignais un peu au début que l’ouvrage soit écrit dans un esprit « guiness book », genre « il a tenu deux ans, moi je tiendrai quatre »… Dès le début du livre on comprend que ce n’est pas cet état d’esprit qui guide notre nouvel ermite. De plus, le temps qui sépare les deux expériences est suffisant pour que les données sociétales et environnementales ne soient plus les mêmes. Déjà entre les années 70 où se situe l’histoire et la décennie que nous parcourons à grandes enjambées, bien des éléments ont à nouveau changé et pas dans le bon sens. Bref, nous voilà face à un journal, pas vraiment chronologique, mais plutôt thématique. Les récits de vie quotidienne sont entrecoupés de réflexions intéressantes sur l’écologie, la place de l’argent dans notre monde, ou le peu de cas que nous faisons des savoirs ancestraux. Certaines idées prêtent à débat – probablement – mais il y a dans cet ouvrage matière à une réflexion sur des thèmes très concrets, abordés de manière non pontifiante. Par contre, si vous êtes amateurs d’intrigues et de péripéties rocambolesques, mieux vaut chercher ailleurs ! Personnellement, la vie d’ermite ne me conviendrait guère : les solutions communautaires, les réseaux, le partage… me paraissent plus adaptés… mais à travers le récit de Thomas Rain Crowe, de vraies questions sont posées et méritent que l’on cherche une ou des réponses possibles.
Les fans de Thoreau vont se régaler avec « Ma vie dans les Appalaches » de Thomas Rain Crowe. La filiation entre cet ouvrage et « Walden ou la vie dans les bois » est évidente et revendiquée par l’auteur. Son idée de départ, avant de se lancer dans l’expérience qu’il décrit dans son livre, est de faire comme son mentor – vivre dans une cabane en autarcie partielle – mais de prolonger son expérience pendant plusieurs années plutôt que de la limiter à une douzaine de mois. J’ai beaucoup aimé ce livre ; certains chapitres m’ont un peu moins accroché que d’autres mais j’ai apprécié la dernière partie malgré la nostalgie dont elle est pétrie. Au bout du compte, je me demande même si je n’ai pas préféré ce récit-là au Walden de Thoreau. Je craignais un peu au début que l’ouvrage soit écrit dans un esprit « guiness book », genre « il a tenu deux ans, moi je tiendrai quatre »… Dès le début du livre on comprend que ce n’est pas cet état d’esprit qui guide notre nouvel ermite. De plus, le temps qui sépare les deux expériences est suffisant pour que les données sociétales et environnementales ne soient plus les mêmes. Déjà entre les années 70 où se situe l’histoire et la décennie que nous parcourons à grandes enjambées, bien des éléments ont à nouveau changé et pas dans le bon sens. Bref, nous voilà face à un journal, pas vraiment chronologique, mais plutôt thématique. Les récits de vie quotidienne sont entrecoupés de réflexions intéressantes sur l’écologie, la place de l’argent dans notre monde, ou le peu de cas que nous faisons des savoirs ancestraux. Certaines idées prêtent à débat – probablement – mais il y a dans cet ouvrage matière à une réflexion sur des thèmes très concrets, abordés de manière non pontifiante. Par contre, si vous êtes amateurs d’intrigues et de péripéties rocambolesques, mieux vaut chercher ailleurs ! Personnellement, la vie d’ermite ne me conviendrait guère : les solutions communautaires, les réseaux, le partage… me paraissent plus adaptés… mais à travers le récit de Thomas Rain Crowe, de vraies questions sont posées et méritent que l’on cherche une ou des réponses possibles.
 Des péripéties, le livre « La naufragée du lac des dents blanches » de Patrice Gain aux éditions « Le mot et le reste » n’en manque pas. J’ai découvert ce livre un peu par hasard ; l’originalité du titre, le résumé de la quatrième de couverture et la confiance assez large que j’accorde à cette petite société d’édition marseillaise ont fait le reste. Je n’ai pas été déçu : l’auteur surfe avec habileté entre les passages mélodramatiques, l’humour de certains dialogues et la poésie des descriptions… Deux pêcheurs, pour se remettre d’un naufrage au large de l’île d’Ouessant, séjournent quelques temps dans le chalet d’un de leurs amis, en Haute-Savoie. Lors d’une randonnée, tout là-haut, dans l’éternité blanche, au bord d’un lac curieusement nommé, ils rencontrent une jeune femme noire épuisée. Elle se nomme Saamyia ; elle a fui son pays, la Somalie, où règne la terreur policière ; elle cherche désespérément les traces de sa fille Sahra dont elle a été séparée au cours de son périple. Nos deux héros et leur hôte se prennent de sympathie pour elle et décident de lui prêter assistance pour la suite de son enquête. Elle a besoin d’aide pour rejoindre la Suisse toute proche et prendre contact avec une institution charitable qui aurait pris son enfant en charge… Il n’en faut pas plus pour que nos quatre « zozos » ne se lancent à l’aventure… Débute alors une série d’aventures rocambolesques, une sorte de road movie en bateau, à pied, en motoneige… Plus nos enquêteurs avancent, plus leur objectif recule ; les raisons de désespérer sont nombreuses mais personne n’abandonne. Les trois hommes ont une attitude qui me rappelle parfois les personnages foutraques de la BD « les vieux fourneaux »… Le mélange des genres est pourtant une réussite : aucune maladresse, beaucoup d’humanité et de tendresse dans les relations au sein de ce quatuor improbable d’aventuriers… Difficile d’inscrire dans une catégorie quelconque ce livre qui a en tout cas le mérite d’évoquer de manière originale un thème tout à fait d’actualité à propos duquel la majorité de nos concitoyens ne brille pas par ses opinions et ses comportements.
Des péripéties, le livre « La naufragée du lac des dents blanches » de Patrice Gain aux éditions « Le mot et le reste » n’en manque pas. J’ai découvert ce livre un peu par hasard ; l’originalité du titre, le résumé de la quatrième de couverture et la confiance assez large que j’accorde à cette petite société d’édition marseillaise ont fait le reste. Je n’ai pas été déçu : l’auteur surfe avec habileté entre les passages mélodramatiques, l’humour de certains dialogues et la poésie des descriptions… Deux pêcheurs, pour se remettre d’un naufrage au large de l’île d’Ouessant, séjournent quelques temps dans le chalet d’un de leurs amis, en Haute-Savoie. Lors d’une randonnée, tout là-haut, dans l’éternité blanche, au bord d’un lac curieusement nommé, ils rencontrent une jeune femme noire épuisée. Elle se nomme Saamyia ; elle a fui son pays, la Somalie, où règne la terreur policière ; elle cherche désespérément les traces de sa fille Sahra dont elle a été séparée au cours de son périple. Nos deux héros et leur hôte se prennent de sympathie pour elle et décident de lui prêter assistance pour la suite de son enquête. Elle a besoin d’aide pour rejoindre la Suisse toute proche et prendre contact avec une institution charitable qui aurait pris son enfant en charge… Il n’en faut pas plus pour que nos quatre « zozos » ne se lancent à l’aventure… Débute alors une série d’aventures rocambolesques, une sorte de road movie en bateau, à pied, en motoneige… Plus nos enquêteurs avancent, plus leur objectif recule ; les raisons de désespérer sont nombreuses mais personne n’abandonne. Les trois hommes ont une attitude qui me rappelle parfois les personnages foutraques de la BD « les vieux fourneaux »… Le mélange des genres est pourtant une réussite : aucune maladresse, beaucoup d’humanité et de tendresse dans les relations au sein de ce quatuor improbable d’aventuriers… Difficile d’inscrire dans une catégorie quelconque ce livre qui a en tout cas le mérite d’évoquer de manière originale un thème tout à fait d’actualité à propos duquel la majorité de nos concitoyens ne brille pas par ses opinions et ses comportements.
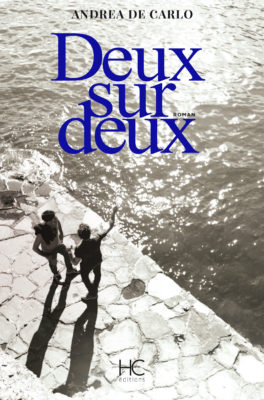 Dernier livre de cette deuxième sélection (attention il ne s’agit pas d’un classement !), « Deux sur deux« , roman écrit par un auteur italien, Andrea de Carlo, traduit et publié chez HC éditions. L’un de mes livres préférés de cet automne, mais comme je n’ai rien publié à cette période et qu’il s’agit d’un petit bijou dans le genre, il rejoint cette liste à la dernière minute. De quoi s’agit-il alors ? De façon tout à fait banale, d’une tranche de vie. On fait la connaissance des deux personnages principaux alors qu’ils sont encore au lycée. Ils suivent le même parcours politique et rejettent une société dont ils dénoncent les valeurs et à laquelle ils refusent de s’intégrer. Par la suite, la vie les sépare et tous deux suivent un parcours très différent, intégration ou marginalité… avant qu’ils ne se retrouvent et que les hasards de l’existence les amènent à confronter l’évolution de leur philosophie et surtout de leur comportement social. Dès le début, je me suis intéressé à ces personnages : j’ai eu l’impression de visionner à nouveau le film « le péril jeune » de Cédric Klapisch, qui fait partie de mes bobines préférées. Cette perception s’est ensuite estompée car le cheminement des personnages centraux d’Andréa de Carlo diverge vers des contrées que Klapisch (qui se limite aux années lycée) n’a pas explorées. L’auteur raconte la confrontation de ses deux personnages avec une société dont ils continuent à rejeter les valeurs mais à laquelle il semble que l’on soit contraint et forcé de s’adapter. Ce cheminement chaotique (surtout pour le plus « flamboyant » des deux garçons) est décrit avec subtilité et humanisme. le style de l’auteur est agréable à lire, et beaucoup de portraits ou de descriptions sonnent fort juste à mes yeux. J’aime beaucoup aussi le rôle joué par leur compagne, loin d’être secondaire.
Dernier livre de cette deuxième sélection (attention il ne s’agit pas d’un classement !), « Deux sur deux« , roman écrit par un auteur italien, Andrea de Carlo, traduit et publié chez HC éditions. L’un de mes livres préférés de cet automne, mais comme je n’ai rien publié à cette période et qu’il s’agit d’un petit bijou dans le genre, il rejoint cette liste à la dernière minute. De quoi s’agit-il alors ? De façon tout à fait banale, d’une tranche de vie. On fait la connaissance des deux personnages principaux alors qu’ils sont encore au lycée. Ils suivent le même parcours politique et rejettent une société dont ils dénoncent les valeurs et à laquelle ils refusent de s’intégrer. Par la suite, la vie les sépare et tous deux suivent un parcours très différent, intégration ou marginalité… avant qu’ils ne se retrouvent et que les hasards de l’existence les amènent à confronter l’évolution de leur philosophie et surtout de leur comportement social. Dès le début, je me suis intéressé à ces personnages : j’ai eu l’impression de visionner à nouveau le film « le péril jeune » de Cédric Klapisch, qui fait partie de mes bobines préférées. Cette perception s’est ensuite estompée car le cheminement des personnages centraux d’Andréa de Carlo diverge vers des contrées que Klapisch (qui se limite aux années lycée) n’a pas explorées. L’auteur raconte la confrontation de ses deux personnages avec une société dont ils continuent à rejeter les valeurs mais à laquelle il semble que l’on soit contraint et forcé de s’adapter. Ce cheminement chaotique (surtout pour le plus « flamboyant » des deux garçons) est décrit avec subtilité et humanisme. le style de l’auteur est agréable à lire, et beaucoup de portraits ou de descriptions sonnent fort juste à mes yeux. J’aime beaucoup aussi le rôle joué par leur compagne, loin d’être secondaire.
Chaque fois que j’apprécie le début d’une histoire, j’ai la même inquiétude : je me demande de quelle façon l’auteur va terminer son récit, avec l’angoisse constante que la fin me déçoive ; chance… la fin de cette histoire ne m’a pas déçu ; je dirai même qu’elle a été à la hauteur de mes espérances !
L’auteur ne se limite pas à décrire le bien-être (ou le mal-être) psychologique des deux amis, mais dépeint également leurs expériences professionnelles et leurs idées sur le rapport qu’ils peuvent avoir avec le monde. Est-ce possible de développer un ilot de paix dans un univers aussi conflictuel ? Peut-on échapper aux lois du système marchand libéral et au règne de l’argent roi ? Ces questions reviennent comme un leitmotiv au fil des pages. J’ai trouvé là un livre que j’ai eu bien de la peine à poser, même s’il ne s’y déroule aucune intrigue fracassante. Il ne s’agit, somme toute, que du récit d’une tranche de vie assez banale, mais dans lequel j’ai découvert de nombreuses résonances avec mes propres interrogations !
A la revoyure comme disait mon pote le bateleur.
3février2019
Posté par Paul dans la catégorie : au jour le jour...; Notre nature à nous.
 Balade matinale. La route goudronnée traverse un hameau et les constructions neuves, sans âme, qui sont venues le faire grossir. Elle continue sur quelques mètres puis devient chemin. L’herbe pousse dans les dernières flaques de bitume. Les talus, sur le bord, imprimés depuis longtemps dans le paysage, montrent qu’il s’agit d’un itinéraire ancien. Le passage plutôt fréquent des tracteurs conserve la trace bien visible. Il a gelé pendant la nuit et l’humidité est encore bien présente. Nos pas hésitent entre les ornières boueuses laissées par les roues, ou la bande centrale herbeuse où nos chaussures se gorgent d’eau : terre collante qui nécessitera un solide décapage des semelles ou chaussettes mouillées. Choix cornélien interrompu par la vue surprenante d’un arbre mort au milieu du labour. Il ne reste que les branches maîtresses et le tronc, un squelette d’arbre vénérable en quelque sorte. Il penche un peu et son avenir paraît précaire. Il est surprenant même que ni la charrue ni le tracteur ne soit venu à bout de cet acrobate chenu…
Balade matinale. La route goudronnée traverse un hameau et les constructions neuves, sans âme, qui sont venues le faire grossir. Elle continue sur quelques mètres puis devient chemin. L’herbe pousse dans les dernières flaques de bitume. Les talus, sur le bord, imprimés depuis longtemps dans le paysage, montrent qu’il s’agit d’un itinéraire ancien. Le passage plutôt fréquent des tracteurs conserve la trace bien visible. Il a gelé pendant la nuit et l’humidité est encore bien présente. Nos pas hésitent entre les ornières boueuses laissées par les roues, ou la bande centrale herbeuse où nos chaussures se gorgent d’eau : terre collante qui nécessitera un solide décapage des semelles ou chaussettes mouillées. Choix cornélien interrompu par la vue surprenante d’un arbre mort au milieu du labour. Il ne reste que les branches maîtresses et le tronc, un squelette d’arbre vénérable en quelque sorte. Il penche un peu et son avenir paraît précaire. Il est surprenant même que ni la charrue ni le tracteur ne soit venu à bout de cet acrobate chenu…
Cette vision interrompt le questionnement terre à terre qui occupe mon cerveau embrumé. Du coup, une pointe de nostalgie m’envahit et déforme quelque peu ma perception du décor qui m’environne. Le ciel est bleu mais il y a quelques nuages qui cherchent à s’assembler. Ce chemin, ce paysage, je les connais bien ; cela fait des années que nous refaisons le même circuit dans les environs de la maison. Une sorte de pèlerinage… Passé, présent, je ne sais plus trop vers quel environnement nous cheminons.
 Plus loin, un autre arbre, cousin du premier sans doute, a eu l’outrecuidance cet automne ou celui d’avant, de tomber en travers du chemin, déraciné par le vent ou par des labours trop proches de ses racines. Il reste quelques feuilles mortes sur les branches ce qui permet au randonneur détective de le ranger dans la catégorie des chênes blancs. Le diamètre du tronc, au niveau de la souche, est énorme, un peu plus d’un mètre sans doute. Lui, c’est évident, on ne l’a pas vu dans son enfance, ni à l’adolescence : un bon siècle sans doute. Le bois est sain mais une fente circulaire suit l’un des cernes, en plein milieu… Il s’agit d’un défaut que les scieurs nomment « roulure » (à ne pas confondre avec la gélivure qui est une fente rayonnante). Séquelle du coup de froid sibérien du fameux hiver 56 ? La première photo que nous prenons laisse un doute quant à sa taille. Dans la seconde, nous introduisons « l’échelle humaine » qui ne laisse planer aucune équivoque…
Plus loin, un autre arbre, cousin du premier sans doute, a eu l’outrecuidance cet automne ou celui d’avant, de tomber en travers du chemin, déraciné par le vent ou par des labours trop proches de ses racines. Il reste quelques feuilles mortes sur les branches ce qui permet au randonneur détective de le ranger dans la catégorie des chênes blancs. Le diamètre du tronc, au niveau de la souche, est énorme, un peu plus d’un mètre sans doute. Lui, c’est évident, on ne l’a pas vu dans son enfance, ni à l’adolescence : un bon siècle sans doute. Le bois est sain mais une fente circulaire suit l’un des cernes, en plein milieu… Il s’agit d’un défaut que les scieurs nomment « roulure » (à ne pas confondre avec la gélivure qui est une fente rayonnante). Séquelle du coup de froid sibérien du fameux hiver 56 ? La première photo que nous prenons laisse un doute quant à sa taille. Dans la seconde, nous introduisons « l’échelle humaine » qui ne laisse planer aucune équivoque…
 L’arbre poussait en bordure du chemin. Sa disparition permettra de gagner quelques mètres carrés de labour et une brassée de maïs supplémentaire. Dans les champs céréaliers, les arbres ne sont plus les bienvenus, même s’ils ont repris un peu la cote dans les pâturages. Nous sommes au faîte d’une colline et l’on ne voit pas l’extrémité de la parcelle labourée ; les sillons plongent dans la vallée. Au milieu de la terre subsiste un ilot de broussailles autour d’une bâtisse en ruines. Ce lieu a un certain écho dans nos souvenirs. Retour dans le passé, à l’époque où le vent rêveur du jeu de rôles avait quelque peu titillé notre imagination. Certaines aventures avaient lieu non pas autour d’une table, mais en pleine forêt, de nuit, de préférence. Lors d’un repérage, ce site particulier nous avait intrigués. Notre esprit créatif avait fait le reste et le vieux cabanon en pisé était devenu la ruine du logis d’un sorcier redoutable : la « tour des nuages ». Quelques fumigènes avaient accentué l’étrangeté du spectacle pour nos aventuriers prêts à se laisser entraîner. Magnifique promotion pour ce qui n’était sans doute qu’un cabanon de vigne. Ajoutez la lumière de la lune sur fond d’obscurité angoissante et le tableau devenait encore plus crédible. Trente ans de cela et les vieux murs en pisé tiennent toujours debout, obligeant la charrue à se détourner de son trajet rectiligne. Etonnant que la bâtisse, obstacle à l’avancée irrésistible du progrès technologique, soit toujours là. Trop de pierres, de ronces sans doute, qui font maintenant le bonheur des dernières vipères rouges du plateau.
L’arbre poussait en bordure du chemin. Sa disparition permettra de gagner quelques mètres carrés de labour et une brassée de maïs supplémentaire. Dans les champs céréaliers, les arbres ne sont plus les bienvenus, même s’ils ont repris un peu la cote dans les pâturages. Nous sommes au faîte d’une colline et l’on ne voit pas l’extrémité de la parcelle labourée ; les sillons plongent dans la vallée. Au milieu de la terre subsiste un ilot de broussailles autour d’une bâtisse en ruines. Ce lieu a un certain écho dans nos souvenirs. Retour dans le passé, à l’époque où le vent rêveur du jeu de rôles avait quelque peu titillé notre imagination. Certaines aventures avaient lieu non pas autour d’une table, mais en pleine forêt, de nuit, de préférence. Lors d’un repérage, ce site particulier nous avait intrigués. Notre esprit créatif avait fait le reste et le vieux cabanon en pisé était devenu la ruine du logis d’un sorcier redoutable : la « tour des nuages ». Quelques fumigènes avaient accentué l’étrangeté du spectacle pour nos aventuriers prêts à se laisser entraîner. Magnifique promotion pour ce qui n’était sans doute qu’un cabanon de vigne. Ajoutez la lumière de la lune sur fond d’obscurité angoissante et le tableau devenait encore plus crédible. Trente ans de cela et les vieux murs en pisé tiennent toujours debout, obligeant la charrue à se détourner de son trajet rectiligne. Etonnant que la bâtisse, obstacle à l’avancée irrésistible du progrès technologique, soit toujours là. Trop de pierres, de ronces sans doute, qui font maintenant le bonheur des dernières vipères rouges du plateau.
 Un peu plus loin, en arrivant vers le haut de la colline, se dresse un petit bois d’épicéas, une anomalie, une sorte de verrue au milieu des feuillus. Ma compagne me dit qu’elle se rappelle les avoir vus peu après leur plantation… Je n’en sais rien. Ma mémoire n’est pas aussi bonne que la sienne. Les arbres sont en mauvais état. Ils n’ont pas été « éclaircis » comme on dit quand on est du métier. Il y a un demi-siècle de cela on incitait tous les propriétaires de boisés à faire place nette pour planter des résineux. Sur les prospectus, on disait « c’est comme les peupliers, ça pousse tout seul, vite, sans entretien et quelques dizaines d’années plus tard, coupe rase et pactole dans la poche du vaillant planteur. » Mensonge de la propagande (celle-ci comme toutes les autres), c’était omettre de préciser qu’obtenir du bois de rapport nécessite un entretien régulier ; c’était aussi se garder de prévenir les assassins de feuillus que l’on n’importait pas des espèces au hasard dans une zone forestière et que chaque essence avait ses exigences. Les études sylvicoles ont progressé et l’on sait maintenant qu’une forêt est un ensemble vivant complexe au sein duquel les arbres s’entraident ; certaines espèces en supportent mieux d’autres et, faute de mycorhize convenable, les importations exogènes dépériront et disparaitront bien souvent à la génération suivante.
Un peu plus loin, en arrivant vers le haut de la colline, se dresse un petit bois d’épicéas, une anomalie, une sorte de verrue au milieu des feuillus. Ma compagne me dit qu’elle se rappelle les avoir vus peu après leur plantation… Je n’en sais rien. Ma mémoire n’est pas aussi bonne que la sienne. Les arbres sont en mauvais état. Ils n’ont pas été « éclaircis » comme on dit quand on est du métier. Il y a un demi-siècle de cela on incitait tous les propriétaires de boisés à faire place nette pour planter des résineux. Sur les prospectus, on disait « c’est comme les peupliers, ça pousse tout seul, vite, sans entretien et quelques dizaines d’années plus tard, coupe rase et pactole dans la poche du vaillant planteur. » Mensonge de la propagande (celle-ci comme toutes les autres), c’était omettre de préciser qu’obtenir du bois de rapport nécessite un entretien régulier ; c’était aussi se garder de prévenir les assassins de feuillus que l’on n’importait pas des espèces au hasard dans une zone forestière et que chaque essence avait ses exigences. Les études sylvicoles ont progressé et l’on sait maintenant qu’une forêt est un ensemble vivant complexe au sein duquel les arbres s’entraident ; certaines espèces en supportent mieux d’autres et, faute de mycorhize convenable, les importations exogènes dépériront et disparaitront bien souvent à la génération suivante.
 Notre chemin avance dans la forêt. Depuis notre dernier passage il y a eu quelques coupes. L’une d’entre elles attire notre regard. Les bûcherons ont pris leur temps et travaillé « à l’ancienne » c’est à dire proprement. Le taillis a été coupé à blanc, mais ceux qui se sont chargés de l’abattage ont pris soin de laisser en place quelques chênes au port majestueux. Ils sont suffisamment rapprochés pour que leur ombre protège les jeunes pousses qui se développent à leur pied, et pour que le vent n’ait pas trop la tâche facile pour les pousser à la chute. J’admire au passage quelques jolis troncs qui dominent leurs voisins au milieu de la forêt intacte ; je reconnais quelques merisiers, des acacias, d’autres chênes préservés par les anciens lorsqu’ils ont fait leur coupe. Un voisin paysan, fort sage, m’avait expliqué que sur cette colline, on pouvait couper le taillis de châtaignier ou d’acacia tous les vingt ans, mais qu’il fallait laisser les plus belles pousses, les perches isolées et bien droites ; il fallait sauter au moins deux ou trois coupes… si l’on voulait des fûts de qualité pour faire les tonneaux… Les forestiers appellent ce genre de parcelle du taillis sous futaie. Cela me paraît être une exploitation intelligente de la ressource. Nous nous chauffons au bois et il faut bien que la cargaison de bûches qu’engloutit notre chaudière vienne de quelque part. Quant au châtaignier, s’il dépasse une soixantaine d’années, il devient un arbre remarquable, offre des fruits savoureux au promeneur, mais son bois perd tout intérêt comme bois d’œuvre. Le contraire du chêne en quelque sorte !
Notre chemin avance dans la forêt. Depuis notre dernier passage il y a eu quelques coupes. L’une d’entre elles attire notre regard. Les bûcherons ont pris leur temps et travaillé « à l’ancienne » c’est à dire proprement. Le taillis a été coupé à blanc, mais ceux qui se sont chargés de l’abattage ont pris soin de laisser en place quelques chênes au port majestueux. Ils sont suffisamment rapprochés pour que leur ombre protège les jeunes pousses qui se développent à leur pied, et pour que le vent n’ait pas trop la tâche facile pour les pousser à la chute. J’admire au passage quelques jolis troncs qui dominent leurs voisins au milieu de la forêt intacte ; je reconnais quelques merisiers, des acacias, d’autres chênes préservés par les anciens lorsqu’ils ont fait leur coupe. Un voisin paysan, fort sage, m’avait expliqué que sur cette colline, on pouvait couper le taillis de châtaignier ou d’acacia tous les vingt ans, mais qu’il fallait laisser les plus belles pousses, les perches isolées et bien droites ; il fallait sauter au moins deux ou trois coupes… si l’on voulait des fûts de qualité pour faire les tonneaux… Les forestiers appellent ce genre de parcelle du taillis sous futaie. Cela me paraît être une exploitation intelligente de la ressource. Nous nous chauffons au bois et il faut bien que la cargaison de bûches qu’engloutit notre chaudière vienne de quelque part. Quant au châtaignier, s’il dépasse une soixantaine d’années, il devient un arbre remarquable, offre des fruits savoureux au promeneur, mais son bois perd tout intérêt comme bois d’œuvre. Le contraire du chêne en quelque sorte !
 Il y a une sorte d’ivresse de la marche ; il me semble que nous avançons d’un pas plus rapide et plus assuré. Les randonneurs chevronnés vous le diront : ce sont les premiers kilomètres qui coûtent le plus cher. Après, on va de l’avant sans trop se poser de questions. La longue grimpette que nous avons suivie est terminée également et cela facilite le travail pour nos jambes vieillissantes. Il n’y a peut-être pas à aller chercher plus loin notre accélération sensible.
Il y a une sorte d’ivresse de la marche ; il me semble que nous avançons d’un pas plus rapide et plus assuré. Les randonneurs chevronnés vous le diront : ce sont les premiers kilomètres qui coûtent le plus cher. Après, on va de l’avant sans trop se poser de questions. La longue grimpette que nous avons suivie est terminée également et cela facilite le travail pour nos jambes vieillissantes. Il n’y a peut-être pas à aller chercher plus loin notre accélération sensible.
La tête occupée par toutes ces réflexions je ne me suis pas rendu compte que nous arrivions près de la petite pièce d’eau, une serve, que j’appelle « le lac en pente »… Ce nom singulier, je l’ai donné un jour, il y a pas mal d’années maintenant, pour essayer d’éveiller la curiosité d’une charmante demoiselle d’une dizaine d’années qui marchait en trainant la patte, peu motivée par nos conversations d’adultes, plutôt éloignées de ses préoccupations. Rien de tel qu’une bonne vieille histoire dans un cas pareil, surtout pour éveiller la curiosité et motiver à aller voir plus loin… « Si, si, je t’assure… Patiente encore quelques minutes, tu verras… Quant à savoir dans quelles conditions une étendue d’eau peut se dispenser de s’étaler paresseusement à l’horizontale, eh bien les esprits rationalistes chagrins devront repasser un autre jour. Au pays des fées et des lutins, mon histoire tenait bien la route. Si je m’en remémore tous les détails, je vous la conterai un de ces jours. L’ami François qui lit régulièrement mes chroniques et a sûrement une fort bonne mémoire se souvient certainement de cette histoire.
Une centaine de mètres plus loin, nous avons rejoint la route goudronnée et nous sommes rentrés en passant par le « chef-lieu ». Fini de musarder ! Lorsque midi sonne au clocher, il y a autre chose que l’adrénaline qui pousse à accélérer le pas… !
Cette chronique m’a été inspirée par notre balade matinale du jour sur une petite route goudronnée. Celle qui se transforme en chemin forestier et … longe une serve en pente.

Quant à l’actualité « bubonique » on en parle bien assez comme ça. Sauf que ce n’est plus tant la peste noire qui nous menace, que la brune, sournoise, insidieuse, qui cherche la moindre brèche pour s’infiltrer.
27janvier2019
Posté par Paul dans la catégorie : l'alambic culturel; mes lectures.
Le temps est propice à la lecture ; le froid n’est pas intense mais omniprésent ; le gris est la couleur dominante de la palette et le vent du Nord ne se fait pas oublier. Je lis beaucoup, deux ou trois livres par semaine peut-être et je ne vais pas tous les évoquer ici ! Je préfère vous parler des ouvrages que j’ai placés en haut du panier. Je n’aime pas parler des livres que je n’ai pas appréciés. Il s’agit parfois d’ouvrages que je n’ai pas lus au bon moment et mon rendez-vous raté n’est pas un prétexte suffisant pour tirer sur l’auteur à boulets rouges.
Fin du palabre d’introduction ; je me lance !
 Deux bons romans graphiques sur le même thème et de la même auteure pour commencer. Il s’agit de « Disgrazia » et de « Mais pour toi demain il fera beau » de Coline Picaud, éditions « le monde à l’envers », Grenoble. Je vous conseille de lire ces deux livres dans l’ordre indiqué, même si ce sont deux récits indépendants. Le thème ? Eh bien il s’agit de raconter l’immigration italienne en France au XXème siècle, à travers l’histoire d’une famille, celle de l’auteure. Nous voilà partis pour une découverte d’arbre généalogique, parfois un peu « fouillis » mais ô combien sympathique et pleine d’humanité. La France, terre d’accueil ? On peut avoir des doutes lorsque l’on vient de lire la chronique que j’ai écrite à propos de la « Retirada » ; on en a encore plus lorsque l’on découvre dans quelles conditions ont été accueillis les nouveaux arrivants d’autres contrées, que ce soit la Pologne, l’Italie ou l’Afrique du Nord… Ce qui est intéressant dans le récit de Coline Picaud, c’est qu’au travers d’événements familiaux, on découvre l’histoire du monde ouvrier, la vie quotidienne des « sans dents » préférés de notre bon président : conditions de vie misérables, combats, victoires, défaites, solidarité, individualisme… De grandes questions sont traitées au fil des pages. En toile de fond, le Front populaire, la guerre mondiale, la libération… pour le tome 1 ; les grandes grèves ouvrières comme celle des Penn Sardines, la naissance des Auberges de Jeunesse ou l’affirmation du féminisme pour le tome 2. Bref c’est fouillé, c’est « nourrissant », et ce sont deux livres sur lesquels on a envie de revenir pour mieux comprendre, mieux enregistrer. Au début, je n’étais pas fan du graphisme, mais je m’y suis rapidement habitué. Si vous aimez les récits structurés, hyper-ordonnés, vous risquez d’être un peu déstabilisés, mais si vous avez eu déjà l’occasion de prêter attention à un arbre généalogique alors vous comprendrez la logique singulière de l’histoire. Personnellement, c’est une période que je connais assez bien, surtout à travers les récits d’historiens. Je trouve particulièrement intéressant de découvrir le récit d’événements à travers le témoignage de ceux qui y ont été impliqués, parfois au degré zéro. Quelques portraits très colorés de dirigeants communistes de l’époque : je pense en particulier à celui de Charles Tillon stalinien notoire pour lequel je n’ai guère de sympathie. Merci à l’auteure aussi d’évoquer la présence de militant(e)s anarchistes dans les luttes ; omission trop fréquente sous la plume des historiens officiels du Parti avec un grand P.
Deux bons romans graphiques sur le même thème et de la même auteure pour commencer. Il s’agit de « Disgrazia » et de « Mais pour toi demain il fera beau » de Coline Picaud, éditions « le monde à l’envers », Grenoble. Je vous conseille de lire ces deux livres dans l’ordre indiqué, même si ce sont deux récits indépendants. Le thème ? Eh bien il s’agit de raconter l’immigration italienne en France au XXème siècle, à travers l’histoire d’une famille, celle de l’auteure. Nous voilà partis pour une découverte d’arbre généalogique, parfois un peu « fouillis » mais ô combien sympathique et pleine d’humanité. La France, terre d’accueil ? On peut avoir des doutes lorsque l’on vient de lire la chronique que j’ai écrite à propos de la « Retirada » ; on en a encore plus lorsque l’on découvre dans quelles conditions ont été accueillis les nouveaux arrivants d’autres contrées, que ce soit la Pologne, l’Italie ou l’Afrique du Nord… Ce qui est intéressant dans le récit de Coline Picaud, c’est qu’au travers d’événements familiaux, on découvre l’histoire du monde ouvrier, la vie quotidienne des « sans dents » préférés de notre bon président : conditions de vie misérables, combats, victoires, défaites, solidarité, individualisme… De grandes questions sont traitées au fil des pages. En toile de fond, le Front populaire, la guerre mondiale, la libération… pour le tome 1 ; les grandes grèves ouvrières comme celle des Penn Sardines, la naissance des Auberges de Jeunesse ou l’affirmation du féminisme pour le tome 2. Bref c’est fouillé, c’est « nourrissant », et ce sont deux livres sur lesquels on a envie de revenir pour mieux comprendre, mieux enregistrer. Au début, je n’étais pas fan du graphisme, mais je m’y suis rapidement habitué. Si vous aimez les récits structurés, hyper-ordonnés, vous risquez d’être un peu déstabilisés, mais si vous avez eu déjà l’occasion de prêter attention à un arbre généalogique alors vous comprendrez la logique singulière de l’histoire. Personnellement, c’est une période que je connais assez bien, surtout à travers les récits d’historiens. Je trouve particulièrement intéressant de découvrir le récit d’événements à travers le témoignage de ceux qui y ont été impliqués, parfois au degré zéro. Quelques portraits très colorés de dirigeants communistes de l’époque : je pense en particulier à celui de Charles Tillon stalinien notoire pour lequel je n’ai guère de sympathie. Merci à l’auteure aussi d’évoquer la présence de militant(e)s anarchistes dans les luttes ; omission trop fréquente sous la plume des historiens officiels du Parti avec un grand P.
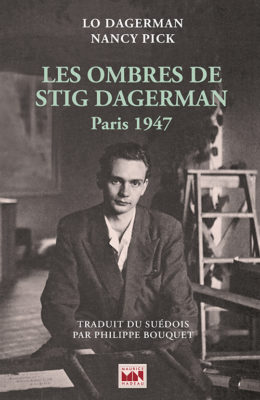 Pour apprécier (comme cela a été mon cas) le troisième ouvrage de ma sélection, « Les ombres de Stig Dagerman« , il vaut mieux connaître les relations entre l’écrivain suédois Stig Dagerman et la militante d’origine autrichienne Etta Federn. Pour le premier, la meilleure solution c’est de se plonger dans une biographie ou directement dans un roman : « automne allemand » ou « printemps français » parmi d’autres. Je ne vais pas vous dresser à nouveau un portrait de ces deux personnages singuliers ; je l’ai déjà fait ! Comme toujours, la « Feuille charbinoise » est présente pour vous aider à vous cultiver… A relire donc : « Stig Dagerman, étoile filante de la littérature suédoise » et « Allemagne, Espagne, France, le long combat pour la liberté d’Etta Federn« … Ce bagage est suffisant pour apprécier le propos des « ombres de Stig Dagerman ». Stig Dagerman fait la connaissance d’Etta Federn en 1947 à Paris. Les deux personnages sont fascinés l’un par l’autre et deviennent très rapidement amis. Peu de temps après la naissance de cette amitié, Stig Dagerman écrit une pièce de théâtre « l’ombre de Mart », dont le scénario est visiblement inspiré des relations d’Etta avec son dernier fils. L’écrivain suédois dresse un tableau apocalyptique des relations entre la mère et le fils : exercice périlleux lorsque l’on parle de ses proches ! La pièce se termine par un matricide qui n’a rien de vraiment surprenant. Quels liens avec la réalité que l’auteur a côtoyée à Paris ? En 1952, l’écrivain, pourtant au faite de sa gloire littéraire, se suicide…
Pour apprécier (comme cela a été mon cas) le troisième ouvrage de ma sélection, « Les ombres de Stig Dagerman« , il vaut mieux connaître les relations entre l’écrivain suédois Stig Dagerman et la militante d’origine autrichienne Etta Federn. Pour le premier, la meilleure solution c’est de se plonger dans une biographie ou directement dans un roman : « automne allemand » ou « printemps français » parmi d’autres. Je ne vais pas vous dresser à nouveau un portrait de ces deux personnages singuliers ; je l’ai déjà fait ! Comme toujours, la « Feuille charbinoise » est présente pour vous aider à vous cultiver… A relire donc : « Stig Dagerman, étoile filante de la littérature suédoise » et « Allemagne, Espagne, France, le long combat pour la liberté d’Etta Federn« … Ce bagage est suffisant pour apprécier le propos des « ombres de Stig Dagerman ». Stig Dagerman fait la connaissance d’Etta Federn en 1947 à Paris. Les deux personnages sont fascinés l’un par l’autre et deviennent très rapidement amis. Peu de temps après la naissance de cette amitié, Stig Dagerman écrit une pièce de théâtre « l’ombre de Mart », dont le scénario est visiblement inspiré des relations d’Etta avec son dernier fils. L’écrivain suédois dresse un tableau apocalyptique des relations entre la mère et le fils : exercice périlleux lorsque l’on parle de ses proches ! La pièce se termine par un matricide qui n’a rien de vraiment surprenant. Quels liens avec la réalité que l’auteur a côtoyée à Paris ? En 1952, l’écrivain, pourtant au faite de sa gloire littéraire, se suicide…
Le livre se présente comme une enquête sur cet ensemble de faits singuliers. Ce qui est original c’est que la tentative de démêler les fils de l’écheveau est confiée à deux personnes qui ne se connaissent pas au début du travail d’écriture, mais qui ont un lien de parenté direct avec les protagonistes, Stig et Etern… L’une des auteures est Lo Dagerman, fille de Stig, et l’autre, Nancy Pick, une proche parente d’Etta. Au fil des pages et du déroulement de l’enquête, la relation entre les deux femmes se construit elle aussi… Alors que le conflit qu’elles étudient aurait pu les séparer, les conclusions qu’elles tirent ont plutôt tendance à les rapprocher. Ce qui est intéressant aussi c’est que ce livre, résultat d’un travail de recherche approfondi, permet d’avoir de nouveaux éclairages sur l’histoire peu ordinaire de l’écrivain suédois. C’est paru aux éditions Maurice Nadeau et j’avoue que c’est un livre que j’ai lu presque d’une traite, après avoir relu, moi aussi, mes propres chroniques (histoire de boucher les trous nombreux qui parsèment le mur de ma mémoire !).
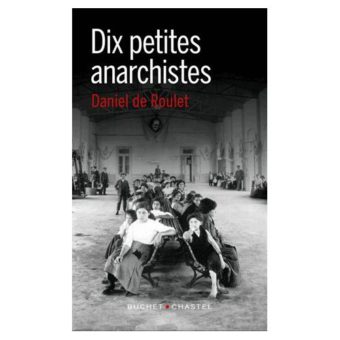 Italie, Espagne, Suède… Cet hiver, je voyage dans mon fauteuil. Nouvelle escale, en Patagonie cette fois, avec le livre de Daniel de Roulet, « Dix petites anarchistes« , aux éditions Buchet-Chastel… Beaucoup de sympathie pour ce roman profondément humain, original, fort bien écrit et basé sur un assemblage solidement documenté de faits réels. Certes l’histoire n’est qu’une fiction, mais, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il s’en est passé des choses dans le milieu libertaire au tournant du XIXème au XXème siècle ! Les tentatives pour créer « ici et maintenant » une utopie que l’on était pressés de voir se réaliser, sans attendre le lendemain du « grand soir », ont été nombreuses. La Cecilia, colonie montée par des militantes et militants italiens est la plus « médiatisée » (si l’on peut dire) mais les expériences se dénombrent par centaine. Objet principal du propos de l’auteur, le projet de ces jeunes libertaires du vallon de St Ismier dans le Jura suisse est original : créer une colonie anarchiste à la pointe méridionale du continent sud-américain ; rester « entre femmes », au moins dans les premiers temps. Elles sont dix à mettre en commun leurs idées un peu folles et leurs maigres moyens financiers. Quelque peu abusées par la propagande de l’époque (incitant à l’émigration les Suisses les plus pauvres), leur choix de destination est plutôt improbable puisqu’il s’agit de la Patagonie, la « terre de feu » de sinistre mémoire dans les récits des navigateurs. Mais la rigueur du climat et de l’accueil des colons déjà installés ne viendront pas à bout de leur résolution. Les luttes, les échecs, mais aussi les réussites (car le récit n’a rien de larmoyant) vont être nombreux. Au fur et à mesure de l’avancée de l’histoire, la petite troupe du départ perd peu à peu ses membres pour des motifs assez variés. Parmi les multiples idées lumineuses du « metteur en scène » de ce récit, celle d’avoir choisi une trame inspirée par « les dix petits nègres » d’une romancière célèbre… Comme « mise en bouche » ou, selon votre souhait, comme « postface », je vous invite à écouter un débat avec l’auteur sur la RTS. Un seul reproche à formuler : pour une fois, j’aurais souhaité que le livre soit un peu plus « copieux » : il y avait matière à développements et certains épisodes de l’histoire auraient gagné à être un peu plus développés.
Italie, Espagne, Suède… Cet hiver, je voyage dans mon fauteuil. Nouvelle escale, en Patagonie cette fois, avec le livre de Daniel de Roulet, « Dix petites anarchistes« , aux éditions Buchet-Chastel… Beaucoup de sympathie pour ce roman profondément humain, original, fort bien écrit et basé sur un assemblage solidement documenté de faits réels. Certes l’histoire n’est qu’une fiction, mais, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il s’en est passé des choses dans le milieu libertaire au tournant du XIXème au XXème siècle ! Les tentatives pour créer « ici et maintenant » une utopie que l’on était pressés de voir se réaliser, sans attendre le lendemain du « grand soir », ont été nombreuses. La Cecilia, colonie montée par des militantes et militants italiens est la plus « médiatisée » (si l’on peut dire) mais les expériences se dénombrent par centaine. Objet principal du propos de l’auteur, le projet de ces jeunes libertaires du vallon de St Ismier dans le Jura suisse est original : créer une colonie anarchiste à la pointe méridionale du continent sud-américain ; rester « entre femmes », au moins dans les premiers temps. Elles sont dix à mettre en commun leurs idées un peu folles et leurs maigres moyens financiers. Quelque peu abusées par la propagande de l’époque (incitant à l’émigration les Suisses les plus pauvres), leur choix de destination est plutôt improbable puisqu’il s’agit de la Patagonie, la « terre de feu » de sinistre mémoire dans les récits des navigateurs. Mais la rigueur du climat et de l’accueil des colons déjà installés ne viendront pas à bout de leur résolution. Les luttes, les échecs, mais aussi les réussites (car le récit n’a rien de larmoyant) vont être nombreux. Au fur et à mesure de l’avancée de l’histoire, la petite troupe du départ perd peu à peu ses membres pour des motifs assez variés. Parmi les multiples idées lumineuses du « metteur en scène » de ce récit, celle d’avoir choisi une trame inspirée par « les dix petits nègres » d’une romancière célèbre… Comme « mise en bouche » ou, selon votre souhait, comme « postface », je vous invite à écouter un débat avec l’auteur sur la RTS. Un seul reproche à formuler : pour une fois, j’aurais souhaité que le livre soit un peu plus « copieux » : il y avait matière à développements et certains épisodes de l’histoire auraient gagné à être un peu plus développés.
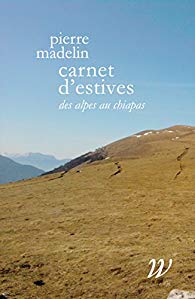 « Carnet d’estives, des Alpes au Chiapas« … J’avoue que j’étais un peu dubitatif en abordant ce livre : auteur inconnu, thème faisant l’objet d’abondantes publications, souvent redondantes. Jamais, je pense, on a autant écrit sur la nature, la montagne, les animaux, l’écologie, alors que concrètement, sur le terrain, la situation va en se dégradant à une vitesse inquiétante. Eh bien je reconnais nettement que j’avais tort d’avoir des doutes. L’ouvrage de Pierre Madelin, collection de brefs récits sur le thème de la vie pastorale, de la montagne et du rapport entre l’homme et la nature, est fort intéressant et soutenu par une réflexion solide et argumentée. L’auteur nous fait voyager effectivement des Alpes au Chiapas avec une brève escale dans les parcs nationaux aux USA… Le style est vivant, le propos souvent mordant, et je partage nombre des idées exprimées par l’auteur (ce qui, après tout, ne fait qu’améliorer le confort du lecteur !). Ma lecture terminée, cela m’a donné envie de découvrir son second opus « après le capitalisme« , qui traite d’un problème d’une actualité brûlante. Peut-on encore faire prendre un virage à ce train fou qui se précipite droit contre la montagne ? Et quel virage si l’on veut que l’homme puisse enfin établir un rapport harmonieux avec l’ensemble des êtres vivants (y compris lui-même) tout en jouissant d’une liberté à laquelle il aspire depuis les origines ?… Le sujet est plus aride et j’avoue avoir préféré le récit du berger à celui du théoricien que j’ai trouvé un peu touffu. Cela ne m’empêche pas de vous en recommander aussi la lecture. Il est intéressant de réfléchir à quoi « demain sera fait » s’il y a encore un demain ! Le premier livre est publié chez « Wildproject éditions » et le second chez « Ecosociété ».
« Carnet d’estives, des Alpes au Chiapas« … J’avoue que j’étais un peu dubitatif en abordant ce livre : auteur inconnu, thème faisant l’objet d’abondantes publications, souvent redondantes. Jamais, je pense, on a autant écrit sur la nature, la montagne, les animaux, l’écologie, alors que concrètement, sur le terrain, la situation va en se dégradant à une vitesse inquiétante. Eh bien je reconnais nettement que j’avais tort d’avoir des doutes. L’ouvrage de Pierre Madelin, collection de brefs récits sur le thème de la vie pastorale, de la montagne et du rapport entre l’homme et la nature, est fort intéressant et soutenu par une réflexion solide et argumentée. L’auteur nous fait voyager effectivement des Alpes au Chiapas avec une brève escale dans les parcs nationaux aux USA… Le style est vivant, le propos souvent mordant, et je partage nombre des idées exprimées par l’auteur (ce qui, après tout, ne fait qu’améliorer le confort du lecteur !). Ma lecture terminée, cela m’a donné envie de découvrir son second opus « après le capitalisme« , qui traite d’un problème d’une actualité brûlante. Peut-on encore faire prendre un virage à ce train fou qui se précipite droit contre la montagne ? Et quel virage si l’on veut que l’homme puisse enfin établir un rapport harmonieux avec l’ensemble des êtres vivants (y compris lui-même) tout en jouissant d’une liberté à laquelle il aspire depuis les origines ?… Le sujet est plus aride et j’avoue avoir préféré le récit du berger à celui du théoricien que j’ai trouvé un peu touffu. Cela ne m’empêche pas de vous en recommander aussi la lecture. Il est intéressant de réfléchir à quoi « demain sera fait » s’il y a encore un demain ! Le premier livre est publié chez « Wildproject éditions » et le second chez « Ecosociété ».
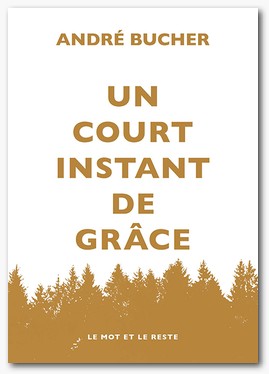 Je termine ce premier inventaire hivernal, par un livre d’André Bucher, notre « écrivain naturaliste » national (désolé, je n’aime pas le terme « nature writing » qui me paraît venir d’une autre langue…), « Un court instant de grâce » publié chez l’excellent éditeur « Le mot et le reste ». Chaque année je découvre un ou deux volumes supplémentaires de l’œuvre plutôt conséquente de cet auteur. C’est une valeur sûre de ma bibliothèque et je suis rarement déçu. Ça n’a toujours pas été le cas avec ce livre qui raconte l’accouchement difficile d’un amour entre deux fortes personnalités d’un certain âge et d’un âge certain. Tout cela est emballé de main de maître dans un décor de montagne somptueux : forêts, torrents, chemins sinueux… Au cœur du roman, une de ces forêts que nos technocrates investisseurs modernes rêvent à tout prix de « normaliser » et de « rentabiliser ». Bien entendu, ces pourfendeurs d’archaïsmes économiques sont handicapés dans leur valeureuse entreprise par les menées d’une écologiste vénérable ; l’une de ces grands-mères que l’on rencontre de plus en plus souvent dans les manifestations, pour lesquelles la « qualité de vie » passe bien avant les profits et la courbe ascendante du CACA 40. Je ne vous dis pas qui gagne à la fin mais sachez que l’histoire m’a profondément touché et tirez-en un indice grâce à votre perspicacité. En attendant ma prochaine lecture de ce grand Monsieur drômois, prenez bien soin de votre petite personne et admirez les flocons plus que les flacons ! En tout cas, tous ces livres et bien d’autres peuvent être consommés sans modération.
Je termine ce premier inventaire hivernal, par un livre d’André Bucher, notre « écrivain naturaliste » national (désolé, je n’aime pas le terme « nature writing » qui me paraît venir d’une autre langue…), « Un court instant de grâce » publié chez l’excellent éditeur « Le mot et le reste ». Chaque année je découvre un ou deux volumes supplémentaires de l’œuvre plutôt conséquente de cet auteur. C’est une valeur sûre de ma bibliothèque et je suis rarement déçu. Ça n’a toujours pas été le cas avec ce livre qui raconte l’accouchement difficile d’un amour entre deux fortes personnalités d’un certain âge et d’un âge certain. Tout cela est emballé de main de maître dans un décor de montagne somptueux : forêts, torrents, chemins sinueux… Au cœur du roman, une de ces forêts que nos technocrates investisseurs modernes rêvent à tout prix de « normaliser » et de « rentabiliser ». Bien entendu, ces pourfendeurs d’archaïsmes économiques sont handicapés dans leur valeureuse entreprise par les menées d’une écologiste vénérable ; l’une de ces grands-mères que l’on rencontre de plus en plus souvent dans les manifestations, pour lesquelles la « qualité de vie » passe bien avant les profits et la courbe ascendante du CACA 40. Je ne vous dis pas qui gagne à la fin mais sachez que l’histoire m’a profondément touché et tirez-en un indice grâce à votre perspicacité. En attendant ma prochaine lecture de ce grand Monsieur drômois, prenez bien soin de votre petite personne et admirez les flocons plus que les flacons ! En tout cas, tous ces livres et bien d’autres peuvent être consommés sans modération.
21janvier2019
Posté par Paul dans la catégorie : Espagne révolutionnaire 1936-39; Histoire locale, nationale, internationale : pages de mémoire.

Janvier 1939 : la « Retirada ». Ce terme désigne l’exode massif à travers les frontières des Pyrénées des soldats, des militants républicains espagnols et de leurs familles, face à la répression franquiste impitoyable qui s’abat sur l’Espagne reconquise. Rien ou très peu n’a été prévu côté français, concernant l’accueil de ces réfugiés bien que l’issue du conflit paraisse évidente depuis plusieurs mois. La trahison des Staliniens et l’indifférence des pays voisins condamne la tentative révolutionnaire menée par les militants des organisations révolutionnaires comme la CNT, la FAI, le POUM, et une partie importante de l’UGT. La chute de Tarragone, annonçant le début du siège de Barcelone, met un terme aux espérances de ceux qui croyaient encore en un dernier sursaut. La capitale de la Catalogne est dévastée par les bombardements incessants. Il est un moment où le courage et la détermination seuls ne suffisent plus face au rouleau compresseur des forces fascistes surarmées par leurs alliés allemands et italiens. Les derniers combats menés par les combattants de la République ont pour seul objectif de laisser le temps, à tous ceux qui le souhaitent, de fuir la répression annoncée. Beaucoup de celles et ceux qui ont joué un rôle actif dans le processus révolutionnaire en cours depuis trois années n’ont aucune pitié à attendre de la part des vainqueurs. Leur seul espoir de survie c’est de se mettre à l’abri, et – comme le pensent bon nombre de ces combattants•tes – de retrouver des forces pour pouvoir reprendre le combat sous forme de guérilla. Parmi ceux qui ont choisi la France comme refuge, peu se doutent de l’accueil que va leur offrir le « pays des droits de l’homme ». Il faut attendre le 28 janvier pour que la frontière soit enfin déclarée officiellement ouverte. Les nouveaux arrivants dont on peut estimer le nombre à un demi-million, sont convoyés comme du bétail, et enfermés dans des zones les plus improbables. L’exemple type est le camp d’Argelès, dont l’aménagement consiste, dans un premier temps, à la pose de rangées successives de barbelés. Aucun abri, aucun sanitaire. Seule la surveillance, confiée à des tirailleurs sénégalais, est organisée. Les Espagnols doivent creuser des trous dans le sable pour s’abriter de l’humidité et du froid hivernal. Près de cent mille personnes vont être parquées là et seront amenées peu à peu à construire des abris de fortune puis des baraquements sommaires. Les morts se comptent par centaines, les épidémies prolifèrent.
 Le ton est donné dès le passage de la frontière. La police française, secondée par l’armée, effectue un premier tri entre les combattants d’une part (qui sont systématiquement dépouillés de leurs armes) et les civils. Les humiliations et souvent les mauvais traitements s’accumulent pour ces hommes et ces femmes qui ont su résister pendant plus de trois années à une guerre impitoyable et à un impressionnant déséquilibre des forces militaires en présence. Mais il ne s’agit là que des préliminaires de l’improvisation qui va suivre. Comme on le leur répète à longueur de journée : « les rouges ne sont pas les bienvenus » et « la France est bien bonne de ne pas purement et simplement les refouler de l’autre côté de la frontière ». Par chance, tous les citoyens de notre pays ne marchent pas au pas derrière la lâcheté de leur gouvernement. Dans les mois qui vont suivre, quelques Républicains chanceux seront accueillis à bras ouvert dans des familles pour lesquelles le terme de solidarité n’est pas un mot creux. Mais la très grande majorité de ceux qui vont passer la frontière n’aura pas cette chance. Ils vont se retrouver dans des camps de concentration obligeamment mis à leur disposition par les autorités. Femmes, enfants, vieillards, infirmes… sont parqués dans des lieux qui ont conservé pour les survivants et leurs descendants une sinistre réputation : Rivesaltes, Argelès, Gurs, le Vernet, Septfonds… Pour la plupart, ces camps seront installés en grande hâte, et continueront à jouer leur rôle pendant une partie de la guerre : Juifs, Tziganes, Maquisards… occuperont les places des Espagnols ; les camps serviront alors de « vivier » pour les déportations vers les camps de la mort en Allemagne.
Le ton est donné dès le passage de la frontière. La police française, secondée par l’armée, effectue un premier tri entre les combattants d’une part (qui sont systématiquement dépouillés de leurs armes) et les civils. Les humiliations et souvent les mauvais traitements s’accumulent pour ces hommes et ces femmes qui ont su résister pendant plus de trois années à une guerre impitoyable et à un impressionnant déséquilibre des forces militaires en présence. Mais il ne s’agit là que des préliminaires de l’improvisation qui va suivre. Comme on le leur répète à longueur de journée : « les rouges ne sont pas les bienvenus » et « la France est bien bonne de ne pas purement et simplement les refouler de l’autre côté de la frontière ». Par chance, tous les citoyens de notre pays ne marchent pas au pas derrière la lâcheté de leur gouvernement. Dans les mois qui vont suivre, quelques Républicains chanceux seront accueillis à bras ouvert dans des familles pour lesquelles le terme de solidarité n’est pas un mot creux. Mais la très grande majorité de ceux qui vont passer la frontière n’aura pas cette chance. Ils vont se retrouver dans des camps de concentration obligeamment mis à leur disposition par les autorités. Femmes, enfants, vieillards, infirmes… sont parqués dans des lieux qui ont conservé pour les survivants et leurs descendants une sinistre réputation : Rivesaltes, Argelès, Gurs, le Vernet, Septfonds… Pour la plupart, ces camps seront installés en grande hâte, et continueront à jouer leur rôle pendant une partie de la guerre : Juifs, Tziganes, Maquisards… occuperont les places des Espagnols ; les camps serviront alors de « vivier » pour les déportations vers les camps de la mort en Allemagne.
 Dès l’approche du printemps, le gouvernement, soucieux d’alléger la « charge » que représentent tous ces internés pour les départements limitrophes de la frontière, met en œuvre un certain nombre de procédures. En premier lieu, la décentralisation : de nouveaux camps sont créés à l’intérieur du pays, chaque département ou presque devant héberger son lot d’indésirables. J’ai raconté cela en détail dans les deux billets où j’ai parlé d’un camp d’internement méconnu et proche de mon domicile, celui d’Arandon. Cette solution temporaire n’est pas la seule envisagée. Très vite, on incite les réfugiés à retourner dans leur pays d’origine ; la propagande explique que non, il n’y a pas tant de risque que cela, que ceux qui n’ont pas commis de crimes graves ne seront pas inquiétés… discours de pure propagande qui fonctionne un peu, mais pas trop, heureusement, car parmi ceux qui écoutent les boniments gouvernementaux, beaucoup y laisseront la vie ou la liberté pour de longues années. Le nouveau régime fasciste en place ne pardonne rien et exécute massivement. Pour ce qui est des combattants, on leur propose de rejoindre la Légion étrangère ou les camps de travail pour étrangers qui sont mis en place. Il est hors de question que notre pays perde le bénéfice d’une main d’œuvre que l’on peut faire travailler dans des conditions proches de l’esclavage. Ils sont assez nombreux à accepter ce changement de statut, d’autant que certains de ces anciens miliciens souhaitent participer à la guerre contre l’Allemagne n’oubliant pas l’aide que ce pays a apporté à Franco. Une partie d’entre eux seront envoyés par exemple sur la ligne Maginot pour participer aux travaux de consolidation ; pris en tenaille par l’offensive allemande, ils auront la joie de connaître d’autres camps, de l’autre côté du Rhin cette fois-ci. Les Espagnols bénéficient d’un « traitement de faveur » de la part des Nazis : dans le camp de Mauthausen, 80% des détenus sont espagnols. 8 000 périront en déportation.
Dès l’approche du printemps, le gouvernement, soucieux d’alléger la « charge » que représentent tous ces internés pour les départements limitrophes de la frontière, met en œuvre un certain nombre de procédures. En premier lieu, la décentralisation : de nouveaux camps sont créés à l’intérieur du pays, chaque département ou presque devant héberger son lot d’indésirables. J’ai raconté cela en détail dans les deux billets où j’ai parlé d’un camp d’internement méconnu et proche de mon domicile, celui d’Arandon. Cette solution temporaire n’est pas la seule envisagée. Très vite, on incite les réfugiés à retourner dans leur pays d’origine ; la propagande explique que non, il n’y a pas tant de risque que cela, que ceux qui n’ont pas commis de crimes graves ne seront pas inquiétés… discours de pure propagande qui fonctionne un peu, mais pas trop, heureusement, car parmi ceux qui écoutent les boniments gouvernementaux, beaucoup y laisseront la vie ou la liberté pour de longues années. Le nouveau régime fasciste en place ne pardonne rien et exécute massivement. Pour ce qui est des combattants, on leur propose de rejoindre la Légion étrangère ou les camps de travail pour étrangers qui sont mis en place. Il est hors de question que notre pays perde le bénéfice d’une main d’œuvre que l’on peut faire travailler dans des conditions proches de l’esclavage. Ils sont assez nombreux à accepter ce changement de statut, d’autant que certains de ces anciens miliciens souhaitent participer à la guerre contre l’Allemagne n’oubliant pas l’aide que ce pays a apporté à Franco. Une partie d’entre eux seront envoyés par exemple sur la ligne Maginot pour participer aux travaux de consolidation ; pris en tenaille par l’offensive allemande, ils auront la joie de connaître d’autres camps, de l’autre côté du Rhin cette fois-ci. Les Espagnols bénéficient d’un « traitement de faveur » de la part des Nazis : dans le camp de Mauthausen, 80% des détenus sont espagnols. 8 000 périront en déportation.
 Concernant cette « Retirada », les chiffres sont terriblement éloquents. Cinq cent mille personnes environ franchissent la frontière entre janvier et mars 1939. Plus de 350 ooo sont enfermées dans la quinzaine de camps de concentration établis en France (Argelès 100 000, Saint-Cyprien 80 000, Barcarès, Rivesaltes 75 000, Gurs 25 000, Brame, Agde… etc…). Si l’on a guère le temps de fournir un équipement de survie, on a le temps de faire des listes, des statistiques et des tris. Le camp du Vernet se spécialise peu à peu dans l’hébergement des anarchistes (les miliciens de la Colonne Durutti par exemple), détenus dangereux s’il en est ! Plusieurs milliers d’entre eux y passeront. On interne dans le camp de Gurs une grande partie des combattants. Le régime imposé dans ces deux derniers camps est particulièrement sévère. A Gurs, quatre cents baraquements construits à la hâte permettent de « neutraliser » soldats espagnols et volontaires étrangers des Brigades Internationales. Les conditions de détention sont ignobles : les hommes vivent dans la boue et sont surveillés comme des criminels. Dès la défaite de juin 1939, le régime de Vichy reprend la gestion de ce camp et s’en sert pour interner les juifs victimes des premières rafles. Gurs est pour eux la dernière étape avant les camps de la mort en Allemagne. Les occupants précédents du camp se sont peu à peu volatilisés : incorporés dans les CTE (camps de travail étrangers), évadés et plus ou moins intégrés dans les villes et villages, volontaires pour le maquis, ou purement et simplement livrés à Franco.
Concernant cette « Retirada », les chiffres sont terriblement éloquents. Cinq cent mille personnes environ franchissent la frontière entre janvier et mars 1939. Plus de 350 ooo sont enfermées dans la quinzaine de camps de concentration établis en France (Argelès 100 000, Saint-Cyprien 80 000, Barcarès, Rivesaltes 75 000, Gurs 25 000, Brame, Agde… etc…). Si l’on a guère le temps de fournir un équipement de survie, on a le temps de faire des listes, des statistiques et des tris. Le camp du Vernet se spécialise peu à peu dans l’hébergement des anarchistes (les miliciens de la Colonne Durutti par exemple), détenus dangereux s’il en est ! Plusieurs milliers d’entre eux y passeront. On interne dans le camp de Gurs une grande partie des combattants. Le régime imposé dans ces deux derniers camps est particulièrement sévère. A Gurs, quatre cents baraquements construits à la hâte permettent de « neutraliser » soldats espagnols et volontaires étrangers des Brigades Internationales. Les conditions de détention sont ignobles : les hommes vivent dans la boue et sont surveillés comme des criminels. Dès la défaite de juin 1939, le régime de Vichy reprend la gestion de ce camp et s’en sert pour interner les juifs victimes des premières rafles. Gurs est pour eux la dernière étape avant les camps de la mort en Allemagne. Les occupants précédents du camp se sont peu à peu volatilisés : incorporés dans les CTE (camps de travail étrangers), évadés et plus ou moins intégrés dans les villes et villages, volontaires pour le maquis, ou purement et simplement livrés à Franco.
 Pour légitimer le statut bien singulier de ces réfugiés, l’Etat français va effectuer de multiples pirouettes juridiques. Ce ne sont pas des prisonniers puisqu’ils n’ont fait les frais d’aucune décision de justice. Ce ne sont pas non plus des réfugiés politiques, car ce statut ne leur est pas accordé et ils ne bénéficient donc pas des dispositions prévues par la convention de Genève. On crée pour eux le statut d’ « étrangers indésirables », bien commode pour justifier barbelés, miradors, et privations diverses. Pendant les premières semaines, l’aliment de base devient le topinambour. On n’enferme pas 80 000 personnes sur une superficie restreinte comme au Barcarès, sans que cela ne prête à conséquence. L’absence d’hygiène, le manque de soins, les carences alimentaires provoquent des épidémies de dysenterie, de pneumonie, de typhoïde, de paludisme, de tuberculose… On estime le nombre de décès à environ 15 000 au début de l’année 1939. D’où la nécessité de renforcer la surveillance et le contrôle des camps pour éviter que ces maladies ne se propagent parmi la population environnante… Les témoignages que publient les journaux de Gauche sur cette catastrophe sanitaire laissent une bonne partie de la France totalement indifférente. Après tout, ce sont des « rouges » (pire même des suppôts de l’Anarchie). La vie est dure pour tout le monde, ils n’ont qu’à retourner chez eux, c’est la paix maintenant… 190 634 Espagnols sont fusillés par la dictature entre 1939 et 1944, selon les chiffres officiels fournis par le Ministère de la Justice franquiste. Quant à l’emploi du terme de « camp de concentration » eh bien c’est au député radical socialiste Albert Sarraut (futur collaborateur) qu’on le doit : il l’utilise lors de « l’inauguration » du camp d’Argelès en février 39 : «Le camp ne sera pas un lieu pénitentiaire mais un camp de concentration. Ce n’est pas la même chose. Les asilés qui y prendront séjour n’y resteront guère que le temps nécessaire pour préparer leur refoulement, ou, sur leur option, leur libre passage de retour en Espagne.» Pas étonnant que ce bonhomme ait ensuite voté les pleins pouvoirs à Pétain !
Pour légitimer le statut bien singulier de ces réfugiés, l’Etat français va effectuer de multiples pirouettes juridiques. Ce ne sont pas des prisonniers puisqu’ils n’ont fait les frais d’aucune décision de justice. Ce ne sont pas non plus des réfugiés politiques, car ce statut ne leur est pas accordé et ils ne bénéficient donc pas des dispositions prévues par la convention de Genève. On crée pour eux le statut d’ « étrangers indésirables », bien commode pour justifier barbelés, miradors, et privations diverses. Pendant les premières semaines, l’aliment de base devient le topinambour. On n’enferme pas 80 000 personnes sur une superficie restreinte comme au Barcarès, sans que cela ne prête à conséquence. L’absence d’hygiène, le manque de soins, les carences alimentaires provoquent des épidémies de dysenterie, de pneumonie, de typhoïde, de paludisme, de tuberculose… On estime le nombre de décès à environ 15 000 au début de l’année 1939. D’où la nécessité de renforcer la surveillance et le contrôle des camps pour éviter que ces maladies ne se propagent parmi la population environnante… Les témoignages que publient les journaux de Gauche sur cette catastrophe sanitaire laissent une bonne partie de la France totalement indifférente. Après tout, ce sont des « rouges » (pire même des suppôts de l’Anarchie). La vie est dure pour tout le monde, ils n’ont qu’à retourner chez eux, c’est la paix maintenant… 190 634 Espagnols sont fusillés par la dictature entre 1939 et 1944, selon les chiffres officiels fournis par le Ministère de la Justice franquiste. Quant à l’emploi du terme de « camp de concentration » eh bien c’est au député radical socialiste Albert Sarraut (futur collaborateur) qu’on le doit : il l’utilise lors de « l’inauguration » du camp d’Argelès en février 39 : «Le camp ne sera pas un lieu pénitentiaire mais un camp de concentration. Ce n’est pas la même chose. Les asilés qui y prendront séjour n’y resteront guère que le temps nécessaire pour préparer leur refoulement, ou, sur leur option, leur libre passage de retour en Espagne.» Pas étonnant que ce bonhomme ait ensuite voté les pleins pouvoirs à Pétain !
 Au vu de ce qui se passe avec les migrants actuels, parqués dans des camps comme la « Jungle de Calais » ou des centres d’internement dans lesquels ils subissent trop souvent les pires humiliations, je me demande si les mentalités, dans leur ensemble, ont beaucoup évolué. Pour la plupart d’entre eux, la sanction tombe rapidement : renvoi manu militari dans leur pays d’origine où eux aussi risquent la mort. Comme en 1939, celles et ceux qui tentent de venir en aide aux réfugiés sont victimes de harcèlements et de répression judiciaire. De ce côté là aussi, les choses n’ont guère changé.
Au vu de ce qui se passe avec les migrants actuels, parqués dans des camps comme la « Jungle de Calais » ou des centres d’internement dans lesquels ils subissent trop souvent les pires humiliations, je me demande si les mentalités, dans leur ensemble, ont beaucoup évolué. Pour la plupart d’entre eux, la sanction tombe rapidement : renvoi manu militari dans leur pays d’origine où eux aussi risquent la mort. Comme en 1939, celles et ceux qui tentent de venir en aide aux réfugiés sont victimes de harcèlements et de répression judiciaire. De ce côté là aussi, les choses n’ont guère changé.
Notes complémentaires
• La situation a changé sur le plan historique et de nombreux documents sont désormais disponibles et une partie des archives accessibles. Pour rédiger cette chronique je me suis appuyé (entre autres) sur le livre de Michel di Nocera « Debout dans l’exil ! » paru aux Editions Libertaires, ainsi que sur « Révolutionnaires, Réfugiés et Résistants » de Frederica Montseny aux éditions CNT-RP. Vous pouvez également consulter « Odyssée pour la liberté » de Marie-Claude Rafaneau-Boj aux éditions « Le coquelicot ». Je vous suggère aussi « Les enfants d’Elisabeth » d’Hélène Legrais aux Presses de la cité, une belle histoire de dévouement, en marge de cette triste réalité. Sachez enfin qu’il existe plusieurs ouvrages consacrés à des camps particuliers ; j’ai sous les yeux celui de Claude Laharie sur Gurs (éd. Atlantica).
• Je parle du camp d’internement d’Arandon, en Isère, dans ces deux chroniques : « Le camp d’internement d’Arandon en 1939/45 » et « D’une recherche dans un domaine… à une découverte dans un autre !«
14janvier2019
Posté par Paul dans la catégorie : au jour le jour...; Notre nature à nous.
 Notre maison est située dans une région intéressante de par son voisinage géographique : les basses terres du Rhône – terminologie à rapprocher de celle de « Bas Dauphiné », plus vaste, à laquelle nous appartenons également. Certains Dauphinois du Sud nous casent dans la région des « Terres froides », mais ce sont des ignares, des gens qui pensent que le Nord de leur département se situe dans la banlieue de Lille ou d’Amiens. Laissons les à leur inculture pour reprendre notre brillant exposé. Placez vous avec moi à la fenêtre de la salle à manger… A main gauche, juste derrière le Rhône, les premiers contreforts du Jura ; à main droite, les massifs des pré-Alpes, la Chartreuse et le massif des Bauges en particulier. Ce sont les reliefs les plus proches : quelques kilomètres à vol d’oiseau pour le Bugey, à peine plus pour l’avant-pays savoyard. Dans notre dos, le Massif Central, mais la distance est plus conséquente pour atteindre le Vivarais ou les Monts du Lyonnais ; il faut bien compter une centaine de kilomètres. Le Jura est notre lieu de prédilection pour les randonnées « montagne à vache ». Les points culminants les plus proches s’élèvent à mille mètres environ. Nos principales références en matière d’orientation : le plateau d’Innimond, ou la Dent du Chat qui domine le lac du Bourget.
Notre maison est située dans une région intéressante de par son voisinage géographique : les basses terres du Rhône – terminologie à rapprocher de celle de « Bas Dauphiné », plus vaste, à laquelle nous appartenons également. Certains Dauphinois du Sud nous casent dans la région des « Terres froides », mais ce sont des ignares, des gens qui pensent que le Nord de leur département se situe dans la banlieue de Lille ou d’Amiens. Laissons les à leur inculture pour reprendre notre brillant exposé. Placez vous avec moi à la fenêtre de la salle à manger… A main gauche, juste derrière le Rhône, les premiers contreforts du Jura ; à main droite, les massifs des pré-Alpes, la Chartreuse et le massif des Bauges en particulier. Ce sont les reliefs les plus proches : quelques kilomètres à vol d’oiseau pour le Bugey, à peine plus pour l’avant-pays savoyard. Dans notre dos, le Massif Central, mais la distance est plus conséquente pour atteindre le Vivarais ou les Monts du Lyonnais ; il faut bien compter une centaine de kilomètres. Le Jura est notre lieu de prédilection pour les randonnées « montagne à vache ». Les points culminants les plus proches s’élèvent à mille mètres environ. Nos principales références en matière d’orientation : le plateau d’Innimond, ou la Dent du Chat qui domine le lac du Bourget.
 L’intérêt de ce dernier massif, c’est de nous permettre de savoir dans quelle direction se situe le Mont-Blanc… En raison d’un caprice du relief, nous ne pouvons voir le « Top of Europ » comme disent une partie de nos visiteurs étrangers, depuis nos fenêtres. Il faut parcourir une centaine de mètres sur la petite route qui passe devant chez nous, et nous diriger vers le Nord-Ouest, pour savoir si « sa majesté » daigne se montrer ou pas. La netteté ainsi que l’éloignement de sa silhouette nous informent sur la météo des jours à venir. Si on n’arrive pas à le voir, eh bien, comme on dit en Bretagne ou en Irlande, c’est qu’il va pleuvoir ou qu’il pleut déjà. Si le sommet semble proche et que ses lignes semblent tracées au crayon sur le ciel, c’est que la pluie attendra une ou deux journées. Lorsqu’on peine à le distinguer parmi les autres monts, c’est plutôt bon signe pour les amateurs de soleil que nous sommes.
L’intérêt de ce dernier massif, c’est de nous permettre de savoir dans quelle direction se situe le Mont-Blanc… En raison d’un caprice du relief, nous ne pouvons voir le « Top of Europ » comme disent une partie de nos visiteurs étrangers, depuis nos fenêtres. Il faut parcourir une centaine de mètres sur la petite route qui passe devant chez nous, et nous diriger vers le Nord-Ouest, pour savoir si « sa majesté » daigne se montrer ou pas. La netteté ainsi que l’éloignement de sa silhouette nous informent sur la météo des jours à venir. Si on n’arrive pas à le voir, eh bien, comme on dit en Bretagne ou en Irlande, c’est qu’il va pleuvoir ou qu’il pleut déjà. Si le sommet semble proche et que ses lignes semblent tracées au crayon sur le ciel, c’est que la pluie attendra une ou deux journées. Lorsqu’on peine à le distinguer parmi les autres monts, c’est plutôt bon signe pour les amateurs de soleil que nous sommes.
 Le plateau d’Innimond, dans le Bugey voisin, joue un rôle plus modeste, mais néanmoins non négligeable. Rares sont les journées sans que l’on fasse une remarque à son sujet. La face Sud que nous apercevons par nos fenêtres, est couverte d’une grande prairie. La neige y est bien plus présente que dans notre jardin ; c’est logique puisque pour atteindre le sommet de ce géant du Jura il faut franchir un dénivelé de plus de 700 m. Alors les remarques vont bon train :
Le plateau d’Innimond, dans le Bugey voisin, joue un rôle plus modeste, mais néanmoins non négligeable. Rares sont les journées sans que l’on fasse une remarque à son sujet. La face Sud que nous apercevons par nos fenêtres, est couverte d’une grande prairie. La neige y est bien plus présente que dans notre jardin ; c’est logique puisque pour atteindre le sommet de ce géant du Jura il faut franchir un dénivelé de plus de 700 m. Alors les remarques vont bon train :
– Tu as vu ? Il a neigé sur Innimond.
– Tiens ! La neige a déjà fondu sur Innimond.
– Tu te rends compte ! Ça fait au moins une semaine que c’est tout blanc par là-haut.
– Vu la couleur, la neige a dû fondre sur les pentes ensoleillées, mais je suis sûr qu’à l’arrière c’est encore tout blanc..
Et ainsi de suite, ça continue l’été…
– Y vont se prendre un orage là-haut ! Tu as vu les gros nuages noirs ? [Excusez le « Y » mais c’est l’une des caractéristiques du parler local : des Y partout…]
– Y font chier à Innimond, la pluie c’est toujours pour eux, jamais pour nous…
Je vous en passe et des meilleures.
 Pour ceux qui s’intéressent à l’histoire et aux traditions locales, le village d’Innimond, au pied du plateau d’Innimond, a toujours constitué une mine de trouvailles pittoresques pour les ethnologues en herbe. Des revues comme la défunte « Evocations » remplissaient leurs pages d’historiettes, de contes en patois, de traditions singulières collectées dans ce village… L’un des charmes de ces récits c’est qu’ils étaient fort souvent truculents et à la limite d’une grossièreté bon enfant qui avait de quoi ravir le chaland trop habitué à des articles policés. Dans ces récits bugistes traditionnels, les personnages n’hésitaient point à ponctuer leurs aventures de flatulences diverses et de jurons hauts en couleur. Pour le dire de manière un peu crue, mais sans aucune intention de mal juger quiconque, ces montagnards « un peu à l’écart » étaient considérés un peu comme arriérés. C’était comme cela il y a un bon demi-siècle, disons, d’autant que l’accès dans ce genre de village isolé n’étant pas simple, les progrès élémentaires tels que courant électrique, remonte-pente, brosse à dents atomique et autres quads, avaient mis un peu de temps avant de parvenir à ces altitudes.
Pour ceux qui s’intéressent à l’histoire et aux traditions locales, le village d’Innimond, au pied du plateau d’Innimond, a toujours constitué une mine de trouvailles pittoresques pour les ethnologues en herbe. Des revues comme la défunte « Evocations » remplissaient leurs pages d’historiettes, de contes en patois, de traditions singulières collectées dans ce village… L’un des charmes de ces récits c’est qu’ils étaient fort souvent truculents et à la limite d’une grossièreté bon enfant qui avait de quoi ravir le chaland trop habitué à des articles policés. Dans ces récits bugistes traditionnels, les personnages n’hésitaient point à ponctuer leurs aventures de flatulences diverses et de jurons hauts en couleur. Pour le dire de manière un peu crue, mais sans aucune intention de mal juger quiconque, ces montagnards « un peu à l’écart » étaient considérés un peu comme arriérés. C’était comme cela il y a un bon demi-siècle, disons, d’autant que l’accès dans ce genre de village isolé n’étant pas simple, les progrès élémentaires tels que courant électrique, remonte-pente, brosse à dents atomique et autres quads, avaient mis un peu de temps avant de parvenir à ces altitudes.
Deux petites formulettes pour illustrer mon propos :
Il était une fois un rat
Qui avait une musique
Sous la queue.
Quand le rat pétait
La musique allait.
Quand le rat ne pétait plus
La musique n’allait plus. (*)
Pète, pèteras-tu
Quand le moulin tourne
Le derrière se déchire.
Quand le grain est moulu
Le derrière est cousu. (*)
 Depuis, les choses ont bien changé et les agriculteurs, quelque peu dégoûtés par la rigueur de leurs conditions de vie et le mépris des citadins, ont eu tendance à brader leurs demeures traditionnelles et à préférer s’entasser dans les tours exemplaires de nos banlieues modernes. Les temps ayant changé, cet exode bienvenu a permis à tous les citadins un peu fortunés d’acquérir de superbes fermettes en pierre, et de les utiliser comme résidences secondaires, tertiaires ou quaternaires. Revirement d’opinion n’ayant rien de bien surprenant, sachant que tous ces connaisseurs cherchaient un terrain de jeu pour leurs 4×4 et un champ de tir pour s’exercer à la chasse au sanglier, ont considéré finalement que ces bouseux avaient bien de la chance d’habiter dans un décor aussi sublime ; d’autant que les nouveaux venus pouvaient passer l’hiver bien au chaud dans leur loft en centre ville, un peu étroit mais bien conçu, et s’adonner assez fréquemment aux joies du shopping. La campagne certes – c’est bon pour les enfants – mais de là à manquer le « black friday », faut pas exagérer !
Depuis, les choses ont bien changé et les agriculteurs, quelque peu dégoûtés par la rigueur de leurs conditions de vie et le mépris des citadins, ont eu tendance à brader leurs demeures traditionnelles et à préférer s’entasser dans les tours exemplaires de nos banlieues modernes. Les temps ayant changé, cet exode bienvenu a permis à tous les citadins un peu fortunés d’acquérir de superbes fermettes en pierre, et de les utiliser comme résidences secondaires, tertiaires ou quaternaires. Revirement d’opinion n’ayant rien de bien surprenant, sachant que tous ces connaisseurs cherchaient un terrain de jeu pour leurs 4×4 et un champ de tir pour s’exercer à la chasse au sanglier, ont considéré finalement que ces bouseux avaient bien de la chance d’habiter dans un décor aussi sublime ; d’autant que les nouveaux venus pouvaient passer l’hiver bien au chaud dans leur loft en centre ville, un peu étroit mais bien conçu, et s’adonner assez fréquemment aux joies du shopping. La campagne certes – c’est bon pour les enfants – mais de là à manquer le « black friday », faut pas exagérer !
 En fait, il faut le dire, ces gens-là n’étaient guère intéressants et ne le sont toujours pas : peu fréquentables à cause de leurs opinions à la droite de la gauche, et surtout de l’argent frais qui s’écoulait entre leurs doigts peu économes. Heureusement, une autre vague d’immigration rurale et montagnarde a suivi… Elle était constitué de gens beaucoup moins fortunés, ne trouvant plus aucun charme à leur travail et à leur vie urbaine, et souhaitant impulser à nouveau un minimum de vie locale ; et ce toute l’année et non le week-end et les jours fériés. J’arrêterai là cette dissertation car ce n’est point là l’objet de ce billet. L’auteur n’étant point sociologue laisse à d’autres le soin de disserter sur les ruraux, les néo-ruraux ou les zozos matelassés de billets. Mon propos de bouseux de la plaine se limitera en effet à expliquer l’importance de voir, depuis sa fenêtre, la ligne bleue du Jura et de savoir en extraire toute la substantifique moelle pour enrichir son quotidien.
En fait, il faut le dire, ces gens-là n’étaient guère intéressants et ne le sont toujours pas : peu fréquentables à cause de leurs opinions à la droite de la gauche, et surtout de l’argent frais qui s’écoulait entre leurs doigts peu économes. Heureusement, une autre vague d’immigration rurale et montagnarde a suivi… Elle était constitué de gens beaucoup moins fortunés, ne trouvant plus aucun charme à leur travail et à leur vie urbaine, et souhaitant impulser à nouveau un minimum de vie locale ; et ce toute l’année et non le week-end et les jours fériés. J’arrêterai là cette dissertation car ce n’est point là l’objet de ce billet. L’auteur n’étant point sociologue laisse à d’autres le soin de disserter sur les ruraux, les néo-ruraux ou les zozos matelassés de billets. Mon propos de bouseux de la plaine se limitera en effet à expliquer l’importance de voir, depuis sa fenêtre, la ligne bleue du Jura et de savoir en extraire toute la substantifique moelle pour enrichir son quotidien.
 Le plateau d’Innimond présente un autre centre d’intérêt essentiel à nos yeux, quand nous avons fini de disserter quotidiennement sur la météorologie ; à son extrémité droite (vue depuis la fenêtre), se trouve une table d’orientation facilement accessible par une petite route. Ceux qui suivent régulièrement ce blog d’intérêt international savent que nous hébergeons, à la belle saison, d’intrépides voyageurs venus des quatre coins de notre ronde planète, pour découvrir les mœurs des Français, excentriques et en partie ruraux, du Nord Dauphiné. Quand le temps des loisirs arrive, après avoir désherbé les carottes, mis en confiture les groseilles, et transformé les bambous en choucroute pour le compost, vient le moment exquis de la balade, afin de découvrir les points d’intérêts majeurs de la région… à pied, en vélo et en voiture bien entendu, puisque l’automobile prend sa place parmi les objets utilisés par les autochtones. Alors on propose bien entendu à nos valeureux stagiaires de découvrir les lieux incontournables (genre Halles de Crémieu, la brasserie locale ou les grottes de La Balme)… mais on les conduit en priorité à la table d’orientation du plateau d’Innimond… C’est un must dans notre programme de découverte locale. D’abord ça me permet de leur coller un cours de géographie gratuit (on ne change pas la mentalité pourrie d’un instit retraité), mais ce n’est pas tout. Ce lieu charmant est aussi le point de départ de une ou plusieurs randonnées pédestres particulièrement plaisantes (un peu moins au mois de septembre quand il faut zigzaguer entre les balles des vaillants nemrods d’opérette traquant le redoutable cochonglier). Deux ou trois heures de marche plus tard, on peut aussi faire une halte non loin du « Sully » local, un magnifique tilleul qui fait l’admiration, méritée, des habitants du cru… Non loin de là il y a aussi une fruitière qui propose une sympathique sélection de produits régionaux…
Le plateau d’Innimond présente un autre centre d’intérêt essentiel à nos yeux, quand nous avons fini de disserter quotidiennement sur la météorologie ; à son extrémité droite (vue depuis la fenêtre), se trouve une table d’orientation facilement accessible par une petite route. Ceux qui suivent régulièrement ce blog d’intérêt international savent que nous hébergeons, à la belle saison, d’intrépides voyageurs venus des quatre coins de notre ronde planète, pour découvrir les mœurs des Français, excentriques et en partie ruraux, du Nord Dauphiné. Quand le temps des loisirs arrive, après avoir désherbé les carottes, mis en confiture les groseilles, et transformé les bambous en choucroute pour le compost, vient le moment exquis de la balade, afin de découvrir les points d’intérêts majeurs de la région… à pied, en vélo et en voiture bien entendu, puisque l’automobile prend sa place parmi les objets utilisés par les autochtones. Alors on propose bien entendu à nos valeureux stagiaires de découvrir les lieux incontournables (genre Halles de Crémieu, la brasserie locale ou les grottes de La Balme)… mais on les conduit en priorité à la table d’orientation du plateau d’Innimond… C’est un must dans notre programme de découverte locale. D’abord ça me permet de leur coller un cours de géographie gratuit (on ne change pas la mentalité pourrie d’un instit retraité), mais ce n’est pas tout. Ce lieu charmant est aussi le point de départ de une ou plusieurs randonnées pédestres particulièrement plaisantes (un peu moins au mois de septembre quand il faut zigzaguer entre les balles des vaillants nemrods d’opérette traquant le redoutable cochonglier). Deux ou trois heures de marche plus tard, on peut aussi faire une halte non loin du « Sully » local, un magnifique tilleul qui fait l’admiration, méritée, des habitants du cru… Non loin de là il y a aussi une fruitière qui propose une sympathique sélection de produits régionaux…
 Béni soit donc ce plateau d’Innimond qui pourvoit aux besoins conversationnels quotidiens et permet aussi de se repérer dans une géographie jurassienne et alpine parfois bien complexe. Je concède qu’il s’agit d’une gloire géographique locale, très locale même, puisque mon fils aîné qui habite de l’autre côté du plateau, loin là-bas, dans l’Ain, quasiment à l’étranger, se réfère à d’autres centres d’intérêts bien plus considérables à ses yeux comme le sommet du Colombier qui écrase mon plateau préféré du haut de son altitude quasiment deux fois plus élevée. Mais ne soyons pas jaloux… Derrière la ligne bleue du Jura, se cache le pays des Helvètes, mais il s’agit là d’une toute autre histoire que vous pouvez, par exemple, découvrir dans un album de Tintin (bof !) ou en écoutant les sublimes chansons de l’ami Bühler (Michel de son petit nom). Quand je pense que ce troubadour de première classe envisage dans l’une des ses complaintes de raser les Alpes pour « qu’on voit la mer »… Heureusement qu’il ne s’attaque pas à notre célèbre plateau ! Nous les vieux, on a encore besoin de quelques repères, non mais !
Béni soit donc ce plateau d’Innimond qui pourvoit aux besoins conversationnels quotidiens et permet aussi de se repérer dans une géographie jurassienne et alpine parfois bien complexe. Je concède qu’il s’agit d’une gloire géographique locale, très locale même, puisque mon fils aîné qui habite de l’autre côté du plateau, loin là-bas, dans l’Ain, quasiment à l’étranger, se réfère à d’autres centres d’intérêts bien plus considérables à ses yeux comme le sommet du Colombier qui écrase mon plateau préféré du haut de son altitude quasiment deux fois plus élevée. Mais ne soyons pas jaloux… Derrière la ligne bleue du Jura, se cache le pays des Helvètes, mais il s’agit là d’une toute autre histoire que vous pouvez, par exemple, découvrir dans un album de Tintin (bof !) ou en écoutant les sublimes chansons de l’ami Bühler (Michel de son petit nom). Quand je pense que ce troubadour de première classe envisage dans l’une des ses complaintes de raser les Alpes pour « qu’on voit la mer »… Heureusement qu’il ne s’attaque pas à notre célèbre plateau ! Nous les vieux, on a encore besoin de quelques repères, non mais !
Notes : (*) extrait d’un article de Charles Talon publié dans le n°95/96 de la revue « Evocations », janvier 1955
8janvier2019
Posté par Paul dans la catégorie : Histoire locale, nationale, internationale : pages de mémoire; Philosophes, trublions, agitateurs et agitatrices du bon vieux temps.
histoire méconnue d’une poétesse de langue persane ayant vécu au XIIème siècle
 Omar Khayyam, l’auteur des quatrains, est largement connu dans les milieux intellectuels ; sa consœur, Mahsati Ganjavi, l’est beaucoup moins, alors que les poèmes qu’elle a écrits sont appréciés pour la richesse de leur style. La mémoire est sélective, du moins dans notre société, et même si les mœurs évoluent, il faudra encore bien du temps pour que les femmes retrouvent la place qui est la leur, dans le domaine des sciences et des arts (entre autres). Dans la lignée des chroniques que j’ai déjà publiées sur les savants du monde arabe, j’avais envie de vous parler d’Omar Khayyam (je viens de terminer le livre que lui a consacré l’écrivain Amin Maalouf) mais j’ai décidé de vous parler en premier de Mahsati Ganjavi, la « dame de la lune » (ainsi peut-on traduire « Mahsati ») et de ses « rubaïyat » (*) consacrés à l’amour. Un point commun relie les deux personnalités : leur franc parler et leur liberté de ton qui n’a pas eu l’honneur de plaire à leurs contemporains les plus orthodoxes !
Omar Khayyam, l’auteur des quatrains, est largement connu dans les milieux intellectuels ; sa consœur, Mahsati Ganjavi, l’est beaucoup moins, alors que les poèmes qu’elle a écrits sont appréciés pour la richesse de leur style. La mémoire est sélective, du moins dans notre société, et même si les mœurs évoluent, il faudra encore bien du temps pour que les femmes retrouvent la place qui est la leur, dans le domaine des sciences et des arts (entre autres). Dans la lignée des chroniques que j’ai déjà publiées sur les savants du monde arabe, j’avais envie de vous parler d’Omar Khayyam (je viens de terminer le livre que lui a consacré l’écrivain Amin Maalouf) mais j’ai décidé de vous parler en premier de Mahsati Ganjavi, la « dame de la lune » (ainsi peut-on traduire « Mahsati ») et de ses « rubaïyat » (*) consacrés à l’amour. Un point commun relie les deux personnalités : leur franc parler et leur liberté de ton qui n’a pas eu l’honneur de plaire à leurs contemporains les plus orthodoxes !
 Mahsati Ganjavi est née le 12 mai 1089 à Gandja (aujourd’hui en Azerbaïdjan). Dans cette ville, elle apparait à la cour du Prince Moghith al-Din où elle s’occupe de la culture et de l’organisation des festivités. Elle quitte ensuite ce lieu et parcourt la région : elle aurait ensuite séjourné à Balkh, Marv, Nishapur, Herat et Marva. Elle a vécu de longues années, avec le titre de poétesse officielle, à la cour de Mahmud Saljugi et de son oncle, le Sultan Sanjar Saljugi. Outre ses talents d’écriture poétique, Mahsati était également une musicienne renommée ; elle jouait de la harpe, du luth et du târ. Le Sultan Sanjar en aurait bien fait sa maîtresse, mais la jeune femme refusa toutes ses avances et lui remit ce quatrain :
Mahsati Ganjavi est née le 12 mai 1089 à Gandja (aujourd’hui en Azerbaïdjan). Dans cette ville, elle apparait à la cour du Prince Moghith al-Din où elle s’occupe de la culture et de l’organisation des festivités. Elle quitte ensuite ce lieu et parcourt la région : elle aurait ensuite séjourné à Balkh, Marv, Nishapur, Herat et Marva. Elle a vécu de longues années, avec le titre de poétesse officielle, à la cour de Mahmud Saljugi et de son oncle, le Sultan Sanjar Saljugi. Outre ses talents d’écriture poétique, Mahsati était également une musicienne renommée ; elle jouait de la harpe, du luth et du târ. Le Sultan Sanjar en aurait bien fait sa maîtresse, mais la jeune femme refusa toutes ses avances et lui remit ce quatrain :
Tu ne peux pas me forcer parce que tu es le roi
Tu ne peux pas me garder par la force de la loi
Tu ne peux pas enchaîner une femme chez toi
Une femme dont les tresses sont une chaîne de soi
 On lui a pourtant reproché, par la suite, les nombreuses liaisons qu’elle aurait eues avec un certain nombre de personnages importants et elle a conservé l’image, dans une fraction de l’opinion, de « femme aux mœurs légères ». L’histoire de sa vie est cependant mal connue et ce genre de rumeur est difficile à vérifier ! Lacune plus importante : on ignore si elle a connu et rencontré son contemporain Omar Khayyam qui écrivait lui aussi en Persan. Tous deux étaient poètes et libres penseurs ; l’un des deux a-t-il influencé l’autre ? Ce qui est certain c’est que beaucoup de préoccupations leur sont communes et que l’un comme l’autre ne se sont pas privés d’égratigner dans leurs écrits le conservatisme social, l’hypocrisie et les préjugés de la religion de leurs pairs et, plus généralement, de la société dans laquelle ils vivaient. Tous deux ont par ailleurs choisi la forme du quatrain, le robaïyat comme format pour leur poésie philosophique. Ceux écrits par la « dame de la lune » nous sont connus par plusieurs publications postérieures que des lettrés ont consacrées à l’écriture poétique en Persan. Une soixantaine de ses quatrains ont notamment été répertoriés dans le « Nozhat al-Majales », une anthologie de 4100 poèmes persans rédigée par le poète Jamal al-Din Khalil Shirvani. La plupart des textes de Mahsati Ganjavi évoquent la joie de vivre et l’importance de l’amour… A ses yeux, l’amour est un sentiment naturel fragile qui ne peut qu’accroître la grandeur de l’homme et renforcer sa renommée.
On lui a pourtant reproché, par la suite, les nombreuses liaisons qu’elle aurait eues avec un certain nombre de personnages importants et elle a conservé l’image, dans une fraction de l’opinion, de « femme aux mœurs légères ». L’histoire de sa vie est cependant mal connue et ce genre de rumeur est difficile à vérifier ! Lacune plus importante : on ignore si elle a connu et rencontré son contemporain Omar Khayyam qui écrivait lui aussi en Persan. Tous deux étaient poètes et libres penseurs ; l’un des deux a-t-il influencé l’autre ? Ce qui est certain c’est que beaucoup de préoccupations leur sont communes et que l’un comme l’autre ne se sont pas privés d’égratigner dans leurs écrits le conservatisme social, l’hypocrisie et les préjugés de la religion de leurs pairs et, plus généralement, de la société dans laquelle ils vivaient. Tous deux ont par ailleurs choisi la forme du quatrain, le robaïyat comme format pour leur poésie philosophique. Ceux écrits par la « dame de la lune » nous sont connus par plusieurs publications postérieures que des lettrés ont consacrées à l’écriture poétique en Persan. Une soixantaine de ses quatrains ont notamment été répertoriés dans le « Nozhat al-Majales », une anthologie de 4100 poèmes persans rédigée par le poète Jamal al-Din Khalil Shirvani. La plupart des textes de Mahsati Ganjavi évoquent la joie de vivre et l’importance de l’amour… A ses yeux, l’amour est un sentiment naturel fragile qui ne peut qu’accroître la grandeur de l’homme et renforcer sa renommée.
 Différents hommages lui ont été rendus par nos contemporains : plusieurs rues ou écoles portent son nom dans des bourgades d’Azerbaïdjan. Dans sa ville natale, un musée lui est consacré et un monument commémoratif a été inauguré en 1980. En novembre 2013, à l’occasion de son 900ème jubilé, une exposition a été consacrée à la poétesse, au Palais du Tau, à Reims. Il n’existe cependant pas de version française de ses quatrains qui ont été traduits, pour l’instant, en Anglais et en Italien (La luna e le perle). Nombreux sont les recueils édités consacrés aux quatrains d’Omar Khayyam ; espérons que par souci d’équité, un éditeur voudra bien se pencher sur les travaux de cette autre artiste remarquable !
Différents hommages lui ont été rendus par nos contemporains : plusieurs rues ou écoles portent son nom dans des bourgades d’Azerbaïdjan. Dans sa ville natale, un musée lui est consacré et un monument commémoratif a été inauguré en 1980. En novembre 2013, à l’occasion de son 900ème jubilé, une exposition a été consacrée à la poétesse, au Palais du Tau, à Reims. Il n’existe cependant pas de version française de ses quatrains qui ont été traduits, pour l’instant, en Anglais et en Italien (La luna e le perle). Nombreux sont les recueils édités consacrés aux quatrains d’Omar Khayyam ; espérons que par souci d’équité, un éditeur voudra bien se pencher sur les travaux de cette autre artiste remarquable !
NDLR – Il s’agit là d’une chronique écrite il y a quelques mois, que j’avais laissée de côté trouvant le propos bien mince. J’espérais trouver une documentation complémentaire mais cela n’a pas été le cas. Si certains peuvent compléter, je publierai bien volontiers le complément d’information.
(*) Le terme de rubaïyat fait référence à la poésie d’Omar Khayyam. Il peut se traduire par « quatrain ». Les deux premiers vers riment avec le dernier, le troisième étant un vers libre. On trouve ce genre de quatrain dans l’œuvre de Fernando Pessoa par exemple.
3janvier2019
Posté par Paul dans la catégorie : au jour le jour....

Je lis de moins en moins de choses dans ma boule de cristal, alors je ne répondrai rien à cette question préliminaire. Selon Mme Irma, tout va de mal en pis… Selon Mr Claudius, l’horizon coloré en jaune n’est peut-être pas si bouché que cela… A titre personnel, amical, familial, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette année. J’avoue aussi que si la situation politique et sociale pouvait enfin partir dans une direction que nous sommes nombreux à espérer, j’en serais comblé… Pour ce qui est du blog, je ne fais plus de pronostic sérieux, mon humeur par rapport à l’écriture étant de plus en plus inconstante. Je lis beaucoup mais je ne produis plus guère, du moins en ce qui concerne le blog. Je vais donc arrêter de faire des annonces avec tambour et trompettes concernant arrêt ou reprise. Mais je crois bien que je continuerai à publier de temps à autre lorsque la plume qui me chatouille la plante du pied deviendra trop agaçante – je pense ! Je remercie en tout cas ceux qui passent de temps à autre pour voir si la poule a pondu un œuf comestible. Je remercie aussi ceux qui reprennent mes textes de temps à autre pour élargir leur audience (je pense entre autres à « Altermonde sans frontières ») ou ceux qui ont conservé « la feuille charbinoise » dans leur liste de sites « fréquentables ». Bref, en 2019 comme avant et comme après, de l’amour, de belles amitiés, quelques bons verres, de sublimes découvertes dans tous les domaines et un peu de sérénité dans cet environnement de plus en plus haineux et guerrier.
 Contrairement à ce qu’enseigne trop souvent l’histoire officielle, à la fin du XIXème siècle, tous les anarchistes ne sont pas occupés à poser des bombes ou à assassiner des chefs d’état… Il en est certains qui s’adonnent à des activités plus calmes, mais tout aussi révolutionnaires dans leur domaine. Prenons par l’exemple la liste des géographes qui se revendiquent du drapeau noir ; ils sont assez nombreux… Je pense à Elisée Reclus, Pierre Kropotkine, Patrick Geddes, Charles Perron, Léon Metchnikoff, Mikhail Dragomanov… et j’en oublie sans doute. Les deux premiers sont connus, le second surtout pour ses écrits politiques… J’ai déjà eu l’occasion de vous dire tout le bien que je pense d’Elisée Reclus dont les travaux ont été largement remis à l’honneur depuis quelques dizaines d’années. Il en est un autre, personnage pittoresque lui aussi, dont j’aimerais vous parler aujourd’hui : il s’agit de Patrick Geddes, un géographe d’origine écossaise, connu dans un petit milieu de spécialistes, mais en partie oublié du public, notamment dans notre pays. Les sources documentaires en anglais sont abondantes mais ce n’est pas le cas en français, bien que Geddes ait fréquemment séjourné en France. Ses travaux touchent à divers domaines puisqu’il fut à la fois biologiste, sociologue, géographe et urbaniste. Comme Reclus, lui aussi a de nouveau droit de cité dans les travaux de chercheurs contemporains (il faudra un jour que l’on s’interroge sur ce phénomène, qui n’a rien de comparable à une « mode » !). Dans leurs divers écrits, par exemple, Kenneth White, fondateur de la géopoétique, José Cornuault, essayiste, ou Frederico Ferretti, enseignant chercheur en géographie, font souvent référence à son œuvre.
Contrairement à ce qu’enseigne trop souvent l’histoire officielle, à la fin du XIXème siècle, tous les anarchistes ne sont pas occupés à poser des bombes ou à assassiner des chefs d’état… Il en est certains qui s’adonnent à des activités plus calmes, mais tout aussi révolutionnaires dans leur domaine. Prenons par l’exemple la liste des géographes qui se revendiquent du drapeau noir ; ils sont assez nombreux… Je pense à Elisée Reclus, Pierre Kropotkine, Patrick Geddes, Charles Perron, Léon Metchnikoff, Mikhail Dragomanov… et j’en oublie sans doute. Les deux premiers sont connus, le second surtout pour ses écrits politiques… J’ai déjà eu l’occasion de vous dire tout le bien que je pense d’Elisée Reclus dont les travaux ont été largement remis à l’honneur depuis quelques dizaines d’années. Il en est un autre, personnage pittoresque lui aussi, dont j’aimerais vous parler aujourd’hui : il s’agit de Patrick Geddes, un géographe d’origine écossaise, connu dans un petit milieu de spécialistes, mais en partie oublié du public, notamment dans notre pays. Les sources documentaires en anglais sont abondantes mais ce n’est pas le cas en français, bien que Geddes ait fréquemment séjourné en France. Ses travaux touchent à divers domaines puisqu’il fut à la fois biologiste, sociologue, géographe et urbaniste. Comme Reclus, lui aussi a de nouveau droit de cité dans les travaux de chercheurs contemporains (il faudra un jour que l’on s’interroge sur ce phénomène, qui n’a rien de comparable à une « mode » !). Dans leurs divers écrits, par exemple, Kenneth White, fondateur de la géopoétique, José Cornuault, essayiste, ou Frederico Ferretti, enseignant chercheur en géographie, font souvent référence à son œuvre. Patrick Geddes a soulevé, de son vivant, des problèmes, comme celui de l’indépendance de son pays natal, l’Ecosse, ou celui de l’aménagement des grandes cités, qui sont tout à fait d’actualité. Je pense entre autres au référendum qui a eu lieu en 2014… Le « oui » n’était pas loin de l’emporter car nombreux sont les Ecossais qui souhaitent se séparer de la Grande Bretagne. Cet homme à l’imagination fertile fut également un collaborateur occasionnel d’Elisée Reclus, notamment lorsque ce dernier voulut se lancer dans la construction d’un globe terrestre de dimension colossale pour permettre à ses concitoyens d’avoir une meilleure approche de la dimension des continents et surtout du relief montagneux. Anarchiste, Patrick Geddes l’a été pendant de longues années, même s’il s’est éloigné de ses orientations politiques à la fin de sa vie. « Sur la route de la liberté, nous trouvons le drapeau rouge du Socialisme et le drapeau noir de l’Anarchisme, symboles des tendances contrastées qui existent en nous. Et en miroir de ces symboles, le développement de l’immense richesse, mais aussi de la grande pauvreté ». Il partage avec Reclus une conviction profonde sur l’importance de l’éducation, notamment pour les adultes, et une méfiance, justifiée à mes yeux, sur la spécialisation outrancière des recherches scientifiques. Ces positions « ouvertes » le conduisent à s’opposer à nombre de ses collègues universitaires. « C’est en faisant que l’on apprend » considère-t-il et ce principe explique sans doute le grand nombre de domaines auxquels il va s’intéresser, et la vie aventureuse qui va être la sienne.
Patrick Geddes a soulevé, de son vivant, des problèmes, comme celui de l’indépendance de son pays natal, l’Ecosse, ou celui de l’aménagement des grandes cités, qui sont tout à fait d’actualité. Je pense entre autres au référendum qui a eu lieu en 2014… Le « oui » n’était pas loin de l’emporter car nombreux sont les Ecossais qui souhaitent se séparer de la Grande Bretagne. Cet homme à l’imagination fertile fut également un collaborateur occasionnel d’Elisée Reclus, notamment lorsque ce dernier voulut se lancer dans la construction d’un globe terrestre de dimension colossale pour permettre à ses concitoyens d’avoir une meilleure approche de la dimension des continents et surtout du relief montagneux. Anarchiste, Patrick Geddes l’a été pendant de longues années, même s’il s’est éloigné de ses orientations politiques à la fin de sa vie. « Sur la route de la liberté, nous trouvons le drapeau rouge du Socialisme et le drapeau noir de l’Anarchisme, symboles des tendances contrastées qui existent en nous. Et en miroir de ces symboles, le développement de l’immense richesse, mais aussi de la grande pauvreté ». Il partage avec Reclus une conviction profonde sur l’importance de l’éducation, notamment pour les adultes, et une méfiance, justifiée à mes yeux, sur la spécialisation outrancière des recherches scientifiques. Ces positions « ouvertes » le conduisent à s’opposer à nombre de ses collègues universitaires. « C’est en faisant que l’on apprend » considère-t-il et ce principe explique sans doute le grand nombre de domaines auxquels il va s’intéresser, et la vie aventureuse qui va être la sienne.
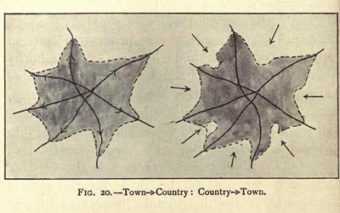 Lors de son séjour prolongé à Dundee il développe et met en pratique ses idées sur l’urbanisme ; l’une de ses convictions, novatrice pour l’époque, étant qu’il faut associer le plus possible les utilisateurs, les citoyens, à la gestion, à l’entretien et à l’administration de leur cadre de vie. Le développement urbain doit être accompagné d’un souci constant de respect de la nature. Il préconise le maintien d’espaces verts importants lors de la construction, et valorise la présence de jardins botaniques et potagers urbains. Ces réalisations doivent favoriser le maintien et l’observation de la biodiversité, ainsi que permettre d’approcher de l’autosuffisance alimentaire pour les nouveaux citadins… Tout cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? On peut facilement établir des liens entre les travaux anciens de Geddes et les écrits contemporains de Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire, même si la dimension politique est beaucoup plus approfondie chez Bookchin. Ce travail sur l’urbanisme deviendra l’une de ses préoccupations principales à la fin de sa vie et il sera à l’origine de travaux d’aménagement à Edimbourg puis à Jérusalem et à Tel Aviv en Palestine plus tard dans sa vie.
Lors de son séjour prolongé à Dundee il développe et met en pratique ses idées sur l’urbanisme ; l’une de ses convictions, novatrice pour l’époque, étant qu’il faut associer le plus possible les utilisateurs, les citoyens, à la gestion, à l’entretien et à l’administration de leur cadre de vie. Le développement urbain doit être accompagné d’un souci constant de respect de la nature. Il préconise le maintien d’espaces verts importants lors de la construction, et valorise la présence de jardins botaniques et potagers urbains. Ces réalisations doivent favoriser le maintien et l’observation de la biodiversité, ainsi que permettre d’approcher de l’autosuffisance alimentaire pour les nouveaux citadins… Tout cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? On peut facilement établir des liens entre les travaux anciens de Geddes et les écrits contemporains de Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire, même si la dimension politique est beaucoup plus approfondie chez Bookchin. Ce travail sur l’urbanisme deviendra l’une de ses préoccupations principales à la fin de sa vie et il sera à l’origine de travaux d’aménagement à Edimbourg puis à Jérusalem et à Tel Aviv en Palestine plus tard dans sa vie.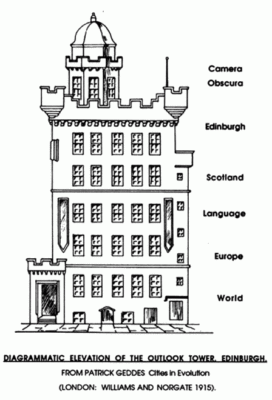 Patrick Geddes va également œuvrer pour une reconnaissance de la culture et de la nation écossaises et s’impliquer dans la rédaction de plusieurs revues. Parallèlement à son travail à Dundee il assure également des cours à l’University College de Dublin, et il est très impressionné par la vigueur du nationalisme irlandais et de la culture celte. Il souhaite enclencher le même dynamisme en Ecosse et pense que pour que ce phénomène dure, il est essentiel de mettre en avant la culture de son pays natal. On peut s’étonner de cette cohabitation entre l’idée nationaliste et le rejet de l’état et des frontières chez les anarchistes. Mais, aux yeux des géographes libertaires, l’Etat et la Nation ne représentent pas la même chose. Le signifiant du mot « Nation » n’est guère comparable à sa définition classique… « Les géographes anarchistes ne reconnaissaient pas l’État, mais ils considéraient la nation, dans le sens à la fois culturel et géographique, comme un objet sur lequel ils pouvaient travailler à « plusieurs échelles ». (citation extraite d’un texte de Frederico Ferretti au sujet de Geddes). « Le savoir national était présenté ici, non pas comme un enjeu chauviniste ou économico-fiscal (du genre « gardons notre argent pour nous »), mais plutôt comme une amélioration collective et publique de la communauté nationale, insérée pacifiquement dans une plus vaste communauté universelle qu’elle se doit de connaître à travers la géographie. » (idem)
Patrick Geddes va également œuvrer pour une reconnaissance de la culture et de la nation écossaises et s’impliquer dans la rédaction de plusieurs revues. Parallèlement à son travail à Dundee il assure également des cours à l’University College de Dublin, et il est très impressionné par la vigueur du nationalisme irlandais et de la culture celte. Il souhaite enclencher le même dynamisme en Ecosse et pense que pour que ce phénomène dure, il est essentiel de mettre en avant la culture de son pays natal. On peut s’étonner de cette cohabitation entre l’idée nationaliste et le rejet de l’état et des frontières chez les anarchistes. Mais, aux yeux des géographes libertaires, l’Etat et la Nation ne représentent pas la même chose. Le signifiant du mot « Nation » n’est guère comparable à sa définition classique… « Les géographes anarchistes ne reconnaissaient pas l’État, mais ils considéraient la nation, dans le sens à la fois culturel et géographique, comme un objet sur lequel ils pouvaient travailler à « plusieurs échelles ». (citation extraite d’un texte de Frederico Ferretti au sujet de Geddes). « Le savoir national était présenté ici, non pas comme un enjeu chauviniste ou économico-fiscal (du genre « gardons notre argent pour nous »), mais plutôt comme une amélioration collective et publique de la communauté nationale, insérée pacifiquement dans une plus vaste communauté universelle qu’elle se doit de connaître à travers la géographie. » (idem) Geddes entretient une correspondance suivie avec Reclus et s’enthousiasme pour le projet de globe que le géographe souhaite construire à l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 1900. En résonance avec ce projet, il rachète et il fait aménager à Edimbourg une tour observatoire (l’Outlook tower) qui se veut à la fois Musée, lieu d’expositions géographiques, laboratoire de sociologie. L’édifice est inauguré en 1892. Geddes espère permettre à ses concitoyens de mieux connaître, grâce à l’observation, la ville et sa région. Il souhaite également promouvoir la géographie et amener les personnalités du monde entier à s’intéresser à l’Ecosse. Dans son ouvrage intitulé « cities in evolution » voici comment l’universitaire parle de sa tour : « Ses six étages superposés représentent dans leur empilement comme une série de cercles concentriques dont les destinations vont en se rétrécissant, depuis le rez-de-chaussée, consacré au monde entier, ou le premier étage, attribué à l’Europe, jusqu’au cinquième étage, réservé à la cité même, surmonté d’une terrasse et d’une chambre obscure qui projette sur un écran tabulaire la perspective animée de ce centre régional de l’étude mondiale. » Lorsque les visiteurs sont guidés par le concepteur en personne, la découverte du lieu est passionnante ; lorsqu’il est absent, il semble que le lieu perde une bonne partie de son intérêt ! Voici ce que déclarent les premiers visiteurs. On se rend compte à quel point ce projet est fortement imprégné des idées de son concepteur. Le problème c’est que la vie agitée de Geddes l’amène à se déplacer en de nombreux autres lieux ! Données assez peu connues, Geddes va construire deux autres « outlook tower » en France. L’une au collège des Ecosssais à Montpellier en 1924 ; la seconde à Domme en Dordogne sera achevée par le neveu d’Elisée Reclus, Paul, après le décès de son ami. Quant au projet de globe, il sera abandonné en cours de route faute du financement nécessaire. Si vous souhaitez approfondir cette histoire de l’Outlook tower, je vous invite à lire une interview de Patrick Geddes publiée à l’origine dans la revue politique et parlementaire en avril 1910 et reproduite sur le blog « la vie quotidienne à Roscoff ».
Geddes entretient une correspondance suivie avec Reclus et s’enthousiasme pour le projet de globe que le géographe souhaite construire à l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 1900. En résonance avec ce projet, il rachète et il fait aménager à Edimbourg une tour observatoire (l’Outlook tower) qui se veut à la fois Musée, lieu d’expositions géographiques, laboratoire de sociologie. L’édifice est inauguré en 1892. Geddes espère permettre à ses concitoyens de mieux connaître, grâce à l’observation, la ville et sa région. Il souhaite également promouvoir la géographie et amener les personnalités du monde entier à s’intéresser à l’Ecosse. Dans son ouvrage intitulé « cities in evolution » voici comment l’universitaire parle de sa tour : « Ses six étages superposés représentent dans leur empilement comme une série de cercles concentriques dont les destinations vont en se rétrécissant, depuis le rez-de-chaussée, consacré au monde entier, ou le premier étage, attribué à l’Europe, jusqu’au cinquième étage, réservé à la cité même, surmonté d’une terrasse et d’une chambre obscure qui projette sur un écran tabulaire la perspective animée de ce centre régional de l’étude mondiale. » Lorsque les visiteurs sont guidés par le concepteur en personne, la découverte du lieu est passionnante ; lorsqu’il est absent, il semble que le lieu perde une bonne partie de son intérêt ! Voici ce que déclarent les premiers visiteurs. On se rend compte à quel point ce projet est fortement imprégné des idées de son concepteur. Le problème c’est que la vie agitée de Geddes l’amène à se déplacer en de nombreux autres lieux ! Données assez peu connues, Geddes va construire deux autres « outlook tower » en France. L’une au collège des Ecosssais à Montpellier en 1924 ; la seconde à Domme en Dordogne sera achevée par le neveu d’Elisée Reclus, Paul, après le décès de son ami. Quant au projet de globe, il sera abandonné en cours de route faute du financement nécessaire. Si vous souhaitez approfondir cette histoire de l’Outlook tower, je vous invite à lire une interview de Patrick Geddes publiée à l’origine dans la revue politique et parlementaire en avril 1910 et reproduite sur le blog « la vie quotidienne à Roscoff ».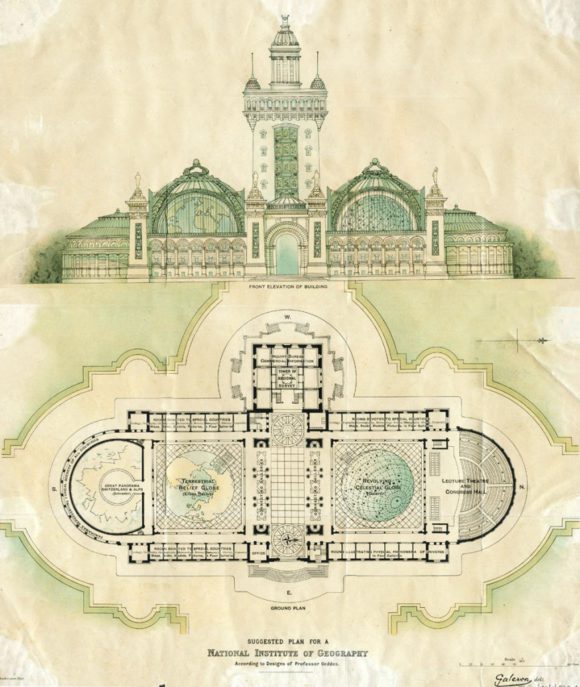
 L’évocation, certes rapide, de la vie de ce singulier chercheur, ne serait pas complète si l’on n’évoque pas le combat qu’il a mené pour l’égalité des droits entre femme et homme ainsi que ses convictions pacifistes.
L’évocation, certes rapide, de la vie de ce singulier chercheur, ne serait pas complète si l’on n’évoque pas le combat qu’il a mené pour l’égalité des droits entre femme et homme ainsi que ses convictions pacifistes.
« C’est par les feuilles que nous vivons. Certains ont l’idée étrange que ce serait la monnaie qui les fait vivre. Ils croient que l’énergie est générée par la circulation de l’argent. Alors que le monde est essentiellement une gigantesque colonie de feuillage, se développant et formant non seulement une masse minérale mais une véritable terre de feuilles. Ce n’est pas le tintement des pièces qui nous fait vivre mais bel et bien la plénitude de nos moissons. »









 Rien ne prédispose Milly à devenir une activiste féministe, anarchiste, militante infatigable pour la paix, contre le racisme, l’antisémitisme et l’exploitation des travailleurs par le Capital tout-puissant. Elle est née dans la petite ville de Zlatopol en Ukraine. La famille Vitkopsky, de confession juive, est d’origine russe et ukrainienne. Ainée de quatre sœurs, elle est la première à quitter son pays d’origine pour rejoindre la Grande Bretagne, en 1894. Elle espère trouver à Londres un travail suffisamment bien rémunéré pour permettre ensuite au restant de sa famille, dont l’existence est sans cesse menacée par les persécutions, de la rejoindre. Les conditions de travail sont particulièrement dures, même si une solidarité remarquable dans le quartier juif de l’East End permet aux émigrants de survivre. Ce n’est qu’en travaillant sans relâche qu’elle arrive à faire quelques économies pour atteindre son objectif. Elle prend très vite conscience des conditions invraisemblables dans lesquelles elle travaille, ainsi que ses compagnes. La lecture de la brochure rédigée par un anarchiste déjà célèbre à l’époque, Pierre Kropotkine, l’impressionne vivement et l’amène à rompre avec son ancien mode de pensée et ses traditions d’origine. Elle prend contact et s’implique dans l’équipe de militants qui rédige et diffuse le journal de propagande anarchiste « Arbeyter Fraynd ». Un an après son arrivée, elle fait la connaissance de Rudolf Rocker…
Rien ne prédispose Milly à devenir une activiste féministe, anarchiste, militante infatigable pour la paix, contre le racisme, l’antisémitisme et l’exploitation des travailleurs par le Capital tout-puissant. Elle est née dans la petite ville de Zlatopol en Ukraine. La famille Vitkopsky, de confession juive, est d’origine russe et ukrainienne. Ainée de quatre sœurs, elle est la première à quitter son pays d’origine pour rejoindre la Grande Bretagne, en 1894. Elle espère trouver à Londres un travail suffisamment bien rémunéré pour permettre ensuite au restant de sa famille, dont l’existence est sans cesse menacée par les persécutions, de la rejoindre. Les conditions de travail sont particulièrement dures, même si une solidarité remarquable dans le quartier juif de l’East End permet aux émigrants de survivre. Ce n’est qu’en travaillant sans relâche qu’elle arrive à faire quelques économies pour atteindre son objectif. Elle prend très vite conscience des conditions invraisemblables dans lesquelles elle travaille, ainsi que ses compagnes. La lecture de la brochure rédigée par un anarchiste déjà célèbre à l’époque, Pierre Kropotkine, l’impressionne vivement et l’amène à rompre avec son ancien mode de pensée et ses traditions d’origine. Elle prend contact et s’implique dans l’équipe de militants qui rédige et diffuse le journal de propagande anarchiste « Arbeyter Fraynd ». Un an après son arrivée, elle fait la connaissance de Rudolf Rocker…
 Dès 1898, il lui propose de l’accompagner à New York où il espère trouver un meilleur emploi. Milly accepte, mais le projet fait long feu. Les nouveaux immigrants sont repoussés à la frontière et rembarquent sur le bateau qui les a amenés. Entre autres éléments reconnus à charge par la très pudibonde Amérique, le fait que leur couple soit illégitime… Dès leur retour à Londres, ils reprennent leurs activités militantes. Outre le journal auquel ils collaboraient déjà, ils lancent une autre revue, « Germinal », dont l’orientation est plus culturelle. En 1907, nait leur fils, Fermin. Rudolf et Milly sont tous deux de farouches opposants à la guerre qui s’en vient à grands pas, ce qui les amène à prendre quelque distance avec Pierre Kropotkine avec lequel ils sont en désaccord complet. Leur militantisme pacifiste n’est pas du goût des autorités gouvernementales anglaises. A la fin de l’année 1914, Rudolf est emprisonné en tant que ressortissant d’un pays ennemi. Milly continue son action et organise notamment des soupes populaires pour les familles de chômeurs. Elle participe également aux manifestations de protestation organisées contre le choix qui est laissé aux immigrants russes : s’enrôler dans l’armée ou être déportés. Elle est arrêtée à son tour en 1916 et condamnée à deux années et demi de prison pour sa rébellion pleinement assumée… On lui promet une libération rapide si elle s’engage à renoncer à toute propagande antiguerre. Elle refuse et reste en prison jusqu’à l’automne 1918. Pendant ce temps, Rudolf est expulsé vers la Hollande en mars 1918. Le gouvernement hollandais ne veut pas de ce personnage important et souhaite le renvoyer en Allemagne, mais les douaniers refusent son entrée sur le territoire et il reste en Hollande jusqu’en novembre 1918, date à laquelle la famille est enfin réunie au complet.
Dès 1898, il lui propose de l’accompagner à New York où il espère trouver un meilleur emploi. Milly accepte, mais le projet fait long feu. Les nouveaux immigrants sont repoussés à la frontière et rembarquent sur le bateau qui les a amenés. Entre autres éléments reconnus à charge par la très pudibonde Amérique, le fait que leur couple soit illégitime… Dès leur retour à Londres, ils reprennent leurs activités militantes. Outre le journal auquel ils collaboraient déjà, ils lancent une autre revue, « Germinal », dont l’orientation est plus culturelle. En 1907, nait leur fils, Fermin. Rudolf et Milly sont tous deux de farouches opposants à la guerre qui s’en vient à grands pas, ce qui les amène à prendre quelque distance avec Pierre Kropotkine avec lequel ils sont en désaccord complet. Leur militantisme pacifiste n’est pas du goût des autorités gouvernementales anglaises. A la fin de l’année 1914, Rudolf est emprisonné en tant que ressortissant d’un pays ennemi. Milly continue son action et organise notamment des soupes populaires pour les familles de chômeurs. Elle participe également aux manifestations de protestation organisées contre le choix qui est laissé aux immigrants russes : s’enrôler dans l’armée ou être déportés. Elle est arrêtée à son tour en 1916 et condamnée à deux années et demi de prison pour sa rébellion pleinement assumée… On lui promet une libération rapide si elle s’engage à renoncer à toute propagande antiguerre. Elle refuse et reste en prison jusqu’à l’automne 1918. Pendant ce temps, Rudolf est expulsé vers la Hollande en mars 1918. Le gouvernement hollandais ne veut pas de ce personnage important et souhaite le renvoyer en Allemagne, mais les douaniers refusent son entrée sur le territoire et il reste en Hollande jusqu’en novembre 1918, date à laquelle la famille est enfin réunie au complet. En novembre 1918, profitant du chaos et de la désorganisation, Rocker retourne enfin en Allemagne, vingt-six années après avoir quitté son pays natal. La famille s’installe à Berlin… et reprend ses activités militantes au sein du mouvement syndicaliste révolutionnaire, et notamment de la toute nouvelle formation, la FAUD (Freie Arbeiter Union Deutschlands). Rudolf devient rapidement un personnage clé de ce syndicat aux côtés de ses amis Gustav Landauer et Eric Mühsam. Après l’écrasement de la République de Bavière, et à l’initiative du social démocrate Noske qui fait tirer sur les ouvriers en grève de Berlin, en février 1920, Rocker est emprisonné un mois. Pendant cette période, Milly s’engage aux côtés des femmes du syndicat pour que leur voix soit enfin entendue et que les militantes occupent les places qui doivent être les leurs. Elle participe à la création de l’Union des Femmes, à Berlin, et rédige une brochure intitulée Was will der Syndikalistische Frauenbund? (Qu’est-ce que les syndicats féminins veulent ?). Milly considère que les femmes sont victimes, comme les hommes, de l’exploitation capitaliste, mais qu’elles « bénéficient » d’une seconde exploitation par leurs partenaires masculins. Elle pense que le travail domestique doit être considéré comme tout aussi précieux que le travail salarié. Elle se bat pour une organisation autonome des femmes au sein de la FAUD. Très rapidement, une revue spécifique à la défense des droits des femmes est publiée comme supplément à la revue du syndicat. Des sujets importants sont abordés dans chaque numéro. Le débat sur la sexualité est l’un des plus vigoureux. Milly réclame un accès à la contraception et préconise une « grève de la procréation » pour que ce droit soit obtenu.
En novembre 1918, profitant du chaos et de la désorganisation, Rocker retourne enfin en Allemagne, vingt-six années après avoir quitté son pays natal. La famille s’installe à Berlin… et reprend ses activités militantes au sein du mouvement syndicaliste révolutionnaire, et notamment de la toute nouvelle formation, la FAUD (Freie Arbeiter Union Deutschlands). Rudolf devient rapidement un personnage clé de ce syndicat aux côtés de ses amis Gustav Landauer et Eric Mühsam. Après l’écrasement de la République de Bavière, et à l’initiative du social démocrate Noske qui fait tirer sur les ouvriers en grève de Berlin, en février 1920, Rocker est emprisonné un mois. Pendant cette période, Milly s’engage aux côtés des femmes du syndicat pour que leur voix soit enfin entendue et que les militantes occupent les places qui doivent être les leurs. Elle participe à la création de l’Union des Femmes, à Berlin, et rédige une brochure intitulée Was will der Syndikalistische Frauenbund? (Qu’est-ce que les syndicats féminins veulent ?). Milly considère que les femmes sont victimes, comme les hommes, de l’exploitation capitaliste, mais qu’elles « bénéficient » d’une seconde exploitation par leurs partenaires masculins. Elle pense que le travail domestique doit être considéré comme tout aussi précieux que le travail salarié. Elle se bat pour une organisation autonome des femmes au sein de la FAUD. Très rapidement, une revue spécifique à la défense des droits des femmes est publiée comme supplément à la revue du syndicat. Des sujets importants sont abordés dans chaque numéro. Le débat sur la sexualité est l’un des plus vigoureux. Milly réclame un accès à la contraception et préconise une « grève de la procréation » pour que ce droit soit obtenu.

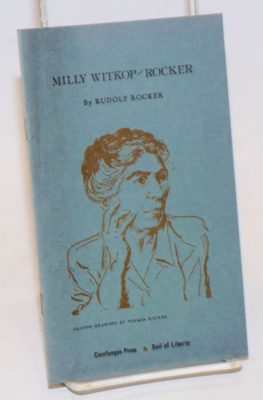 Rudolf Rocker mourut, à son tour, trois années plus tard, en septembre 1958. Durant cette période il continua à écrire et rédigea, entre autres, une brochure en hommage à sa compagne. Ce fait est suffisamment rare pour être signalé ! Bien que ce ne soit pas l’objet de mon propos, je tiens à vous signaler également que l’une des sœurs de Milly, Rose, était également une militante importante au sein du mouvement anarcha-féministe américain. Quant à leur fils Fermin, il devint un peintre réputé dont plusieurs œuvres peuvent être admirées sur le Web. Milly Witcop ayant peu écrit, certains mettront peut-être en doute l’importance du rôle qu’elle a eu dans l’œuvre de son mari. Je conclurai cette chronique en citant un autre extrait de la brochure que lui a consacré Rudolf :
Rudolf Rocker mourut, à son tour, trois années plus tard, en septembre 1958. Durant cette période il continua à écrire et rédigea, entre autres, une brochure en hommage à sa compagne. Ce fait est suffisamment rare pour être signalé ! Bien que ce ne soit pas l’objet de mon propos, je tiens à vous signaler également que l’une des sœurs de Milly, Rose, était également une militante importante au sein du mouvement anarcha-féministe américain. Quant à leur fils Fermin, il devint un peintre réputé dont plusieurs œuvres peuvent être admirées sur le Web. Milly Witcop ayant peu écrit, certains mettront peut-être en doute l’importance du rôle qu’elle a eu dans l’œuvre de son mari. Je conclurai cette chronique en citant un autre extrait de la brochure que lui a consacré Rudolf :
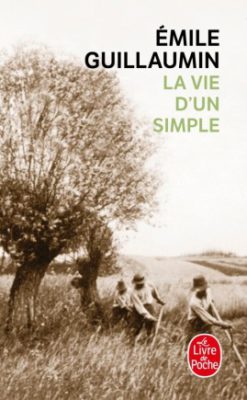 Ces temps-ci, je vous promène pas mal à la campagne (normal c’est mon environnement au quotidien !)… Eh bien, restons-y avec un excellent bouquin qui est loin d’être une nouveauté puisque publié pour la première fois en 1904 : La vie d’un simple, d’Emile Guillaumin. J’ai tardé à lire ce livre bien que j’en ai entendu parler depuis longtemps, notamment dans les écrits de Poulaille. Ayant déjà eu pas mal de déceptions avec des romans basés sur la vie paysanne, je craignais de découvrir un énième roman de terroir, chronique larmoyante d’une famille méritante… En fait, cela a été une belle surprise que ce livre. La beauté du style et la richesse des descriptions ethnologiques rendent sa lecture passionnante. Dès les premières pages on comprend que l’auteur est partie prenante dans son récit et qu’il connait, non seulement par sa réflexion mais aussi par le « toucher » de ses mains, le sujet qu’il traite en profondeur. Il s’agit d’un véritable témoignage sur la vie paysanne au XIXème siècle et les mutations qu’elle va connaître. Emile Guillaumin s’est impliqué dans la naissance du syndicalisme paysan, mais son ouvrage n’a rien d’un cahier de doléances ou de revendications. Il n’a que peu d’estime pour les politiques et quelques descriptions pittoresques témoignent de cette indifférence proche du mépris. Les notables socialisants ne sont pas épargnés. Proche d’un certain nombre d’idées exprimées par les Libertaires, l’auteur, ami de Griffuelhes, de Mirbeau ou de Poulaille, ne s’est jamais impliqué dans un quelconque mouvement. Sa dure vie de paysan-écrivain a mobilisé toute son énergie. Un bon demi-siècle s’écoule entre le début et la fin de « la vie d’un simple » (mi XIXème siècle – début XXème). Une période de changements lents mais réguliers dans le mode de vie. Au fil des pages de ce récit vibrant d’humanité, on se rend compte des aléas multiples auxquels tenait la survie de ces laboureurs, mais on prend aussi conscience de la cupidité de la majorité des propriétaires. Dans l’esprit de certains de ces bourgeois aisés, la place sociale de celui à qui ils louaient leurs terres n’était pas très éloignée de celle du serf au Moyen-Âge. Le héros de l’histoire dénonce toutes les injustices dont il est témoin avec une certaine modération. Il est souvent au bord de la révolte, mais le bon sens paysan domine et limite les propos outranciers. Sans être vraiment ni « partageux » ni socialiste, on sent, tout au long des pages, l’espérance de l’auteur en une évolution de la condition paysanne vers plus d’égalité et de justice. Une belle lecture.
Ces temps-ci, je vous promène pas mal à la campagne (normal c’est mon environnement au quotidien !)… Eh bien, restons-y avec un excellent bouquin qui est loin d’être une nouveauté puisque publié pour la première fois en 1904 : La vie d’un simple, d’Emile Guillaumin. J’ai tardé à lire ce livre bien que j’en ai entendu parler depuis longtemps, notamment dans les écrits de Poulaille. Ayant déjà eu pas mal de déceptions avec des romans basés sur la vie paysanne, je craignais de découvrir un énième roman de terroir, chronique larmoyante d’une famille méritante… En fait, cela a été une belle surprise que ce livre. La beauté du style et la richesse des descriptions ethnologiques rendent sa lecture passionnante. Dès les premières pages on comprend que l’auteur est partie prenante dans son récit et qu’il connait, non seulement par sa réflexion mais aussi par le « toucher » de ses mains, le sujet qu’il traite en profondeur. Il s’agit d’un véritable témoignage sur la vie paysanne au XIXème siècle et les mutations qu’elle va connaître. Emile Guillaumin s’est impliqué dans la naissance du syndicalisme paysan, mais son ouvrage n’a rien d’un cahier de doléances ou de revendications. Il n’a que peu d’estime pour les politiques et quelques descriptions pittoresques témoignent de cette indifférence proche du mépris. Les notables socialisants ne sont pas épargnés. Proche d’un certain nombre d’idées exprimées par les Libertaires, l’auteur, ami de Griffuelhes, de Mirbeau ou de Poulaille, ne s’est jamais impliqué dans un quelconque mouvement. Sa dure vie de paysan-écrivain a mobilisé toute son énergie. Un bon demi-siècle s’écoule entre le début et la fin de « la vie d’un simple » (mi XIXème siècle – début XXème). Une période de changements lents mais réguliers dans le mode de vie. Au fil des pages de ce récit vibrant d’humanité, on se rend compte des aléas multiples auxquels tenait la survie de ces laboureurs, mais on prend aussi conscience de la cupidité de la majorité des propriétaires. Dans l’esprit de certains de ces bourgeois aisés, la place sociale de celui à qui ils louaient leurs terres n’était pas très éloignée de celle du serf au Moyen-Âge. Le héros de l’histoire dénonce toutes les injustices dont il est témoin avec une certaine modération. Il est souvent au bord de la révolte, mais le bon sens paysan domine et limite les propos outranciers. Sans être vraiment ni « partageux » ni socialiste, on sent, tout au long des pages, l’espérance de l’auteur en une évolution de la condition paysanne vers plus d’égalité et de justice. Une belle lecture. Guère de points communs entre mon premier et mon second choix, si ce n’est qu’il s’agit encore une fois d’un récit empreint d’une profonde humanité. J’ai découvert, un peu par hasard (mais avec aussi un coup de pouce de la bibliothèque en ligne « Babelio », seul « réseau social » doit je sois membre) « La jeune fille et le fleuve » de Bernard Housseau, aux éditions Passiflore. J’ai tiré grand plaisir de cette lecture et je voudrais vous inciter à faire une découverte que les chroniqueurs de la énième rentrée littéraire n’ont, semble-t-il, pas faite pour l’instant…
Guère de points communs entre mon premier et mon second choix, si ce n’est qu’il s’agit encore une fois d’un récit empreint d’une profonde humanité. J’ai découvert, un peu par hasard (mais avec aussi un coup de pouce de la bibliothèque en ligne « Babelio », seul « réseau social » doit je sois membre) « La jeune fille et le fleuve » de Bernard Housseau, aux éditions Passiflore. J’ai tiré grand plaisir de cette lecture et je voudrais vous inciter à faire une découverte que les chroniqueurs de la énième rentrée littéraire n’ont, semble-t-il, pas faite pour l’instant…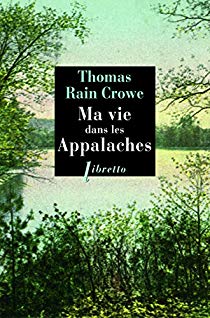 Les fans de Thoreau vont se régaler avec « Ma vie dans les Appalaches » de Thomas Rain Crowe. La filiation entre cet ouvrage et « Walden ou la vie dans les bois » est évidente et revendiquée par l’auteur. Son idée de départ, avant de se lancer dans l’expérience qu’il décrit dans son livre, est de faire comme son mentor – vivre dans une cabane en autarcie partielle – mais de prolonger son expérience pendant plusieurs années plutôt que de la limiter à une douzaine de mois. J’ai beaucoup aimé ce livre ; certains chapitres m’ont un peu moins accroché que d’autres mais j’ai apprécié la dernière partie malgré la nostalgie dont elle est pétrie. Au bout du compte, je me demande même si je n’ai pas préféré ce récit-là au Walden de Thoreau. Je craignais un peu au début que l’ouvrage soit écrit dans un esprit « guiness book », genre « il a tenu deux ans, moi je tiendrai quatre »… Dès le début du livre on comprend que ce n’est pas cet état d’esprit qui guide notre nouvel ermite. De plus, le temps qui sépare les deux expériences est suffisant pour que les données sociétales et environnementales ne soient plus les mêmes. Déjà entre les années 70 où se situe l’histoire et la décennie que nous parcourons à grandes enjambées, bien des éléments ont à nouveau changé et pas dans le bon sens. Bref, nous voilà face à un journal, pas vraiment chronologique, mais plutôt thématique. Les récits de vie quotidienne sont entrecoupés de réflexions intéressantes sur l’écologie, la place de l’argent dans notre monde, ou le peu de cas que nous faisons des savoirs ancestraux. Certaines idées prêtent à débat – probablement – mais il y a dans cet ouvrage matière à une réflexion sur des thèmes très concrets, abordés de manière non pontifiante. Par contre, si vous êtes amateurs d’intrigues et de péripéties rocambolesques, mieux vaut chercher ailleurs ! Personnellement, la vie d’ermite ne me conviendrait guère : les solutions communautaires, les réseaux, le partage… me paraissent plus adaptés… mais à travers le récit de Thomas Rain Crowe, de vraies questions sont posées et méritent que l’on cherche une ou des réponses possibles.
Les fans de Thoreau vont se régaler avec « Ma vie dans les Appalaches » de Thomas Rain Crowe. La filiation entre cet ouvrage et « Walden ou la vie dans les bois » est évidente et revendiquée par l’auteur. Son idée de départ, avant de se lancer dans l’expérience qu’il décrit dans son livre, est de faire comme son mentor – vivre dans une cabane en autarcie partielle – mais de prolonger son expérience pendant plusieurs années plutôt que de la limiter à une douzaine de mois. J’ai beaucoup aimé ce livre ; certains chapitres m’ont un peu moins accroché que d’autres mais j’ai apprécié la dernière partie malgré la nostalgie dont elle est pétrie. Au bout du compte, je me demande même si je n’ai pas préféré ce récit-là au Walden de Thoreau. Je craignais un peu au début que l’ouvrage soit écrit dans un esprit « guiness book », genre « il a tenu deux ans, moi je tiendrai quatre »… Dès le début du livre on comprend que ce n’est pas cet état d’esprit qui guide notre nouvel ermite. De plus, le temps qui sépare les deux expériences est suffisant pour que les données sociétales et environnementales ne soient plus les mêmes. Déjà entre les années 70 où se situe l’histoire et la décennie que nous parcourons à grandes enjambées, bien des éléments ont à nouveau changé et pas dans le bon sens. Bref, nous voilà face à un journal, pas vraiment chronologique, mais plutôt thématique. Les récits de vie quotidienne sont entrecoupés de réflexions intéressantes sur l’écologie, la place de l’argent dans notre monde, ou le peu de cas que nous faisons des savoirs ancestraux. Certaines idées prêtent à débat – probablement – mais il y a dans cet ouvrage matière à une réflexion sur des thèmes très concrets, abordés de manière non pontifiante. Par contre, si vous êtes amateurs d’intrigues et de péripéties rocambolesques, mieux vaut chercher ailleurs ! Personnellement, la vie d’ermite ne me conviendrait guère : les solutions communautaires, les réseaux, le partage… me paraissent plus adaptés… mais à travers le récit de Thomas Rain Crowe, de vraies questions sont posées et méritent que l’on cherche une ou des réponses possibles. Des péripéties, le livre « La naufragée du lac des dents blanches » de Patrice Gain aux éditions « Le mot et le reste » n’en manque pas. J’ai découvert ce livre un peu par hasard ; l’originalité du titre, le résumé de la quatrième de couverture et la confiance assez large que j’accorde à cette petite société d’édition marseillaise ont fait le reste. Je n’ai pas été déçu : l’auteur surfe avec habileté entre les passages mélodramatiques, l’humour de certains dialogues et la poésie des descriptions… Deux pêcheurs, pour se remettre d’un naufrage au large de l’île d’Ouessant, séjournent quelques temps dans le chalet d’un de leurs amis, en Haute-Savoie. Lors d’une randonnée, tout là-haut, dans l’éternité blanche, au bord d’un lac curieusement nommé, ils rencontrent une jeune femme noire épuisée. Elle se nomme Saamyia ; elle a fui son pays, la Somalie, où règne la terreur policière ; elle cherche désespérément les traces de sa fille Sahra dont elle a été séparée au cours de son périple. Nos deux héros et leur hôte se prennent de sympathie pour elle et décident de lui prêter assistance pour la suite de son enquête. Elle a besoin d’aide pour rejoindre la Suisse toute proche et prendre contact avec une institution charitable qui aurait pris son enfant en charge… Il n’en faut pas plus pour que nos quatre « zozos » ne se lancent à l’aventure… Débute alors une série d’aventures rocambolesques, une sorte de road movie en bateau, à pied, en motoneige… Plus nos enquêteurs avancent, plus leur objectif recule ; les raisons de désespérer sont nombreuses mais personne n’abandonne. Les trois hommes ont une attitude qui me rappelle parfois les personnages foutraques de la BD « les vieux fourneaux »… Le mélange des genres est pourtant une réussite : aucune maladresse, beaucoup d’humanité et de tendresse dans les relations au sein de ce quatuor improbable d’aventuriers… Difficile d’inscrire dans une catégorie quelconque ce livre qui a en tout cas le mérite d’évoquer de manière originale un thème tout à fait d’actualité à propos duquel la majorité de nos concitoyens ne brille pas par ses opinions et ses comportements.
Des péripéties, le livre « La naufragée du lac des dents blanches » de Patrice Gain aux éditions « Le mot et le reste » n’en manque pas. J’ai découvert ce livre un peu par hasard ; l’originalité du titre, le résumé de la quatrième de couverture et la confiance assez large que j’accorde à cette petite société d’édition marseillaise ont fait le reste. Je n’ai pas été déçu : l’auteur surfe avec habileté entre les passages mélodramatiques, l’humour de certains dialogues et la poésie des descriptions… Deux pêcheurs, pour se remettre d’un naufrage au large de l’île d’Ouessant, séjournent quelques temps dans le chalet d’un de leurs amis, en Haute-Savoie. Lors d’une randonnée, tout là-haut, dans l’éternité blanche, au bord d’un lac curieusement nommé, ils rencontrent une jeune femme noire épuisée. Elle se nomme Saamyia ; elle a fui son pays, la Somalie, où règne la terreur policière ; elle cherche désespérément les traces de sa fille Sahra dont elle a été séparée au cours de son périple. Nos deux héros et leur hôte se prennent de sympathie pour elle et décident de lui prêter assistance pour la suite de son enquête. Elle a besoin d’aide pour rejoindre la Suisse toute proche et prendre contact avec une institution charitable qui aurait pris son enfant en charge… Il n’en faut pas plus pour que nos quatre « zozos » ne se lancent à l’aventure… Débute alors une série d’aventures rocambolesques, une sorte de road movie en bateau, à pied, en motoneige… Plus nos enquêteurs avancent, plus leur objectif recule ; les raisons de désespérer sont nombreuses mais personne n’abandonne. Les trois hommes ont une attitude qui me rappelle parfois les personnages foutraques de la BD « les vieux fourneaux »… Le mélange des genres est pourtant une réussite : aucune maladresse, beaucoup d’humanité et de tendresse dans les relations au sein de ce quatuor improbable d’aventuriers… Difficile d’inscrire dans une catégorie quelconque ce livre qui a en tout cas le mérite d’évoquer de manière originale un thème tout à fait d’actualité à propos duquel la majorité de nos concitoyens ne brille pas par ses opinions et ses comportements.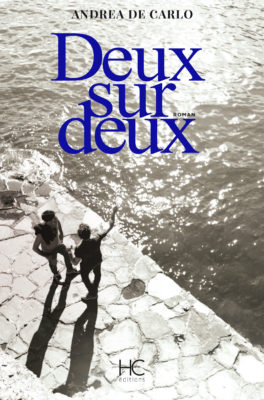 Dernier livre de cette deuxième sélection (attention il ne s’agit pas d’un classement !), « Deux sur deux« , roman écrit par un auteur italien, Andrea de Carlo, traduit et publié chez HC éditions. L’un de mes livres préférés de cet automne, mais comme je n’ai rien publié à cette période et qu’il s’agit d’un petit bijou dans le genre, il rejoint cette liste à la dernière minute. De quoi s’agit-il alors ? De façon tout à fait banale, d’une tranche de vie. On fait la connaissance des deux personnages principaux alors qu’ils sont encore au lycée. Ils suivent le même parcours politique et rejettent une société dont ils dénoncent les valeurs et à laquelle ils refusent de s’intégrer. Par la suite, la vie les sépare et tous deux suivent un parcours très différent, intégration ou marginalité… avant qu’ils ne se retrouvent et que les hasards de l’existence les amènent à confronter l’évolution de leur philosophie et surtout de leur comportement social. Dès le début, je me suis intéressé à ces personnages : j’ai eu l’impression de visionner à nouveau le film « le péril jeune » de
Dernier livre de cette deuxième sélection (attention il ne s’agit pas d’un classement !), « Deux sur deux« , roman écrit par un auteur italien, Andrea de Carlo, traduit et publié chez HC éditions. L’un de mes livres préférés de cet automne, mais comme je n’ai rien publié à cette période et qu’il s’agit d’un petit bijou dans le genre, il rejoint cette liste à la dernière minute. De quoi s’agit-il alors ? De façon tout à fait banale, d’une tranche de vie. On fait la connaissance des deux personnages principaux alors qu’ils sont encore au lycée. Ils suivent le même parcours politique et rejettent une société dont ils dénoncent les valeurs et à laquelle ils refusent de s’intégrer. Par la suite, la vie les sépare et tous deux suivent un parcours très différent, intégration ou marginalité… avant qu’ils ne se retrouvent et que les hasards de l’existence les amènent à confronter l’évolution de leur philosophie et surtout de leur comportement social. Dès le début, je me suis intéressé à ces personnages : j’ai eu l’impression de visionner à nouveau le film « le péril jeune » de  Balade matinale. La route goudronnée traverse un hameau et les constructions neuves, sans âme, qui sont venues le faire grossir. Elle continue sur quelques mètres puis devient chemin. L’herbe pousse dans les dernières flaques de bitume. Les talus, sur le bord, imprimés depuis longtemps dans le paysage, montrent qu’il s’agit d’un itinéraire ancien. Le passage plutôt fréquent des tracteurs conserve la trace bien visible. Il a gelé pendant la nuit et l’humidité est encore bien présente. Nos pas hésitent entre les ornières boueuses laissées par les roues, ou la bande centrale herbeuse où nos chaussures se gorgent d’eau : terre collante qui nécessitera un solide décapage des semelles ou chaussettes mouillées. Choix cornélien interrompu par la vue surprenante d’un arbre mort au milieu du labour. Il ne reste que les branches maîtresses et le tronc, un squelette d’arbre vénérable en quelque sorte. Il penche un peu et son avenir paraît précaire. Il est surprenant même que ni la charrue ni le tracteur ne soit venu à bout de cet acrobate chenu…
Balade matinale. La route goudronnée traverse un hameau et les constructions neuves, sans âme, qui sont venues le faire grossir. Elle continue sur quelques mètres puis devient chemin. L’herbe pousse dans les dernières flaques de bitume. Les talus, sur le bord, imprimés depuis longtemps dans le paysage, montrent qu’il s’agit d’un itinéraire ancien. Le passage plutôt fréquent des tracteurs conserve la trace bien visible. Il a gelé pendant la nuit et l’humidité est encore bien présente. Nos pas hésitent entre les ornières boueuses laissées par les roues, ou la bande centrale herbeuse où nos chaussures se gorgent d’eau : terre collante qui nécessitera un solide décapage des semelles ou chaussettes mouillées. Choix cornélien interrompu par la vue surprenante d’un arbre mort au milieu du labour. Il ne reste que les branches maîtresses et le tronc, un squelette d’arbre vénérable en quelque sorte. Il penche un peu et son avenir paraît précaire. Il est surprenant même que ni la charrue ni le tracteur ne soit venu à bout de cet acrobate chenu… Plus loin, un autre arbre, cousin du premier sans doute, a eu l’outrecuidance cet automne ou celui d’avant, de tomber en travers du chemin, déraciné par le vent ou par des labours trop proches de ses racines. Il reste quelques feuilles mortes sur les branches ce qui permet au randonneur détective de le ranger dans la catégorie des chênes blancs. Le diamètre du tronc, au niveau de la souche, est énorme, un peu plus d’un mètre sans doute. Lui, c’est évident, on ne l’a pas vu dans son enfance, ni à l’adolescence : un bon siècle sans doute. Le bois est sain mais une fente circulaire suit l’un des cernes, en plein milieu… Il s’agit d’un défaut que les scieurs nomment « roulure » (à ne pas confondre avec la gélivure qui est une fente rayonnante). Séquelle du coup de froid sibérien du fameux hiver 56 ? La première photo que nous prenons laisse un doute quant à sa taille. Dans la seconde, nous introduisons « l’échelle humaine » qui ne laisse planer aucune équivoque…
Plus loin, un autre arbre, cousin du premier sans doute, a eu l’outrecuidance cet automne ou celui d’avant, de tomber en travers du chemin, déraciné par le vent ou par des labours trop proches de ses racines. Il reste quelques feuilles mortes sur les branches ce qui permet au randonneur détective de le ranger dans la catégorie des chênes blancs. Le diamètre du tronc, au niveau de la souche, est énorme, un peu plus d’un mètre sans doute. Lui, c’est évident, on ne l’a pas vu dans son enfance, ni à l’adolescence : un bon siècle sans doute. Le bois est sain mais une fente circulaire suit l’un des cernes, en plein milieu… Il s’agit d’un défaut que les scieurs nomment « roulure » (à ne pas confondre avec la gélivure qui est une fente rayonnante). Séquelle du coup de froid sibérien du fameux hiver 56 ? La première photo que nous prenons laisse un doute quant à sa taille. Dans la seconde, nous introduisons « l’échelle humaine » qui ne laisse planer aucune équivoque… L’arbre poussait en bordure du chemin. Sa disparition permettra de gagner quelques mètres carrés de labour et une brassée de maïs supplémentaire. Dans les champs céréaliers, les arbres ne sont plus les bienvenus, même s’ils ont repris un peu la cote dans les pâturages. Nous sommes au faîte d’une colline et l’on ne voit pas l’extrémité de la parcelle labourée ; les sillons plongent dans la vallée. Au milieu de la terre subsiste un ilot de broussailles autour d’une bâtisse en ruines. Ce lieu a un certain écho dans nos souvenirs. Retour dans le passé, à l’époque où le vent rêveur du jeu de rôles avait quelque peu titillé notre imagination. Certaines aventures avaient lieu non pas autour d’une table, mais en pleine forêt, de nuit, de préférence. Lors d’un repérage, ce site particulier nous avait intrigués. Notre esprit créatif avait fait le reste et le vieux cabanon en pisé était devenu la ruine du logis d’un sorcier redoutable : la « tour des nuages ». Quelques fumigènes avaient accentué l’étrangeté du spectacle pour nos aventuriers prêts à se laisser entraîner. Magnifique promotion pour ce qui n’était sans doute qu’un cabanon de vigne. Ajoutez la lumière de la lune sur fond d’obscurité angoissante et le tableau devenait encore plus crédible. Trente ans de cela et les vieux murs en pisé tiennent toujours debout, obligeant la charrue à se détourner de son trajet rectiligne. Etonnant que la bâtisse, obstacle à l’avancée irrésistible du progrès technologique, soit toujours là. Trop de pierres, de ronces sans doute, qui font maintenant le bonheur des dernières vipères rouges du plateau.
L’arbre poussait en bordure du chemin. Sa disparition permettra de gagner quelques mètres carrés de labour et une brassée de maïs supplémentaire. Dans les champs céréaliers, les arbres ne sont plus les bienvenus, même s’ils ont repris un peu la cote dans les pâturages. Nous sommes au faîte d’une colline et l’on ne voit pas l’extrémité de la parcelle labourée ; les sillons plongent dans la vallée. Au milieu de la terre subsiste un ilot de broussailles autour d’une bâtisse en ruines. Ce lieu a un certain écho dans nos souvenirs. Retour dans le passé, à l’époque où le vent rêveur du jeu de rôles avait quelque peu titillé notre imagination. Certaines aventures avaient lieu non pas autour d’une table, mais en pleine forêt, de nuit, de préférence. Lors d’un repérage, ce site particulier nous avait intrigués. Notre esprit créatif avait fait le reste et le vieux cabanon en pisé était devenu la ruine du logis d’un sorcier redoutable : la « tour des nuages ». Quelques fumigènes avaient accentué l’étrangeté du spectacle pour nos aventuriers prêts à se laisser entraîner. Magnifique promotion pour ce qui n’était sans doute qu’un cabanon de vigne. Ajoutez la lumière de la lune sur fond d’obscurité angoissante et le tableau devenait encore plus crédible. Trente ans de cela et les vieux murs en pisé tiennent toujours debout, obligeant la charrue à se détourner de son trajet rectiligne. Etonnant que la bâtisse, obstacle à l’avancée irrésistible du progrès technologique, soit toujours là. Trop de pierres, de ronces sans doute, qui font maintenant le bonheur des dernières vipères rouges du plateau. Un peu plus loin, en arrivant vers le haut de la colline, se dresse un petit bois d’épicéas, une anomalie, une sorte de verrue au milieu des feuillus. Ma compagne me dit qu’elle se rappelle les avoir vus peu après leur plantation… Je n’en sais rien. Ma mémoire n’est pas aussi bonne que la sienne. Les arbres sont en mauvais état. Ils n’ont pas été « éclaircis » comme on dit quand on est du métier. Il y a un demi-siècle de cela on incitait tous les propriétaires de boisés à faire place nette pour planter des résineux. Sur les prospectus, on disait « c’est comme les peupliers, ça pousse tout seul, vite, sans entretien et quelques dizaines d’années plus tard, coupe rase et pactole dans la poche du vaillant planteur. » Mensonge de la propagande (celle-ci comme toutes les autres), c’était omettre de préciser qu’obtenir du bois de rapport nécessite un entretien régulier ; c’était aussi se garder de prévenir les assassins de feuillus que l’on n’importait pas des espèces au hasard dans une zone forestière et que chaque essence avait ses exigences. Les études sylvicoles ont progressé et l’on sait maintenant qu’une forêt est un ensemble vivant complexe au sein duquel les arbres s’entraident ; certaines espèces en supportent mieux d’autres et, faute de mycorhize convenable, les importations exogènes dépériront et disparaitront bien souvent à la génération suivante.
Un peu plus loin, en arrivant vers le haut de la colline, se dresse un petit bois d’épicéas, une anomalie, une sorte de verrue au milieu des feuillus. Ma compagne me dit qu’elle se rappelle les avoir vus peu après leur plantation… Je n’en sais rien. Ma mémoire n’est pas aussi bonne que la sienne. Les arbres sont en mauvais état. Ils n’ont pas été « éclaircis » comme on dit quand on est du métier. Il y a un demi-siècle de cela on incitait tous les propriétaires de boisés à faire place nette pour planter des résineux. Sur les prospectus, on disait « c’est comme les peupliers, ça pousse tout seul, vite, sans entretien et quelques dizaines d’années plus tard, coupe rase et pactole dans la poche du vaillant planteur. » Mensonge de la propagande (celle-ci comme toutes les autres), c’était omettre de préciser qu’obtenir du bois de rapport nécessite un entretien régulier ; c’était aussi se garder de prévenir les assassins de feuillus que l’on n’importait pas des espèces au hasard dans une zone forestière et que chaque essence avait ses exigences. Les études sylvicoles ont progressé et l’on sait maintenant qu’une forêt est un ensemble vivant complexe au sein duquel les arbres s’entraident ; certaines espèces en supportent mieux d’autres et, faute de mycorhize convenable, les importations exogènes dépériront et disparaitront bien souvent à la génération suivante. Notre chemin avance dans la forêt. Depuis notre dernier passage il y a eu quelques coupes. L’une d’entre elles attire notre regard. Les bûcherons ont pris leur temps et travaillé « à l’ancienne » c’est à dire proprement. Le taillis a été coupé à blanc, mais ceux qui se sont chargés de l’abattage ont pris soin de laisser en place quelques chênes au port majestueux. Ils sont suffisamment rapprochés pour que leur ombre protège les jeunes pousses qui se développent à leur pied, et pour que le vent n’ait pas trop la tâche facile pour les pousser à la chute. J’admire au passage quelques jolis troncs qui dominent leurs voisins au milieu de la forêt intacte ; je reconnais quelques merisiers, des acacias, d’autres chênes préservés par les anciens lorsqu’ils ont fait leur coupe. Un voisin paysan, fort sage, m’avait expliqué que sur cette colline, on pouvait couper le taillis de châtaignier ou d’acacia tous les vingt ans, mais qu’il fallait laisser les plus belles pousses, les perches isolées et bien droites ; il fallait sauter au moins deux ou trois coupes… si l’on voulait des fûts de qualité pour faire les tonneaux… Les forestiers appellent ce genre de parcelle du taillis sous futaie. Cela me paraît être une exploitation intelligente de la ressource. Nous nous chauffons au bois et il faut bien que la cargaison de bûches qu’engloutit notre chaudière vienne de quelque part. Quant au châtaignier, s’il dépasse une soixantaine d’années, il devient un arbre remarquable, offre des fruits savoureux au promeneur, mais son bois perd tout intérêt comme bois d’œuvre. Le contraire du chêne en quelque sorte !
Notre chemin avance dans la forêt. Depuis notre dernier passage il y a eu quelques coupes. L’une d’entre elles attire notre regard. Les bûcherons ont pris leur temps et travaillé « à l’ancienne » c’est à dire proprement. Le taillis a été coupé à blanc, mais ceux qui se sont chargés de l’abattage ont pris soin de laisser en place quelques chênes au port majestueux. Ils sont suffisamment rapprochés pour que leur ombre protège les jeunes pousses qui se développent à leur pied, et pour que le vent n’ait pas trop la tâche facile pour les pousser à la chute. J’admire au passage quelques jolis troncs qui dominent leurs voisins au milieu de la forêt intacte ; je reconnais quelques merisiers, des acacias, d’autres chênes préservés par les anciens lorsqu’ils ont fait leur coupe. Un voisin paysan, fort sage, m’avait expliqué que sur cette colline, on pouvait couper le taillis de châtaignier ou d’acacia tous les vingt ans, mais qu’il fallait laisser les plus belles pousses, les perches isolées et bien droites ; il fallait sauter au moins deux ou trois coupes… si l’on voulait des fûts de qualité pour faire les tonneaux… Les forestiers appellent ce genre de parcelle du taillis sous futaie. Cela me paraît être une exploitation intelligente de la ressource. Nous nous chauffons au bois et il faut bien que la cargaison de bûches qu’engloutit notre chaudière vienne de quelque part. Quant au châtaignier, s’il dépasse une soixantaine d’années, il devient un arbre remarquable, offre des fruits savoureux au promeneur, mais son bois perd tout intérêt comme bois d’œuvre. Le contraire du chêne en quelque sorte ! Il y a une sorte d’ivresse de la marche ; il me semble que nous avançons d’un pas plus rapide et plus assuré. Les randonneurs chevronnés vous le diront : ce sont les premiers kilomètres qui coûtent le plus cher. Après, on va de l’avant sans trop se poser de questions. La longue grimpette que nous avons suivie est terminée également et cela facilite le travail pour nos jambes vieillissantes. Il n’y a peut-être pas à aller chercher plus loin notre accélération sensible.
Il y a une sorte d’ivresse de la marche ; il me semble que nous avançons d’un pas plus rapide et plus assuré. Les randonneurs chevronnés vous le diront : ce sont les premiers kilomètres qui coûtent le plus cher. Après, on va de l’avant sans trop se poser de questions. La longue grimpette que nous avons suivie est terminée également et cela facilite le travail pour nos jambes vieillissantes. Il n’y a peut-être pas à aller chercher plus loin notre accélération sensible.
 Deux bons romans graphiques sur le même thème et de la même auteure pour commencer. Il s’agit de « Disgrazia » et de « Mais pour toi demain il fera beau » de Coline Picaud, éditions « le monde à l’envers », Grenoble. Je vous conseille de lire ces deux livres dans l’ordre indiqué, même si ce sont deux récits indépendants. Le thème ? Eh bien il s’agit de raconter l’immigration italienne en France au XXème siècle, à travers l’histoire d’une famille, celle de l’auteure. Nous voilà partis pour une découverte d’arbre généalogique, parfois un peu « fouillis » mais ô combien sympathique et pleine d’humanité. La France, terre d’accueil ? On peut avoir des doutes lorsque l’on vient de lire la chronique que j’ai écrite à propos de la « Retirada » ; on en a encore plus lorsque l’on découvre dans quelles conditions ont été accueillis les nouveaux arrivants d’autres contrées, que ce soit la Pologne, l’Italie ou l’Afrique du Nord… Ce qui est intéressant dans le récit de Coline Picaud, c’est qu’au travers d’événements familiaux, on découvre l’histoire du monde ouvrier, la vie quotidienne des « sans dents » préférés de notre bon président : conditions de vie misérables, combats, victoires, défaites, solidarité, individualisme… De grandes questions sont traitées au fil des pages. En toile de fond, le Front populaire, la guerre mondiale, la libération… pour le tome 1 ; les grandes grèves ouvrières comme celle des Penn Sardines, la naissance des Auberges de Jeunesse ou l’affirmation du féminisme pour le tome 2. Bref c’est fouillé, c’est « nourrissant », et ce sont deux livres sur lesquels on a envie de revenir pour mieux comprendre, mieux enregistrer. Au début, je n’étais pas fan du graphisme, mais je m’y suis rapidement habitué. Si vous aimez les récits structurés, hyper-ordonnés, vous risquez d’être un peu déstabilisés, mais si vous avez eu déjà l’occasion de prêter attention à un arbre généalogique alors vous comprendrez la logique singulière de l’histoire. Personnellement, c’est une période que je connais assez bien, surtout à travers les récits d’historiens. Je trouve particulièrement intéressant de découvrir le récit d’événements à travers le témoignage de ceux qui y ont été impliqués, parfois au degré zéro. Quelques portraits très colorés de dirigeants communistes de l’époque : je pense en particulier à celui de Charles Tillon stalinien notoire pour lequel je n’ai guère de sympathie. Merci à l’auteure aussi d’évoquer la présence de militant(e)s anarchistes dans les luttes ; omission trop fréquente sous la plume des historiens officiels du Parti avec un grand P.
Deux bons romans graphiques sur le même thème et de la même auteure pour commencer. Il s’agit de « Disgrazia » et de « Mais pour toi demain il fera beau » de Coline Picaud, éditions « le monde à l’envers », Grenoble. Je vous conseille de lire ces deux livres dans l’ordre indiqué, même si ce sont deux récits indépendants. Le thème ? Eh bien il s’agit de raconter l’immigration italienne en France au XXème siècle, à travers l’histoire d’une famille, celle de l’auteure. Nous voilà partis pour une découverte d’arbre généalogique, parfois un peu « fouillis » mais ô combien sympathique et pleine d’humanité. La France, terre d’accueil ? On peut avoir des doutes lorsque l’on vient de lire la chronique que j’ai écrite à propos de la « Retirada » ; on en a encore plus lorsque l’on découvre dans quelles conditions ont été accueillis les nouveaux arrivants d’autres contrées, que ce soit la Pologne, l’Italie ou l’Afrique du Nord… Ce qui est intéressant dans le récit de Coline Picaud, c’est qu’au travers d’événements familiaux, on découvre l’histoire du monde ouvrier, la vie quotidienne des « sans dents » préférés de notre bon président : conditions de vie misérables, combats, victoires, défaites, solidarité, individualisme… De grandes questions sont traitées au fil des pages. En toile de fond, le Front populaire, la guerre mondiale, la libération… pour le tome 1 ; les grandes grèves ouvrières comme celle des Penn Sardines, la naissance des Auberges de Jeunesse ou l’affirmation du féminisme pour le tome 2. Bref c’est fouillé, c’est « nourrissant », et ce sont deux livres sur lesquels on a envie de revenir pour mieux comprendre, mieux enregistrer. Au début, je n’étais pas fan du graphisme, mais je m’y suis rapidement habitué. Si vous aimez les récits structurés, hyper-ordonnés, vous risquez d’être un peu déstabilisés, mais si vous avez eu déjà l’occasion de prêter attention à un arbre généalogique alors vous comprendrez la logique singulière de l’histoire. Personnellement, c’est une période que je connais assez bien, surtout à travers les récits d’historiens. Je trouve particulièrement intéressant de découvrir le récit d’événements à travers le témoignage de ceux qui y ont été impliqués, parfois au degré zéro. Quelques portraits très colorés de dirigeants communistes de l’époque : je pense en particulier à celui de Charles Tillon stalinien notoire pour lequel je n’ai guère de sympathie. Merci à l’auteure aussi d’évoquer la présence de militant(e)s anarchistes dans les luttes ; omission trop fréquente sous la plume des historiens officiels du Parti avec un grand P.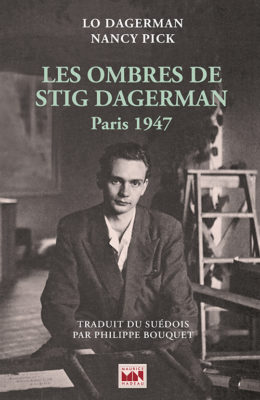 Pour apprécier (comme cela a été mon cas) le troisième ouvrage de ma sélection, « Les ombres de Stig Dagerman« , il vaut mieux connaître les relations entre l’écrivain suédois Stig Dagerman et la militante d’origine autrichienne Etta Federn. Pour le premier, la meilleure solution c’est de se plonger dans une biographie ou directement dans un roman : « automne allemand » ou « printemps français » parmi d’autres. Je ne vais pas vous dresser à nouveau un portrait de ces deux personnages singuliers ; je l’ai déjà fait ! Comme toujours, la « Feuille charbinoise » est présente pour vous aider à vous cultiver… A relire donc : «
Pour apprécier (comme cela a été mon cas) le troisième ouvrage de ma sélection, « Les ombres de Stig Dagerman« , il vaut mieux connaître les relations entre l’écrivain suédois Stig Dagerman et la militante d’origine autrichienne Etta Federn. Pour le premier, la meilleure solution c’est de se plonger dans une biographie ou directement dans un roman : « automne allemand » ou « printemps français » parmi d’autres. Je ne vais pas vous dresser à nouveau un portrait de ces deux personnages singuliers ; je l’ai déjà fait ! Comme toujours, la « Feuille charbinoise » est présente pour vous aider à vous cultiver… A relire donc : « 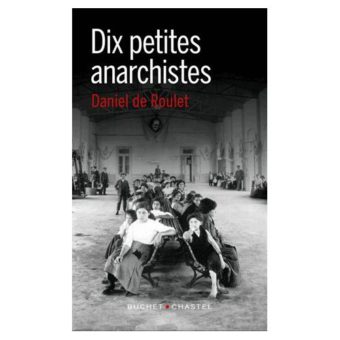 Italie, Espagne, Suède… Cet hiver, je voyage dans mon fauteuil. Nouvelle escale, en Patagonie cette fois, avec le livre de Daniel de Roulet, « Dix petites anarchistes« , aux éditions Buchet-Chastel… Beaucoup de sympathie pour ce roman profondément humain, original, fort bien écrit et basé sur un assemblage solidement documenté de faits réels. Certes l’histoire n’est qu’une fiction, mais, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il s’en est passé des choses dans le milieu libertaire au tournant du XIXème au XXème siècle ! Les tentatives pour créer « ici et maintenant » une utopie que l’on était pressés de voir se réaliser, sans attendre le lendemain du « grand soir », ont été nombreuses. La Cecilia, colonie montée par des militantes et militants italiens est la plus « médiatisée » (si l’on peut dire) mais les expériences se dénombrent par centaine. Objet principal du propos de l’auteur, le projet de ces jeunes libertaires du vallon de St Ismier dans le Jura suisse est original : créer une colonie anarchiste à la pointe méridionale du continent sud-américain ; rester « entre femmes », au moins dans les premiers temps. Elles sont dix à mettre en commun leurs idées un peu folles et leurs maigres moyens financiers. Quelque peu abusées par la propagande de l’époque (incitant à l’émigration les Suisses les plus pauvres), leur choix de destination est plutôt improbable puisqu’il s’agit de la Patagonie, la « terre de feu » de sinistre mémoire dans les récits des navigateurs. Mais la rigueur du climat et de l’accueil des colons déjà installés ne viendront pas à bout de leur résolution. Les luttes, les échecs, mais aussi les réussites (car le récit n’a rien de larmoyant) vont être nombreux. Au fur et à mesure de l’avancée de l’histoire, la petite troupe du départ perd peu à peu ses membres pour des motifs assez variés. Parmi les multiples idées lumineuses du « metteur en scène » de ce récit, celle d’avoir choisi une trame inspirée par « les dix petits nègres » d’une romancière célèbre… Comme « mise en bouche » ou, selon votre souhait, comme « postface », je vous invite à écouter
Italie, Espagne, Suède… Cet hiver, je voyage dans mon fauteuil. Nouvelle escale, en Patagonie cette fois, avec le livre de Daniel de Roulet, « Dix petites anarchistes« , aux éditions Buchet-Chastel… Beaucoup de sympathie pour ce roman profondément humain, original, fort bien écrit et basé sur un assemblage solidement documenté de faits réels. Certes l’histoire n’est qu’une fiction, mais, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il s’en est passé des choses dans le milieu libertaire au tournant du XIXème au XXème siècle ! Les tentatives pour créer « ici et maintenant » une utopie que l’on était pressés de voir se réaliser, sans attendre le lendemain du « grand soir », ont été nombreuses. La Cecilia, colonie montée par des militantes et militants italiens est la plus « médiatisée » (si l’on peut dire) mais les expériences se dénombrent par centaine. Objet principal du propos de l’auteur, le projet de ces jeunes libertaires du vallon de St Ismier dans le Jura suisse est original : créer une colonie anarchiste à la pointe méridionale du continent sud-américain ; rester « entre femmes », au moins dans les premiers temps. Elles sont dix à mettre en commun leurs idées un peu folles et leurs maigres moyens financiers. Quelque peu abusées par la propagande de l’époque (incitant à l’émigration les Suisses les plus pauvres), leur choix de destination est plutôt improbable puisqu’il s’agit de la Patagonie, la « terre de feu » de sinistre mémoire dans les récits des navigateurs. Mais la rigueur du climat et de l’accueil des colons déjà installés ne viendront pas à bout de leur résolution. Les luttes, les échecs, mais aussi les réussites (car le récit n’a rien de larmoyant) vont être nombreux. Au fur et à mesure de l’avancée de l’histoire, la petite troupe du départ perd peu à peu ses membres pour des motifs assez variés. Parmi les multiples idées lumineuses du « metteur en scène » de ce récit, celle d’avoir choisi une trame inspirée par « les dix petits nègres » d’une romancière célèbre… Comme « mise en bouche » ou, selon votre souhait, comme « postface », je vous invite à écouter 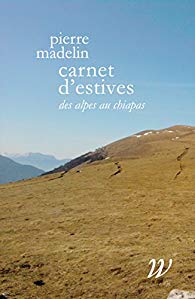 « Carnet d’estives, des Alpes au Chiapas« … J’avoue que j’étais un peu dubitatif en abordant ce livre : auteur inconnu, thème faisant l’objet d’abondantes publications, souvent redondantes. Jamais, je pense, on a autant écrit sur la nature, la montagne, les animaux, l’écologie, alors que concrètement, sur le terrain, la situation va en se dégradant à une vitesse inquiétante. Eh bien je reconnais nettement que j’avais tort d’avoir des doutes. L’ouvrage de Pierre Madelin, collection de brefs récits sur le thème de la vie pastorale, de la montagne et du rapport entre l’homme et la nature, est fort intéressant et soutenu par une réflexion solide et argumentée. L’auteur nous fait voyager effectivement des Alpes au Chiapas avec une brève escale dans les parcs nationaux aux USA… Le style est vivant, le propos souvent mordant, et je partage nombre des idées exprimées par l’auteur (ce qui, après tout, ne fait qu’améliorer le confort du lecteur !). Ma lecture terminée, cela m’a donné envie de découvrir son second opus « après le capitalisme« , qui traite d’un problème d’une actualité brûlante. Peut-on encore faire prendre un virage à ce train fou qui se précipite droit contre la montagne ? Et quel virage si l’on veut que l’homme puisse enfin établir un rapport harmonieux avec l’ensemble des êtres vivants (y compris lui-même) tout en jouissant d’une liberté à laquelle il aspire depuis les origines ?… Le sujet est plus aride et j’avoue avoir préféré le récit du berger à celui du théoricien que j’ai trouvé un peu touffu. Cela ne m’empêche pas de vous en recommander aussi la lecture. Il est intéressant de réfléchir à quoi « demain sera fait » s’il y a encore un demain ! Le premier livre est publié chez « Wildproject éditions » et le second chez « Ecosociété ».
« Carnet d’estives, des Alpes au Chiapas« … J’avoue que j’étais un peu dubitatif en abordant ce livre : auteur inconnu, thème faisant l’objet d’abondantes publications, souvent redondantes. Jamais, je pense, on a autant écrit sur la nature, la montagne, les animaux, l’écologie, alors que concrètement, sur le terrain, la situation va en se dégradant à une vitesse inquiétante. Eh bien je reconnais nettement que j’avais tort d’avoir des doutes. L’ouvrage de Pierre Madelin, collection de brefs récits sur le thème de la vie pastorale, de la montagne et du rapport entre l’homme et la nature, est fort intéressant et soutenu par une réflexion solide et argumentée. L’auteur nous fait voyager effectivement des Alpes au Chiapas avec une brève escale dans les parcs nationaux aux USA… Le style est vivant, le propos souvent mordant, et je partage nombre des idées exprimées par l’auteur (ce qui, après tout, ne fait qu’améliorer le confort du lecteur !). Ma lecture terminée, cela m’a donné envie de découvrir son second opus « après le capitalisme« , qui traite d’un problème d’une actualité brûlante. Peut-on encore faire prendre un virage à ce train fou qui se précipite droit contre la montagne ? Et quel virage si l’on veut que l’homme puisse enfin établir un rapport harmonieux avec l’ensemble des êtres vivants (y compris lui-même) tout en jouissant d’une liberté à laquelle il aspire depuis les origines ?… Le sujet est plus aride et j’avoue avoir préféré le récit du berger à celui du théoricien que j’ai trouvé un peu touffu. Cela ne m’empêche pas de vous en recommander aussi la lecture. Il est intéressant de réfléchir à quoi « demain sera fait » s’il y a encore un demain ! Le premier livre est publié chez « Wildproject éditions » et le second chez « Ecosociété ».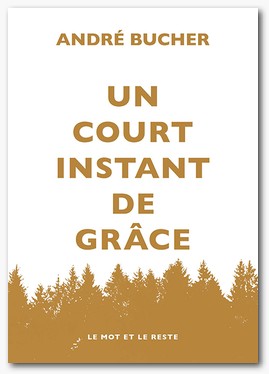 Je termine ce premier inventaire hivernal, par un livre d’André Bucher, notre « écrivain naturaliste » national (désolé, je n’aime pas le terme « nature writing » qui me paraît venir d’une autre langue…), « Un court instant de grâce » publié chez l’excellent éditeur « Le mot et le reste ». Chaque année je découvre un ou deux volumes supplémentaires de l’œuvre plutôt conséquente de cet auteur. C’est une valeur sûre de ma bibliothèque et je suis rarement déçu. Ça n’a toujours pas été le cas avec ce livre qui raconte l’accouchement difficile d’un amour entre deux fortes personnalités d’un certain âge et d’un âge certain. Tout cela est emballé de main de maître dans un décor de montagne somptueux : forêts, torrents, chemins sinueux… Au cœur du roman, une de ces forêts que nos technocrates investisseurs modernes rêvent à tout prix de « normaliser » et de « rentabiliser ». Bien entendu, ces pourfendeurs d’archaïsmes économiques sont handicapés dans leur valeureuse entreprise par les menées d’une écologiste vénérable ; l’une de ces grands-mères que l’on rencontre de plus en plus souvent dans les manifestations, pour lesquelles la « qualité de vie » passe bien avant les profits et la courbe ascendante du CACA 40. Je ne vous dis pas qui gagne à la fin mais sachez que l’histoire m’a profondément touché et tirez-en un indice grâce à votre perspicacité. En attendant ma prochaine lecture de ce grand Monsieur drômois, prenez bien soin de votre petite personne et admirez les flocons plus que les flacons ! En tout cas, tous ces livres et bien d’autres peuvent être consommés sans modération.
Je termine ce premier inventaire hivernal, par un livre d’André Bucher, notre « écrivain naturaliste » national (désolé, je n’aime pas le terme « nature writing » qui me paraît venir d’une autre langue…), « Un court instant de grâce » publié chez l’excellent éditeur « Le mot et le reste ». Chaque année je découvre un ou deux volumes supplémentaires de l’œuvre plutôt conséquente de cet auteur. C’est une valeur sûre de ma bibliothèque et je suis rarement déçu. Ça n’a toujours pas été le cas avec ce livre qui raconte l’accouchement difficile d’un amour entre deux fortes personnalités d’un certain âge et d’un âge certain. Tout cela est emballé de main de maître dans un décor de montagne somptueux : forêts, torrents, chemins sinueux… Au cœur du roman, une de ces forêts que nos technocrates investisseurs modernes rêvent à tout prix de « normaliser » et de « rentabiliser ». Bien entendu, ces pourfendeurs d’archaïsmes économiques sont handicapés dans leur valeureuse entreprise par les menées d’une écologiste vénérable ; l’une de ces grands-mères que l’on rencontre de plus en plus souvent dans les manifestations, pour lesquelles la « qualité de vie » passe bien avant les profits et la courbe ascendante du CACA 40. Je ne vous dis pas qui gagne à la fin mais sachez que l’histoire m’a profondément touché et tirez-en un indice grâce à votre perspicacité. En attendant ma prochaine lecture de ce grand Monsieur drômois, prenez bien soin de votre petite personne et admirez les flocons plus que les flacons ! En tout cas, tous ces livres et bien d’autres peuvent être consommés sans modération.
 Le ton est donné dès le passage de la frontière. La police française, secondée par l’armée, effectue un premier tri entre les combattants d’une part (qui sont systématiquement dépouillés de leurs armes) et les civils. Les humiliations et souvent les mauvais traitements s’accumulent pour ces hommes et ces femmes qui ont su résister pendant plus de trois années à une guerre impitoyable et à un impressionnant déséquilibre des forces militaires en présence. Mais il ne s’agit là que des préliminaires de l’improvisation qui va suivre. Comme on le leur répète à longueur de journée : « les rouges ne sont pas les bienvenus » et « la France est bien bonne de ne pas purement et simplement les refouler de l’autre côté de la frontière ». Par chance, tous les citoyens de notre pays ne marchent pas au pas derrière la lâcheté de leur gouvernement. Dans les mois qui vont suivre, quelques Républicains chanceux seront accueillis à bras ouvert dans des familles pour lesquelles le terme de solidarité n’est pas un mot creux. Mais la très grande majorité de ceux qui vont passer la frontière n’aura pas cette chance. Ils vont se retrouver dans des camps de concentration obligeamment mis à leur disposition par les autorités. Femmes, enfants, vieillards, infirmes… sont parqués dans des lieux qui ont conservé pour les survivants et leurs descendants une sinistre réputation : Rivesaltes, Argelès, Gurs, le Vernet, Septfonds… Pour la plupart, ces camps seront installés en grande hâte, et continueront à jouer leur rôle pendant une partie de la guerre : Juifs, Tziganes, Maquisards… occuperont les places des Espagnols ; les camps serviront alors de « vivier » pour les déportations vers les camps de la mort en Allemagne.
Le ton est donné dès le passage de la frontière. La police française, secondée par l’armée, effectue un premier tri entre les combattants d’une part (qui sont systématiquement dépouillés de leurs armes) et les civils. Les humiliations et souvent les mauvais traitements s’accumulent pour ces hommes et ces femmes qui ont su résister pendant plus de trois années à une guerre impitoyable et à un impressionnant déséquilibre des forces militaires en présence. Mais il ne s’agit là que des préliminaires de l’improvisation qui va suivre. Comme on le leur répète à longueur de journée : « les rouges ne sont pas les bienvenus » et « la France est bien bonne de ne pas purement et simplement les refouler de l’autre côté de la frontière ». Par chance, tous les citoyens de notre pays ne marchent pas au pas derrière la lâcheté de leur gouvernement. Dans les mois qui vont suivre, quelques Républicains chanceux seront accueillis à bras ouvert dans des familles pour lesquelles le terme de solidarité n’est pas un mot creux. Mais la très grande majorité de ceux qui vont passer la frontière n’aura pas cette chance. Ils vont se retrouver dans des camps de concentration obligeamment mis à leur disposition par les autorités. Femmes, enfants, vieillards, infirmes… sont parqués dans des lieux qui ont conservé pour les survivants et leurs descendants une sinistre réputation : Rivesaltes, Argelès, Gurs, le Vernet, Septfonds… Pour la plupart, ces camps seront installés en grande hâte, et continueront à jouer leur rôle pendant une partie de la guerre : Juifs, Tziganes, Maquisards… occuperont les places des Espagnols ; les camps serviront alors de « vivier » pour les déportations vers les camps de la mort en Allemagne. Dès l’approche du printemps, le gouvernement, soucieux d’alléger la « charge » que représentent tous ces internés pour les départements limitrophes de la frontière, met en œuvre un certain nombre de procédures. En premier lieu, la décentralisation : de nouveaux camps sont créés à l’intérieur du pays, chaque département ou presque devant héberger son lot d’indésirables. J’ai raconté cela en détail dans les deux billets où j’ai parlé d’un camp d’internement méconnu et proche de mon domicile, celui d’Arandon. Cette solution temporaire n’est pas la seule envisagée. Très vite, on incite les réfugiés à retourner dans leur pays d’origine ; la propagande explique que non, il n’y a pas tant de risque que cela, que ceux qui n’ont pas commis de crimes graves ne seront pas inquiétés… discours de pure propagande qui fonctionne un peu, mais pas trop, heureusement, car parmi ceux qui écoutent les boniments gouvernementaux, beaucoup y laisseront la vie ou la liberté pour de longues années. Le nouveau régime fasciste en place ne pardonne rien et exécute massivement. Pour ce qui est des combattants, on leur propose de rejoindre la Légion étrangère ou les camps de travail pour étrangers qui sont mis en place. Il est hors de question que notre pays perde le bénéfice d’une main d’œuvre que l’on peut faire travailler dans des conditions proches de l’esclavage. Ils sont assez nombreux à accepter ce changement de statut, d’autant que certains de ces anciens miliciens souhaitent participer à la guerre contre l’Allemagne n’oubliant pas l’aide que ce pays a apporté à Franco. Une partie d’entre eux seront envoyés par exemple sur la ligne Maginot pour participer aux travaux de consolidation ; pris en tenaille par l’offensive allemande, ils auront la joie de connaître d’autres camps, de l’autre côté du Rhin cette fois-ci. Les Espagnols bénéficient d’un « traitement de faveur » de la part des Nazis : dans le camp de Mauthausen, 80% des détenus sont espagnols. 8 000 périront en déportation.
Dès l’approche du printemps, le gouvernement, soucieux d’alléger la « charge » que représentent tous ces internés pour les départements limitrophes de la frontière, met en œuvre un certain nombre de procédures. En premier lieu, la décentralisation : de nouveaux camps sont créés à l’intérieur du pays, chaque département ou presque devant héberger son lot d’indésirables. J’ai raconté cela en détail dans les deux billets où j’ai parlé d’un camp d’internement méconnu et proche de mon domicile, celui d’Arandon. Cette solution temporaire n’est pas la seule envisagée. Très vite, on incite les réfugiés à retourner dans leur pays d’origine ; la propagande explique que non, il n’y a pas tant de risque que cela, que ceux qui n’ont pas commis de crimes graves ne seront pas inquiétés… discours de pure propagande qui fonctionne un peu, mais pas trop, heureusement, car parmi ceux qui écoutent les boniments gouvernementaux, beaucoup y laisseront la vie ou la liberté pour de longues années. Le nouveau régime fasciste en place ne pardonne rien et exécute massivement. Pour ce qui est des combattants, on leur propose de rejoindre la Légion étrangère ou les camps de travail pour étrangers qui sont mis en place. Il est hors de question que notre pays perde le bénéfice d’une main d’œuvre que l’on peut faire travailler dans des conditions proches de l’esclavage. Ils sont assez nombreux à accepter ce changement de statut, d’autant que certains de ces anciens miliciens souhaitent participer à la guerre contre l’Allemagne n’oubliant pas l’aide que ce pays a apporté à Franco. Une partie d’entre eux seront envoyés par exemple sur la ligne Maginot pour participer aux travaux de consolidation ; pris en tenaille par l’offensive allemande, ils auront la joie de connaître d’autres camps, de l’autre côté du Rhin cette fois-ci. Les Espagnols bénéficient d’un « traitement de faveur » de la part des Nazis : dans le camp de Mauthausen, 80% des détenus sont espagnols. 8 000 périront en déportation. Concernant cette « Retirada », les chiffres sont terriblement éloquents. Cinq cent mille personnes environ franchissent la frontière entre janvier et mars 1939. Plus de 350 ooo sont enfermées dans la quinzaine de camps de concentration établis en France (Argelès 100 000, Saint-Cyprien 80 000, Barcarès, Rivesaltes 75 000, Gurs 25 000, Brame, Agde… etc…). Si l’on a guère le temps de fournir un équipement de survie, on a le temps de faire des listes, des statistiques et des tris. Le camp du Vernet se spécialise peu à peu dans l’hébergement des anarchistes (les miliciens de la Colonne Durutti par exemple), détenus dangereux s’il en est ! Plusieurs milliers d’entre eux y passeront. On interne dans le camp de Gurs une grande partie des combattants. Le régime imposé dans ces deux derniers camps est particulièrement sévère. A Gurs, quatre cents baraquements construits à la hâte permettent de « neutraliser » soldats espagnols et volontaires étrangers des Brigades Internationales. Les conditions de détention sont ignobles : les hommes vivent dans la boue et sont surveillés comme des criminels. Dès la défaite de juin 1939, le régime de Vichy reprend la gestion de ce camp et s’en sert pour interner les juifs victimes des premières rafles. Gurs est pour eux la dernière étape avant les camps de la mort en Allemagne. Les occupants précédents du camp se sont peu à peu volatilisés : incorporés dans les CTE (camps de travail étrangers), évadés et plus ou moins intégrés dans les villes et villages, volontaires pour le maquis, ou purement et simplement livrés à Franco.
Concernant cette « Retirada », les chiffres sont terriblement éloquents. Cinq cent mille personnes environ franchissent la frontière entre janvier et mars 1939. Plus de 350 ooo sont enfermées dans la quinzaine de camps de concentration établis en France (Argelès 100 000, Saint-Cyprien 80 000, Barcarès, Rivesaltes 75 000, Gurs 25 000, Brame, Agde… etc…). Si l’on a guère le temps de fournir un équipement de survie, on a le temps de faire des listes, des statistiques et des tris. Le camp du Vernet se spécialise peu à peu dans l’hébergement des anarchistes (les miliciens de la Colonne Durutti par exemple), détenus dangereux s’il en est ! Plusieurs milliers d’entre eux y passeront. On interne dans le camp de Gurs une grande partie des combattants. Le régime imposé dans ces deux derniers camps est particulièrement sévère. A Gurs, quatre cents baraquements construits à la hâte permettent de « neutraliser » soldats espagnols et volontaires étrangers des Brigades Internationales. Les conditions de détention sont ignobles : les hommes vivent dans la boue et sont surveillés comme des criminels. Dès la défaite de juin 1939, le régime de Vichy reprend la gestion de ce camp et s’en sert pour interner les juifs victimes des premières rafles. Gurs est pour eux la dernière étape avant les camps de la mort en Allemagne. Les occupants précédents du camp se sont peu à peu volatilisés : incorporés dans les CTE (camps de travail étrangers), évadés et plus ou moins intégrés dans les villes et villages, volontaires pour le maquis, ou purement et simplement livrés à Franco. Pour légitimer le statut bien singulier de ces réfugiés, l’Etat français va effectuer de multiples pirouettes juridiques. Ce ne sont pas des prisonniers puisqu’ils n’ont fait les frais d’aucune décision de justice. Ce ne sont pas non plus des réfugiés politiques, car ce statut ne leur est pas accordé et ils ne bénéficient donc pas des dispositions prévues par la convention de Genève. On crée pour eux le statut d’ « étrangers indésirables », bien commode pour justifier barbelés, miradors, et privations diverses. Pendant les premières semaines, l’aliment de base devient le topinambour. On n’enferme pas 80 000 personnes sur une superficie restreinte comme au Barcarès, sans que cela ne prête à conséquence. L’absence d’hygiène, le manque de soins, les carences alimentaires provoquent des épidémies de dysenterie, de pneumonie, de typhoïde, de paludisme, de tuberculose… On estime le nombre de décès à environ 15 000 au début de l’année 1939. D’où la nécessité de renforcer la surveillance et le contrôle des camps pour éviter que ces maladies ne se propagent parmi la population environnante… Les témoignages que publient les journaux de Gauche sur cette catastrophe sanitaire laissent une bonne partie de la France totalement indifférente. Après tout, ce sont des « rouges » (pire même des suppôts de l’Anarchie). La vie est dure pour tout le monde, ils n’ont qu’à retourner chez eux, c’est la paix maintenant… 190 634 Espagnols sont fusillés par la dictature entre 1939 et 1944, selon les chiffres officiels fournis par le Ministère de la Justice franquiste. Quant à l’emploi du terme de « camp de concentration » eh bien c’est au député radical socialiste Albert Sarraut (futur collaborateur) qu’on le doit : il l’utilise lors de « l’inauguration » du camp d’Argelès en février 39 : «Le camp ne sera pas un lieu pénitentiaire mais un camp de concentration. Ce n’est pas la même chose. Les asilés qui y prendront séjour n’y resteront guère que le temps nécessaire pour préparer leur refoulement, ou, sur leur option, leur libre passage de retour en Espagne.» Pas étonnant que ce bonhomme ait ensuite voté les pleins pouvoirs à Pétain !
Pour légitimer le statut bien singulier de ces réfugiés, l’Etat français va effectuer de multiples pirouettes juridiques. Ce ne sont pas des prisonniers puisqu’ils n’ont fait les frais d’aucune décision de justice. Ce ne sont pas non plus des réfugiés politiques, car ce statut ne leur est pas accordé et ils ne bénéficient donc pas des dispositions prévues par la convention de Genève. On crée pour eux le statut d’ « étrangers indésirables », bien commode pour justifier barbelés, miradors, et privations diverses. Pendant les premières semaines, l’aliment de base devient le topinambour. On n’enferme pas 80 000 personnes sur une superficie restreinte comme au Barcarès, sans que cela ne prête à conséquence. L’absence d’hygiène, le manque de soins, les carences alimentaires provoquent des épidémies de dysenterie, de pneumonie, de typhoïde, de paludisme, de tuberculose… On estime le nombre de décès à environ 15 000 au début de l’année 1939. D’où la nécessité de renforcer la surveillance et le contrôle des camps pour éviter que ces maladies ne se propagent parmi la population environnante… Les témoignages que publient les journaux de Gauche sur cette catastrophe sanitaire laissent une bonne partie de la France totalement indifférente. Après tout, ce sont des « rouges » (pire même des suppôts de l’Anarchie). La vie est dure pour tout le monde, ils n’ont qu’à retourner chez eux, c’est la paix maintenant… 190 634 Espagnols sont fusillés par la dictature entre 1939 et 1944, selon les chiffres officiels fournis par le Ministère de la Justice franquiste. Quant à l’emploi du terme de « camp de concentration » eh bien c’est au député radical socialiste Albert Sarraut (futur collaborateur) qu’on le doit : il l’utilise lors de « l’inauguration » du camp d’Argelès en février 39 : «Le camp ne sera pas un lieu pénitentiaire mais un camp de concentration. Ce n’est pas la même chose. Les asilés qui y prendront séjour n’y resteront guère que le temps nécessaire pour préparer leur refoulement, ou, sur leur option, leur libre passage de retour en Espagne.» Pas étonnant que ce bonhomme ait ensuite voté les pleins pouvoirs à Pétain ! Au vu de ce qui se passe avec les migrants actuels, parqués dans des camps comme la « Jungle de Calais » ou des centres d’internement dans lesquels ils subissent trop souvent les pires humiliations, je me demande si les mentalités, dans leur ensemble, ont beaucoup évolué. Pour la plupart d’entre eux, la sanction tombe rapidement : renvoi manu militari dans leur pays d’origine où eux aussi risquent la mort. Comme en 1939, celles et ceux qui tentent de venir en aide aux réfugiés sont victimes de harcèlements et de répression judiciaire. De ce côté là aussi, les choses n’ont guère changé.
Au vu de ce qui se passe avec les migrants actuels, parqués dans des camps comme la « Jungle de Calais » ou des centres d’internement dans lesquels ils subissent trop souvent les pires humiliations, je me demande si les mentalités, dans leur ensemble, ont beaucoup évolué. Pour la plupart d’entre eux, la sanction tombe rapidement : renvoi manu militari dans leur pays d’origine où eux aussi risquent la mort. Comme en 1939, celles et ceux qui tentent de venir en aide aux réfugiés sont victimes de harcèlements et de répression judiciaire. De ce côté là aussi, les choses n’ont guère changé. Notre maison est située dans une région intéressante de par son voisinage géographique : les basses terres du Rhône – terminologie à rapprocher de celle de « Bas Dauphiné », plus vaste, à laquelle nous appartenons également. Certains Dauphinois du Sud nous casent dans la région des « Terres froides », mais ce sont des ignares, des gens qui pensent que le Nord de leur département se situe dans la banlieue de Lille ou d’Amiens. Laissons les à leur inculture pour reprendre notre brillant exposé. Placez vous avec moi à la fenêtre de la salle à manger… A main gauche, juste derrière le Rhône, les premiers contreforts du Jura ; à main droite, les massifs des pré-Alpes, la Chartreuse et le massif des Bauges en particulier. Ce sont les reliefs les plus proches : quelques kilomètres à vol d’oiseau pour le Bugey, à peine plus pour l’avant-pays savoyard. Dans notre dos, le Massif Central, mais la distance est plus conséquente pour atteindre le Vivarais ou les Monts du Lyonnais ; il faut bien compter une centaine de kilomètres. Le Jura est notre lieu de prédilection pour les randonnées « montagne à vache ». Les points culminants les plus proches s’élèvent à mille mètres environ. Nos principales références en matière d’orientation : le plateau d’Innimond, ou la Dent du Chat qui domine le lac du Bourget.
Notre maison est située dans une région intéressante de par son voisinage géographique : les basses terres du Rhône – terminologie à rapprocher de celle de « Bas Dauphiné », plus vaste, à laquelle nous appartenons également. Certains Dauphinois du Sud nous casent dans la région des « Terres froides », mais ce sont des ignares, des gens qui pensent que le Nord de leur département se situe dans la banlieue de Lille ou d’Amiens. Laissons les à leur inculture pour reprendre notre brillant exposé. Placez vous avec moi à la fenêtre de la salle à manger… A main gauche, juste derrière le Rhône, les premiers contreforts du Jura ; à main droite, les massifs des pré-Alpes, la Chartreuse et le massif des Bauges en particulier. Ce sont les reliefs les plus proches : quelques kilomètres à vol d’oiseau pour le Bugey, à peine plus pour l’avant-pays savoyard. Dans notre dos, le Massif Central, mais la distance est plus conséquente pour atteindre le Vivarais ou les Monts du Lyonnais ; il faut bien compter une centaine de kilomètres. Le Jura est notre lieu de prédilection pour les randonnées « montagne à vache ». Les points culminants les plus proches s’élèvent à mille mètres environ. Nos principales références en matière d’orientation : le plateau d’Innimond, ou la Dent du Chat qui domine le lac du Bourget. L’intérêt de ce dernier massif, c’est de nous permettre de savoir dans quelle direction se situe le Mont-Blanc… En raison d’un caprice du relief, nous ne pouvons voir le « Top of Europ » comme disent une partie de nos visiteurs étrangers, depuis nos fenêtres. Il faut parcourir une centaine de mètres sur la petite route qui passe devant chez nous, et nous diriger vers le Nord-Ouest, pour savoir si « sa majesté » daigne se montrer ou pas. La netteté ainsi que l’éloignement de sa silhouette nous informent sur la météo des jours à venir. Si on n’arrive pas à le voir, eh bien, comme on dit en Bretagne ou en Irlande, c’est qu’il va pleuvoir ou qu’il pleut déjà. Si le sommet semble proche et que ses lignes semblent tracées au crayon sur le ciel, c’est que la pluie attendra une ou deux journées. Lorsqu’on peine à le distinguer parmi les autres monts, c’est plutôt bon signe pour les amateurs de soleil que nous sommes.
L’intérêt de ce dernier massif, c’est de nous permettre de savoir dans quelle direction se situe le Mont-Blanc… En raison d’un caprice du relief, nous ne pouvons voir le « Top of Europ » comme disent une partie de nos visiteurs étrangers, depuis nos fenêtres. Il faut parcourir une centaine de mètres sur la petite route qui passe devant chez nous, et nous diriger vers le Nord-Ouest, pour savoir si « sa majesté » daigne se montrer ou pas. La netteté ainsi que l’éloignement de sa silhouette nous informent sur la météo des jours à venir. Si on n’arrive pas à le voir, eh bien, comme on dit en Bretagne ou en Irlande, c’est qu’il va pleuvoir ou qu’il pleut déjà. Si le sommet semble proche et que ses lignes semblent tracées au crayon sur le ciel, c’est que la pluie attendra une ou deux journées. Lorsqu’on peine à le distinguer parmi les autres monts, c’est plutôt bon signe pour les amateurs de soleil que nous sommes. Le plateau d’Innimond, dans le Bugey voisin, joue un rôle plus modeste, mais néanmoins non négligeable. Rares sont les journées sans que l’on fasse une remarque à son sujet. La face Sud que nous apercevons par nos fenêtres, est couverte d’une grande prairie. La neige y est bien plus présente que dans notre jardin ; c’est logique puisque pour atteindre le sommet de ce géant du Jura il faut franchir un dénivelé de plus de 700 m. Alors les remarques vont bon train :
Le plateau d’Innimond, dans le Bugey voisin, joue un rôle plus modeste, mais néanmoins non négligeable. Rares sont les journées sans que l’on fasse une remarque à son sujet. La face Sud que nous apercevons par nos fenêtres, est couverte d’une grande prairie. La neige y est bien plus présente que dans notre jardin ; c’est logique puisque pour atteindre le sommet de ce géant du Jura il faut franchir un dénivelé de plus de 700 m. Alors les remarques vont bon train : Pour ceux qui s’intéressent à l’histoire et aux traditions locales, le village d’Innimond, au pied du plateau d’Innimond, a toujours constitué une mine de trouvailles pittoresques pour les ethnologues en herbe. Des revues comme la défunte « Evocations » remplissaient leurs pages d’historiettes, de contes en patois, de traditions singulières collectées dans ce village… L’un des charmes de ces récits c’est qu’ils étaient fort souvent truculents et à la limite d’une grossièreté bon enfant qui avait de quoi ravir le chaland trop habitué à des articles policés. Dans ces récits bugistes traditionnels, les personnages n’hésitaient point à ponctuer leurs aventures de flatulences diverses et de jurons hauts en couleur. Pour le dire de manière un peu crue, mais sans aucune intention de mal juger quiconque, ces montagnards « un peu à l’écart » étaient considérés un peu comme arriérés. C’était comme cela il y a un bon demi-siècle, disons, d’autant que l’accès dans ce genre de village isolé n’étant pas simple, les progrès élémentaires tels que courant électrique, remonte-pente, brosse à dents atomique et autres quads, avaient mis un peu de temps avant de parvenir à ces altitudes.
Pour ceux qui s’intéressent à l’histoire et aux traditions locales, le village d’Innimond, au pied du plateau d’Innimond, a toujours constitué une mine de trouvailles pittoresques pour les ethnologues en herbe. Des revues comme la défunte « Evocations » remplissaient leurs pages d’historiettes, de contes en patois, de traditions singulières collectées dans ce village… L’un des charmes de ces récits c’est qu’ils étaient fort souvent truculents et à la limite d’une grossièreté bon enfant qui avait de quoi ravir le chaland trop habitué à des articles policés. Dans ces récits bugistes traditionnels, les personnages n’hésitaient point à ponctuer leurs aventures de flatulences diverses et de jurons hauts en couleur. Pour le dire de manière un peu crue, mais sans aucune intention de mal juger quiconque, ces montagnards « un peu à l’écart » étaient considérés un peu comme arriérés. C’était comme cela il y a un bon demi-siècle, disons, d’autant que l’accès dans ce genre de village isolé n’étant pas simple, les progrès élémentaires tels que courant électrique, remonte-pente, brosse à dents atomique et autres quads, avaient mis un peu de temps avant de parvenir à ces altitudes. Depuis, les choses ont bien changé et les agriculteurs, quelque peu dégoûtés par la rigueur de leurs conditions de vie et le mépris des citadins, ont eu tendance à brader leurs demeures traditionnelles et à préférer s’entasser dans les tours exemplaires de nos banlieues modernes. Les temps ayant changé, cet exode bienvenu a permis à tous les citadins un peu fortunés d’acquérir de superbes fermettes en pierre, et de les utiliser comme résidences secondaires, tertiaires ou quaternaires. Revirement d’opinion n’ayant rien de bien surprenant, sachant que tous ces connaisseurs cherchaient un terrain de jeu pour leurs 4×4 et un champ de tir pour s’exercer à la chasse au sanglier, ont considéré finalement que ces bouseux avaient bien de la chance d’habiter dans un décor aussi sublime ; d’autant que les nouveaux venus pouvaient passer l’hiver bien au chaud dans leur loft en centre ville, un peu étroit mais bien conçu, et s’adonner assez fréquemment aux joies du shopping. La campagne certes – c’est bon pour les enfants – mais de là à manquer le « black friday », faut pas exagérer !
Depuis, les choses ont bien changé et les agriculteurs, quelque peu dégoûtés par la rigueur de leurs conditions de vie et le mépris des citadins, ont eu tendance à brader leurs demeures traditionnelles et à préférer s’entasser dans les tours exemplaires de nos banlieues modernes. Les temps ayant changé, cet exode bienvenu a permis à tous les citadins un peu fortunés d’acquérir de superbes fermettes en pierre, et de les utiliser comme résidences secondaires, tertiaires ou quaternaires. Revirement d’opinion n’ayant rien de bien surprenant, sachant que tous ces connaisseurs cherchaient un terrain de jeu pour leurs 4×4 et un champ de tir pour s’exercer à la chasse au sanglier, ont considéré finalement que ces bouseux avaient bien de la chance d’habiter dans un décor aussi sublime ; d’autant que les nouveaux venus pouvaient passer l’hiver bien au chaud dans leur loft en centre ville, un peu étroit mais bien conçu, et s’adonner assez fréquemment aux joies du shopping. La campagne certes – c’est bon pour les enfants – mais de là à manquer le « black friday », faut pas exagérer ! En fait, il faut le dire, ces gens-là n’étaient guère intéressants et ne le sont toujours pas : peu fréquentables à cause de leurs opinions à la droite de la gauche, et surtout de l’argent frais qui s’écoulait entre leurs doigts peu économes. Heureusement, une autre vague d’immigration rurale et montagnarde a suivi… Elle était constitué de gens beaucoup moins fortunés, ne trouvant plus aucun charme à leur travail et à leur vie urbaine, et souhaitant impulser à nouveau un minimum de vie locale ; et ce toute l’année et non le week-end et les jours fériés. J’arrêterai là cette dissertation car ce n’est point là l’objet de ce billet. L’auteur n’étant point sociologue laisse à d’autres le soin de disserter sur les ruraux, les néo-ruraux ou les zozos matelassés de billets. Mon propos de bouseux de la plaine se limitera en effet à expliquer l’importance de voir, depuis sa fenêtre, la ligne bleue du Jura et de savoir en extraire toute la substantifique moelle pour enrichir son quotidien.
En fait, il faut le dire, ces gens-là n’étaient guère intéressants et ne le sont toujours pas : peu fréquentables à cause de leurs opinions à la droite de la gauche, et surtout de l’argent frais qui s’écoulait entre leurs doigts peu économes. Heureusement, une autre vague d’immigration rurale et montagnarde a suivi… Elle était constitué de gens beaucoup moins fortunés, ne trouvant plus aucun charme à leur travail et à leur vie urbaine, et souhaitant impulser à nouveau un minimum de vie locale ; et ce toute l’année et non le week-end et les jours fériés. J’arrêterai là cette dissertation car ce n’est point là l’objet de ce billet. L’auteur n’étant point sociologue laisse à d’autres le soin de disserter sur les ruraux, les néo-ruraux ou les zozos matelassés de billets. Mon propos de bouseux de la plaine se limitera en effet à expliquer l’importance de voir, depuis sa fenêtre, la ligne bleue du Jura et de savoir en extraire toute la substantifique moelle pour enrichir son quotidien. Le plateau d’Innimond présente un autre centre d’intérêt essentiel à nos yeux, quand nous avons fini de disserter quotidiennement sur la météorologie ; à son extrémité droite (vue depuis la fenêtre), se trouve une table d’orientation facilement accessible par une petite route. Ceux qui suivent régulièrement ce blog d’intérêt international savent que nous hébergeons, à la belle saison, d’intrépides voyageurs venus des quatre coins de notre ronde planète, pour découvrir les mœurs des Français, excentriques et en partie ruraux, du Nord Dauphiné. Quand le temps des loisirs arrive, après avoir désherbé les carottes, mis en confiture les groseilles, et transformé les bambous en choucroute pour le compost, vient le moment exquis de la balade, afin de découvrir les points d’intérêts majeurs de la région… à pied, en vélo et en voiture bien entendu, puisque l’automobile prend sa place parmi les objets utilisés par les autochtones. Alors on propose bien entendu à nos valeureux stagiaires de découvrir les lieux incontournables (genre Halles de Crémieu, la brasserie locale ou les grottes de La Balme)… mais on les conduit en priorité à la table d’orientation du plateau d’Innimond… C’est un must dans notre programme de découverte locale. D’abord ça me permet de leur coller un cours de géographie gratuit (on ne change pas la mentalité pourrie d’un instit retraité), mais ce n’est pas tout. Ce lieu charmant est aussi le point de départ de une ou plusieurs randonnées pédestres particulièrement plaisantes (un peu moins au mois de septembre quand il faut zigzaguer entre les balles des vaillants nemrods d’opérette traquant le redoutable cochonglier). Deux ou trois heures de marche plus tard, on peut aussi faire une halte non loin du « Sully » local, un magnifique tilleul qui fait l’admiration, méritée, des habitants du cru… Non loin de là il y a aussi une fruitière qui propose une sympathique sélection de produits régionaux…
Le plateau d’Innimond présente un autre centre d’intérêt essentiel à nos yeux, quand nous avons fini de disserter quotidiennement sur la météorologie ; à son extrémité droite (vue depuis la fenêtre), se trouve une table d’orientation facilement accessible par une petite route. Ceux qui suivent régulièrement ce blog d’intérêt international savent que nous hébergeons, à la belle saison, d’intrépides voyageurs venus des quatre coins de notre ronde planète, pour découvrir les mœurs des Français, excentriques et en partie ruraux, du Nord Dauphiné. Quand le temps des loisirs arrive, après avoir désherbé les carottes, mis en confiture les groseilles, et transformé les bambous en choucroute pour le compost, vient le moment exquis de la balade, afin de découvrir les points d’intérêts majeurs de la région… à pied, en vélo et en voiture bien entendu, puisque l’automobile prend sa place parmi les objets utilisés par les autochtones. Alors on propose bien entendu à nos valeureux stagiaires de découvrir les lieux incontournables (genre Halles de Crémieu, la brasserie locale ou les grottes de La Balme)… mais on les conduit en priorité à la table d’orientation du plateau d’Innimond… C’est un must dans notre programme de découverte locale. D’abord ça me permet de leur coller un cours de géographie gratuit (on ne change pas la mentalité pourrie d’un instit retraité), mais ce n’est pas tout. Ce lieu charmant est aussi le point de départ de une ou plusieurs randonnées pédestres particulièrement plaisantes (un peu moins au mois de septembre quand il faut zigzaguer entre les balles des vaillants nemrods d’opérette traquant le redoutable cochonglier). Deux ou trois heures de marche plus tard, on peut aussi faire une halte non loin du « Sully » local, un magnifique tilleul qui fait l’admiration, méritée, des habitants du cru… Non loin de là il y a aussi une fruitière qui propose une sympathique sélection de produits régionaux… Béni soit donc ce plateau d’Innimond qui pourvoit aux besoins conversationnels quotidiens et permet aussi de se repérer dans une géographie jurassienne et alpine parfois bien complexe. Je concède qu’il s’agit d’une gloire géographique locale, très locale même, puisque mon fils aîné qui habite de l’autre côté du plateau, loin là-bas, dans l’Ain, quasiment à l’étranger, se réfère à d’autres centres d’intérêts bien plus considérables à ses yeux comme le sommet du Colombier qui écrase mon plateau préféré du haut de son altitude quasiment deux fois plus élevée. Mais ne soyons pas jaloux… Derrière la ligne bleue du Jura, se cache le pays des Helvètes, mais il s’agit là d’une toute autre histoire que vous pouvez, par exemple, découvrir dans un album de Tintin (bof !) ou en écoutant les sublimes chansons de l’ami Bühler (Michel de son petit nom). Quand je pense que ce troubadour de première classe envisage dans l’une des ses complaintes de raser les Alpes pour « qu’on voit la mer »… Heureusement qu’il ne s’attaque pas à notre célèbre plateau ! Nous les vieux, on a encore besoin de quelques repères, non mais !
Béni soit donc ce plateau d’Innimond qui pourvoit aux besoins conversationnels quotidiens et permet aussi de se repérer dans une géographie jurassienne et alpine parfois bien complexe. Je concède qu’il s’agit d’une gloire géographique locale, très locale même, puisque mon fils aîné qui habite de l’autre côté du plateau, loin là-bas, dans l’Ain, quasiment à l’étranger, se réfère à d’autres centres d’intérêts bien plus considérables à ses yeux comme le sommet du Colombier qui écrase mon plateau préféré du haut de son altitude quasiment deux fois plus élevée. Mais ne soyons pas jaloux… Derrière la ligne bleue du Jura, se cache le pays des Helvètes, mais il s’agit là d’une toute autre histoire que vous pouvez, par exemple, découvrir dans un album de Tintin (bof !) ou en écoutant les sublimes chansons de l’ami Bühler (Michel de son petit nom). Quand je pense que ce troubadour de première classe envisage dans l’une des ses complaintes de raser les Alpes pour « qu’on voit la mer »… Heureusement qu’il ne s’attaque pas à notre célèbre plateau ! Nous les vieux, on a encore besoin de quelques repères, non mais ! Omar Khayyam, l’auteur des quatrains, est largement connu dans les milieux intellectuels ; sa consœur, Mahsati Ganjavi, l’est beaucoup moins, alors que les poèmes qu’elle a écrits sont appréciés pour la richesse de leur style. La mémoire est sélective, du moins dans notre société, et même si les mœurs évoluent, il faudra encore bien du temps pour que les femmes retrouvent la place qui est la leur, dans le domaine des sciences et des arts (entre autres). Dans la lignée des chroniques que j’ai déjà publiées sur les savants du monde arabe, j’avais envie de vous parler d’Omar Khayyam (je viens de terminer le livre que lui a consacré l’écrivain Amin Maalouf) mais j’ai décidé de vous parler en premier de Mahsati Ganjavi, la « dame de la lune » (ainsi peut-on traduire « Mahsati ») et de ses « rubaïyat » (*) consacrés à l’amour. Un point commun relie les deux personnalités : leur franc parler et leur liberté de ton qui n’a pas eu l’honneur de plaire à leurs contemporains les plus orthodoxes !
Omar Khayyam, l’auteur des quatrains, est largement connu dans les milieux intellectuels ; sa consœur, Mahsati Ganjavi, l’est beaucoup moins, alors que les poèmes qu’elle a écrits sont appréciés pour la richesse de leur style. La mémoire est sélective, du moins dans notre société, et même si les mœurs évoluent, il faudra encore bien du temps pour que les femmes retrouvent la place qui est la leur, dans le domaine des sciences et des arts (entre autres). Dans la lignée des chroniques que j’ai déjà publiées sur les savants du monde arabe, j’avais envie de vous parler d’Omar Khayyam (je viens de terminer le livre que lui a consacré l’écrivain Amin Maalouf) mais j’ai décidé de vous parler en premier de Mahsati Ganjavi, la « dame de la lune » (ainsi peut-on traduire « Mahsati ») et de ses « rubaïyat » (*) consacrés à l’amour. Un point commun relie les deux personnalités : leur franc parler et leur liberté de ton qui n’a pas eu l’honneur de plaire à leurs contemporains les plus orthodoxes ! Mahsati Ganjavi est née le 12 mai 1089 à Gandja (aujourd’hui en Azerbaïdjan). Dans cette ville, elle apparait à la cour du Prince Moghith al-Din où elle s’occupe de la culture et de l’organisation des festivités. Elle quitte ensuite ce lieu et parcourt la région : elle aurait ensuite séjourné à Balkh, Marv, Nishapur, Herat et Marva. Elle a vécu de longues années, avec le titre de poétesse officielle, à la cour de Mahmud Saljugi et de son oncle, le Sultan Sanjar Saljugi. Outre ses talents d’écriture poétique, Mahsati était également une musicienne renommée ; elle jouait de la harpe, du luth et du târ. Le Sultan Sanjar en aurait bien fait sa maîtresse, mais la jeune femme refusa toutes ses avances et lui remit ce quatrain :
Mahsati Ganjavi est née le 12 mai 1089 à Gandja (aujourd’hui en Azerbaïdjan). Dans cette ville, elle apparait à la cour du Prince Moghith al-Din où elle s’occupe de la culture et de l’organisation des festivités. Elle quitte ensuite ce lieu et parcourt la région : elle aurait ensuite séjourné à Balkh, Marv, Nishapur, Herat et Marva. Elle a vécu de longues années, avec le titre de poétesse officielle, à la cour de Mahmud Saljugi et de son oncle, le Sultan Sanjar Saljugi. Outre ses talents d’écriture poétique, Mahsati était également une musicienne renommée ; elle jouait de la harpe, du luth et du târ. Le Sultan Sanjar en aurait bien fait sa maîtresse, mais la jeune femme refusa toutes ses avances et lui remit ce quatrain : On lui a pourtant reproché, par la suite, les nombreuses liaisons qu’elle aurait eues avec un certain nombre de personnages importants et elle a conservé l’image, dans une fraction de l’opinion, de « femme aux mœurs légères ». L’histoire de sa vie est cependant mal connue et ce genre de rumeur est difficile à vérifier ! Lacune plus importante : on ignore si elle a connu et rencontré son contemporain Omar Khayyam qui écrivait lui aussi en Persan. Tous deux étaient poètes et libres penseurs ; l’un des deux a-t-il influencé l’autre ? Ce qui est certain c’est que beaucoup de préoccupations leur sont communes et que l’un comme l’autre ne se sont pas privés d’égratigner dans leurs écrits le conservatisme social, l’hypocrisie et les préjugés de la religion de leurs pairs et, plus généralement, de la société dans laquelle ils vivaient. Tous deux ont par ailleurs choisi la forme du quatrain, le robaïyat comme format pour leur poésie philosophique. Ceux écrits par la « dame de la lune » nous sont connus par plusieurs publications postérieures que des lettrés ont consacrées à l’écriture poétique en Persan. Une soixantaine de ses quatrains ont notamment été répertoriés dans le « Nozhat al-Majales », une anthologie de 4100 poèmes persans rédigée par le poète Jamal al-Din Khalil Shirvani. La plupart des textes de Mahsati Ganjavi évoquent la joie de vivre et l’importance de l’amour… A ses yeux, l’amour est un sentiment naturel fragile qui ne peut qu’accroître la grandeur de l’homme et renforcer sa renommée.
On lui a pourtant reproché, par la suite, les nombreuses liaisons qu’elle aurait eues avec un certain nombre de personnages importants et elle a conservé l’image, dans une fraction de l’opinion, de « femme aux mœurs légères ». L’histoire de sa vie est cependant mal connue et ce genre de rumeur est difficile à vérifier ! Lacune plus importante : on ignore si elle a connu et rencontré son contemporain Omar Khayyam qui écrivait lui aussi en Persan. Tous deux étaient poètes et libres penseurs ; l’un des deux a-t-il influencé l’autre ? Ce qui est certain c’est que beaucoup de préoccupations leur sont communes et que l’un comme l’autre ne se sont pas privés d’égratigner dans leurs écrits le conservatisme social, l’hypocrisie et les préjugés de la religion de leurs pairs et, plus généralement, de la société dans laquelle ils vivaient. Tous deux ont par ailleurs choisi la forme du quatrain, le robaïyat comme format pour leur poésie philosophique. Ceux écrits par la « dame de la lune » nous sont connus par plusieurs publications postérieures que des lettrés ont consacrées à l’écriture poétique en Persan. Une soixantaine de ses quatrains ont notamment été répertoriés dans le « Nozhat al-Majales », une anthologie de 4100 poèmes persans rédigée par le poète Jamal al-Din Khalil Shirvani. La plupart des textes de Mahsati Ganjavi évoquent la joie de vivre et l’importance de l’amour… A ses yeux, l’amour est un sentiment naturel fragile qui ne peut qu’accroître la grandeur de l’homme et renforcer sa renommée. Différents hommages lui ont été rendus par nos contemporains : plusieurs rues ou écoles portent son nom dans des bourgades d’Azerbaïdjan. Dans sa ville natale, un musée lui est consacré et un monument commémoratif a été inauguré en 1980. En novembre 2013, à l’occasion de son 900ème jubilé, une exposition a été consacrée à la poétesse, au Palais du Tau, à Reims. Il n’existe cependant pas de version française de ses quatrains qui ont été traduits, pour l’instant, en Anglais et en Italien (La luna e le perle). Nombreux sont les recueils édités consacrés aux quatrains d’Omar Khayyam ; espérons que par souci d’équité, un éditeur voudra bien se pencher sur les travaux de cette autre artiste remarquable !
Différents hommages lui ont été rendus par nos contemporains : plusieurs rues ou écoles portent son nom dans des bourgades d’Azerbaïdjan. Dans sa ville natale, un musée lui est consacré et un monument commémoratif a été inauguré en 1980. En novembre 2013, à l’occasion de son 900ème jubilé, une exposition a été consacrée à la poétesse, au Palais du Tau, à Reims. Il n’existe cependant pas de version française de ses quatrains qui ont été traduits, pour l’instant, en Anglais et en Italien (La luna e le perle). Nombreux sont les recueils édités consacrés aux quatrains d’Omar Khayyam ; espérons que par souci d’équité, un éditeur voudra bien se pencher sur les travaux de cette autre artiste remarquable !